Présentation du livre par Amin Maalouf
DOSSIER
AUTEUR
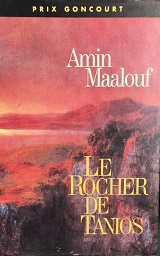
éd. Club France Loisirs, 1994, avec un message
de l'auteur aux lecteurs et lectrices
J'ai quitté le Liban en juin 1976 et, dès ce moment-là, la tentation était grande, pour moi, de consacrer un livre à ce pays, à sa montagne célébrée par la Bible, à son aventure humaine exceptionnelle et aux drames qu'il a vécus. J'ai pourtant attendu dix-sept ans avant d'en parler, et j'ai écrit cinq livres dans lesquels j'ai voyagé de l'Espagne de l'Inquisition à la Mésopotamie sassanide, en passant par la Perse des Assassins et l'Italie de la Renaissance - sans jamais mentionner le Liban. Ce livre, pourtant, je savais depuis toujours que je devais l'écrire. Je le devais, en quelque sorte, aux miens et à moi-même. Car si ce n'est pas, à vrai dire, mon histoire que j'y raconte, c'est certainement l'histoire des miens, celle de mes aïeux proches ou lointains, celle de mon village et de tant d'autres villages, celle de la Montagne.
Pour
écrire ce livre, j'ai choisi d'aller vivre loin de mon domicile
parisien, dans une île superbe et paisible au large de la Vendée,
et si ma femme venait parfois m'y retrouver, je n'ai vu mes enfants que
trois fois dans l'année - seul le téléphone maintenait
nos liens, nos échanges. J'avais besoin de solitude et de sérénité
pour laisser, en quelque sorte, remonter en moi une foule d'images, de
visages, de récits, de sensations.
Peu à peu, une histoire s'est imposée à moi, qui
allait devenir le point de départ et le fil conducteur du roman.
Mon père me l'avait racontée il y a plus de vingt-cinq ans,
alors que nous marchions ensemble sur l'unique route du village. Il s'était
arrêté, m'avait désigné à sa droite
un enchevêtrement de rochers au bout de la route, vers le haut :
"C'est ici qu'a été tué le patriarche, autrefois,
des mains d'un certain Abou-Kichk Maalouf." Il me raconta alors ce
qui avait amené ce dernier à se transformer en meurtrier.
Celui-ci
avait un fils qui était tombé amoureux de la fille d'un
notable, et Abou-Kichk, qui était de condition modeste, n'osait
pas demander sa main de peur d'essuyer un refus et de perdre la face.
Il avait donc sollicité le patriarche de sa communauté,
un personnage fort influent, le priant d'intervenir à sa place.
Le prélat était donc allé chez le notable, avait
constaté qu'il était effectivement fort prospère,
et que sa fille était d'une grande beauté, si bien qu'il
n'avait pu s'empêcher de demander sa main... pour son propre neveu.
En apprenant la nouvelle, Abou-Kichk, s'estimant trompé, bafoué,
avait tendu une embuscade et, d'un coup de fusil, avait abattu le patriarche.
Puis il avait dévalé la montagne, en compagnie de son fils,
jusqu'à la mer, s'était embarqué vers l'île
de Chypre pour y chercher refuge. Mais les agents de l'émir l'avaient
suivi, quelque temps après, dans le but de le ramener au pays afin
qu'il y soit châtié.
Ce récit ne m'avait pas laissé indifférent. J'y ai
très souvent pensé depuis. Dans le pays, d'ailleurs, ce
crime n'a jamais été considéré comme un simple
fait divers. Le mobile, passionnel mais de manière indirecte, inaccoutumée,
la personnalité de la victime, un des plus hauts dignitaires chrétiens
d'Orient, et aussi l'acharnement de l'émir, gouverneur de la Montagne,
à ramener le criminel d'au-delà la mer, chose inouïe
à l'époque, tout cela a contribué à créer,
autour d'Abou-Kichk et de son méfait, un halo de légende.
C'était en quelque sorte le crime célèbre du XIXe
siècle dans le Mont-Liban, l'histoire qu'on se dépêchait
de raconter à tous les étrangers de passage, Lamartine,
par exemple, ainsi que Renan ou Barrès.
Au village, bien entendu, l'affaire prit une tout autre ampleur. Qu'un
tel événement - fût-il criminel - ait eu lieu "chez
nous" suscitait en certains de mes proches une sorte de fierté.
D'innombrables histoires circulaient à propos d'Abou-Kichk, de
son fils, du patriarche, les unes vraisemblables, d'autres fantaisistes
; l'un des oncles de mon père s'en était même fait
une spécialité : au cours des longues soirées d'hiver,
il contait inlassablement l'histoire d'Abou-Kichk, introduisant à
chaque fois des variantes, des "améliorations", se sorte
qu'il y eut, me dit-on, pour ses auditeurs, autant d'histoires différentes
que de soirées.
Je n'ai pas connu cette époque ni ses conteurs. À ma naissance,
ce grand-oncle était mort. La vie villageoise n'était d'ailleurs
plus la même et ne le serait jamais plus. La plupart des familles
étaient allées s'installer en ville où elles passaient
les neuf mois d'hiver, ne "remontant" plus au village que pour
l'été. Puis arriva la télévision, les conteurs
se sont tus... Bien des récits sont aujourd'hui oubliés.
Mais j'ai eu la chance d'en entendre quelques-uns encore, de la bouche
de mon père, de celle de ma grand- mère, de quelques autres
personnes de ma vaste parenté. Dont l'histoire d'Abou-Kichk.
Et dans ma retraite atlantique, parmi tous les souvenirs qui traversaient
mon esprit, c'est ce meurtre qui revenait de la manière la plus
insistante. C'est autour de lui que, peu à peu, le roman a pris
forme, autour de lui que se sont rassemblés les événements,
les lieux, les visages - tout un univers oublié reprenait lentement
sa place et ses couleurs. Un univers où l'imaginaire se nourrissait
constamment de mes souvenirs, c'est-à-dire, en fait, de la mémoire
des miens. Car si les personnages et les événements de ce
roman sont imaginaires, la plupart s'inspirent, à des degrés
divers, de personnages et d'événements réels. Ainsi,
mon père m'avait parlé un jour d'un étrange marchand
ambulant qui venait quelquefois au village, transportant à dos
de mule, au milieu d'innombrables bricoles, des ouvrages de philosophie
qu'il avait écrits et qu'il espérait vendre à quelques
lettrés du pays ; c'est ainsi qu'est né le personnage de
Nader, muletier savant, auteur d'un livre de sagesse...
À travers Le Rocher de Tanios, j'ai certainement voulu exprimer
ma nostalgie à l'égard du Liban d'autrefois. Tous ceux qui
ont connu ce pays, même pour un séjour furtif, le comprendront
aisément. Pays d'extrême douceur et d'extrême violence,
pays déroutant. Mais pays attachant, indéniablement. Pays
inoubliable, ineffaçable. J'ai préféré l'évocation
aux explications, j'ai préféré raconter une histoire
villageoise, avec ses passions, ses errances, ses dérives, avec
ses drames et ses cocasseries, plutôt que de réécrire
l'Histoire, si cruelle et si chaotique en cette contrée éprouvée.
Cependant, à travers ces hommes et ces femmes, à travers
les épisodes de leurs amours, de leurs déchirements, j'ai
voulu également transmettre un peu de ma tendresse pour cette terre,
un peu de ma nostalgie. J'espère aussi avoir transmis, au fil des
pages, ce que j'appellerais, faute d'un terme plus précis, "une
certaine connaissance intime" de cet univers méconnu, avec
les traditions et les valeurs propres qui établissent sa différence,
mais avec, aussi, ses aspects simplement humains, qui correspondent à
des passions éternelles et universelles. C'est en effet ma conviction
profonde que l'un des rôles du roman est de diffuser, dans notre
monde encore trop cloisonné, cette connaissance salutaire de l'autre
comme de soi- même. Parce qu'il raconte au lieu de prêcher.
Parce qu'il enjambe les frontières invisibles qui sont, en vérité,
les plus durables et les plus insidieuses.
Dans ce monde qui est profondément un, bien que bariolé
d'innombrables couleurs, le montagneux pays de Tanios n'est qu'une minuscule
touche, quasiment invisible à l'œil nu. Sous la loupe du voyageur,
du lecteur, il apparaît pourtant dans son infinie diversité,
tout un univers à la fois disparu et présent, fragile et
éternel, si lointain, si proche.

@John Foley/Grasset
