|
Accueil
–
Présentation
du groupe – Livres
lus –
Programme
actuel
Programmation des années précédentes – Liens – Nous contacter |
Nous
avons lu pour le 9 février 2025
Compartiment
pour dames
de Anita NAIR

| Découvrez ›NOS RÉACTIONS sur ce livre |
| DES INFOS AUTOUR DU LIVRE • Le livre • Les livres d'Anita Nair • Les traductrices • Repères biographiques • Interviews • Écrivaines indiennes |
• Le livre traduit, avec trois éditions, le livre en vo
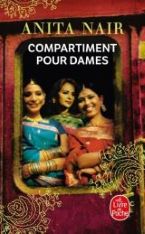 |
 |
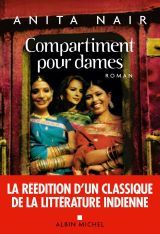 |
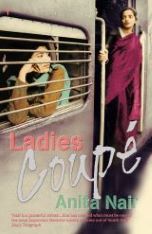 |
|
Compartiment
pour dames,
Livre de poche, 2019
|
Picquier, 2002
Picquier poche, 2004 |
Compartiment
pour dames, Albin Michel, 2016
|
Ladies Coupé,
Penguin, 2001 |
|
Traduction de l'anglais (Inde) Marielle Morin Quatrième de couverture : Akhila est employée aux impôts. Éternelle célibataire, cette quadragénaire n'a jamais été libre de mener sa vie comme elle l'entendait : toujours la fille, la sœur, la tante de quelqu'un, celle qui fait vivre la famille. Sur un coup de tête, elle prend un aller simple pour Kanyakumari, une petite ville balnéaire du sud de l'Inde. Dans l'intimité du sleeping – le fameux "compartiment pour dames" – qu'elle partage avec cinq autres compagnes, Akhila ose poser la question qui la hante depuis longtemps : une femme a-t-elle vraiment besoin d'un homme pour être heureuse et épanouie ? Compartiment pour dames est le best-seller qui a révélé Anita Nair. C’est un livre délicieux, chaleureux, qui nous ouvre le cœur de ces femmes indiennes dont nous sommes finalement proches, mais c’est aussi un texte engagé sur le sort qui leur est réservé aujourd’hui encore. |
|||
•
10 livres d'Anita Nair publiés en France
Elle a publié
des nouvelles, de la poésie, des livres pour enfants.
Voici les livres traduits en français
dans l'ordre de leur publication en Inde. Le premier traduit est celui
que nous lisons.
- Le Chat karmique
(Satyr of the Subway & Eleven Other Stories, 1997), nouvelles,
trad. Marielle Morin, Picquier, 2005 ; rééd. Picquier
poche, 2008. Épuisé.
- Un
homme meilleur (The Better Man, 2000), trad. Marielle Morin,
Picquier, 2003 ; rééd. Picquier poche, 2006. Épuisé.
Son premier roman.
- Compartiment
pour dames (Ladies Coupé, 2001), trad. Marielle
Morin, Picquier, 2002 ; rééd. Picquier poche, 2004 ; rééd.
Albin
Michel, 2016 ; rééd. Le Livre de poche, 2019.
- Les Neuf Visages du
cœur (Mistress, 2005), trad. Marielle Morin, Picquier,
2006 ; rééd. Picquier poche, 2010. Épuisé.
- L'Inconnue
de Bangalore (Cut Like Wound, 2012), trad. Dominique Vitalyos,
Albin Michel, 2013 ; rééd. Le Livre de poche, 2015.
- Quand viennent les cyclones (Lessons in Forgetting, 2010), trad. Dominique Vitalyos, Albin Michel, 2010 ; rééd. Le Livre de poche, 2013.
- Dans les jardins du Malabar (Idris: Keeper of the Light, 2014), trad. Dominique Vitalyos, Albin Michel, 2016 ; rééd. Le Livre de poche, 2019.
- L'abécédaire des sentiments (Alphabet Soup for Lovers, 2015), trad. Dominique Vitalyos, Albin Michel, 2018.
- La mangeuse de guêpes (Eating Wasps, 2018), trad. Patricia Barbe-Girault, Albin Michel, 2020.
La traductrice de Compartiment pour dames
est la première à faire connaître Anita Nair en français.
- Marielle Morin, chez Picquier : 4 livres traduits en 2002, 2003, 2005,
2006. Présentation de par Marielle Morin =>ici
ou =>là.
- Dominique Vitalyos, chez Albin Michel : 5 livres traduits en 2010, 2013, 2015, 2016, 2018. Présentation de Dominique Vitalyos =>ici et le détail de ses traductions sur son blog =>là.
- Patricia Barbe-Girault, chez Albin Michel : le
dernier livre traduit en 2020. Présentation de Patricia
Barbe-Girault =>ici
; a fait une thèse sur
Salman Rushdie ; entretien sur la traduction =>là.
•
Quelques repères sur son parcours et sa
vie à Bangladore
Formation, débuts professionnels
- Née au Kerala en 1966
- Licence en langue et littérature anglaises.
- Anita Nair voulait devenir journaliste. Elle commence par travailler
pour Aside, un magazine de Madras, mais sans réussir à
en vivre. Elle se marie à 20 ans avec son amour rencontré
à 16 ans, d'une caste inférieure, et enchaîne alors
les petites boulots comme la vente immobilière, est pigiste pour
différents magazines, travaille dans la publicité.
À vingt-cinq ans, je me suis retrouvée sans emploi. L’agence de publicité pour laquelle je travaillais a été reprise par un autre groupe et tous les anciens employés se sont sentis si mal à l’aise que la plupart d’entre nous sommes partis… Mon oncle qui vit à New York m’a invitée à séjourner chez lui et je suis donc allée à Manhattan. La plupart des gens qui voyagent ont un objectif précis : ils sont soit des touristes, soit là pour affaires ou pour rendre visite à leur famille… Je ne faisais rien. Je me contentais de me promener dans Manhattan, puis de parcourir les États-Unis, à la recherche de Dieu sait quoi, mais quand je suis revenue en Inde, j’avais déjà décidé de ce que je voulais faire. Cela a pris un certain temps, mais vers vingt-sept ans, ces mois d’introspection m’ont rappelée à l’ordre et un jour, j’ai commencé à écrire. J’ai écrit les trois premiers paragraphes de Satyr of Subway et j’ai su avec certitude que j’avais enfin trouvé une voix. (Entretien avec Vishwanath Bitee, The Criterion, 2 mars 2015)
Carrière littéraire
- Premier livre publié en 1997 : un recueil de nouvelles inspirées
pour partie de son séjour à New York, intitulé Satyr
of the Subway (Le Chat karmique),
qui lui permet de gagner une bourse pour compléter sa formation
au Virginia Center for the Creative Arts
en 1998 (scoop : ce centre américain a une antenne en France, une
coquette résidence d'artistes "Le
Moulin à nef" dans le Tarn-et-Garonne...)
- Deuxième livre et premier roman en 2000, Un
homme meilleur, publié par Penguin
India et premier livre d'un auteur indien à être publié
par Picador
USA.
- Le succès s'installe à partir de 2001 avec Compartiment
pour dames.
- Elle crée un cours d'écriture, Anita's Attic, de 12 semaines
(creative writing course & mentorship
program). On peut la voir en 2012 en vidéo =>ici.
Vie personnelle
- Elle vit à Bangalore avec son fils et son mari, Suresh Parambath,
qui travaille dans la publicité (les potins amoureux =>ici).
La grand reporter Sylvie Kauffmann la rencontre à Bangalore quelques
années après qu'a démarré son succès
(Le Monde,
25 avril 2007). Extrait :
Pour parvenir jusqu'au refuge d'Anita Nair, il faut un certain sens de l'orientation, une bonne dose d'ingéniosité et pas mal de patience. Le lotissement fermé, quasiment introuvable, dans lequel est nichée sa jolie maison jaune est une "gated community" à l'indienne, à la périphérie de Bangalore : haut portail avec gardes, piscine, quelques grosses maisons séparées par des terrains en friche. À l'extérieur, des enfants jouent pieds nus devant de petites échoppes.
La romancière Anita Nair (Un homme meilleur et Compartiment pour dames, éditions Philippe Picquier) est "tombée amoureuse de Bangalore" il y a dix-sept ans. Elle travaillait dans la publicité et arrivait de Chennai, anciennement Madras. Bangalore "était alors une petite ville charmante, nonchalante. Un peu paresseuse, les déjeuners duraient trois heures, les magasins fermaient pendant la sieste". Le charme a opéré pendant dix ans. "À Chennai, il y a la prohibition, tandis qu'à Bangalore, on va dans les pubs boire un verre, j'adorais ça." "Puis la circulation s'est intensifiée, les rues sont devenues bruyantes, on s'est mis à couper les arbres. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'éloigner." "On" : son mari et son fils, 14 ans. "Depuis trois ou quatre ans, les gens arrivent de Mumbai, de Calcutta, l'argent du high-tech coule à flots, tout le monde est pressé. Fini les déjeuners languissants !" Elle s'est éloignée, mais elle est restée. Contrairement à Mumbai ou Delhi, villes de grande culture littéraire, Bangalore n'a "ni clubs ni cliques" : elle peut s'y isoler pour écrire.
- "Le Bangalore d'Anita Nair", Émilie Grangeray,
Le Monde, 28 juin 2013 : "Originaire du Kerala (État
du sud de l'Inde), la romancière habite aujourd'hui Bangalore,
dans le Karnataka qu'elle nous fait visiter" :

Mahesh Shantaram pour
M Le magazine du Monde (portfolio
en ligne =>ici)
"C'est la ville des extrêmes. À un bout du spectre, on trouve la cité cosmopolite, moderne et dynamique, où les choses évoluent à toute vitesse."
"Le quartier de Shivaji Nagar n'aurait jamais pris pour moi la même importance si je ne m'étais pas lancée dans mon premier roman véritablement urbain, il y a trois ans de cela. Pour l'écrire, je comptais me laisser guider par la ville autant que par les personnages. J'ai donc passé quelques jours à arpenter inlassablement les petites rues de Shivaji Nagar. Mais ce sont mes balades nocturnes qui ont réellement provoqué l'étincelle créatrice. En soirée et jusque tard dans la nuit, le secteur du dépôt de bus grouille d'activité, les marchands ambulants installent leurs voiturettes au bord de la chaussée et l'énergie ambiante se réverbère dans les ruelles et les allées environnantes."
- Intéressante interview en anglais dans une librairie, 10 ans après le succès de Compartiment pour dames (Ladies Coupé), NDTV (télévision indienne), 21 décembre 2011, 6 min.
- Entretien avec Céline Laflute pour Evene.fr, octobre 2006. Extrait :
Comment expliquez-vous que vous ne fassiez aucun cas du fait d'écrire en anglais, contrairement à Arundhati Roy par exemple ?
Je suis une sorte d'anomalie parce que j'écris en anglais sur l'Inde rurale et l'Inde des banlieues. Le plus souvent, les romans écrits en anglais en Inde sont tournés vers le monde urbain. J'essaie de me servir de l'idiome local autant que possible car, dans les situations que je crée, l'anglais n'est pas souvent parlé. J'aime aussi saisir l'Inde telle qu'elle est, l'Inde dans laquelle je vis, avec le moins de nostalgie et de compassion possibles. Heureusement, la chose semble acceptée, non seulement à l'étranger, mais aussi en Inde — l'épreuve de vérité incontournable ! J'ai réalisé que bien qu'une culture soit plutôt relative à une région, la condition humaine est universelle. C'est l'écriture de qualité qui triomphe et s'élève au-dessus des différences culturelles...Lisez Amitav Ghosh, I. Allan Sealy, M. Mukundan, Kamala Das.
•
Autres écrivaines indiennes
Parmi les noms cités, Kamala Das est
une femme, poétesse, non traduite.
Arundhati Roy, mentionnée dans la question, est devenue célèbre
avec son roman Le
Dieu des Petits Riens. Elle est l'auteure aussi de
Le Ministère du Bonheur Suprême. Elle est également
militante et a écrit de nombreux essais.
La liste est ouverte, car Anita Nair est la première Indienne programmée.
Et voici NOS RÉACTIONS sur le livre
|
Les
lectrices
|
Ce
9 février 2025, nous étions 12
à avoir découvert le livre
:
• en direct (8) : Anne, Claire Bo, Felina, Laetitia,
Marie-Yasmine, Nelly, Patricia, Sophie de Paris
• en visio (1) : Agnès
• par écrit (3) : Joëlle ; sans avoir fini le livre,
livrant juste une impression : Anne, Flora.
Prises ailleurs (4) : Aurore, Claire Bi, Stéphanie, Sophie de Nice.
|
Des
irréconciables
|
•
Sont nettement négatives et ont bien failli descendre du train
: Joëlle,
Nelly.
• N'ont pas encore été conquises — on ne sait
jamais s'il y avait un coup de théâtre — et sont prêtes
à balancer dans la catégorie suivante : Anne,
Flora,
Marie-Yasmine.
• Sont définitivement mitigées, mais restent pacifistes
: Agnès,
Laetitia.
• Sont positives, voire plus, et font le voyage sans se plaindre
des cahots : Claire
Bo, Felina, Patricia,
Sophie.
|
La
succession des avis
|
Anne,
malade et n'ayant pas terminé le livre
Pour l'instant mon impression est assez mitigée.
Flora,
n'ayant pas non plus terminé le livre
J'ai lu environ la moitié du livre.
Je suis mitigée : il se laisse lire facilement, mais je ne suis
pas captivée par les différentes histoires de ces femmes.
Je ne sais pas si ça vient du sujet, de la manière dont
c'est écrit, mais je n'ai pas accroché.
Joëlle
Dans les années
70, il y avait un musicien indien très célèbre qui
s'appelait Ravi Shankar
(plus connu peut-être maintenant pour sa fille, Norah
Jones). Il avait donné un concert à Pleyel et j'étais
allée l'écouter. Le concert m'avait paru bien long et un
peu ennuyeux. Ce livre m'y a refait penser.
Je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai quand même dû me forcer.
Je n'ai pas une vocation rentrée d'ethnologue et donc, les mœurs
étranges de ces personnes, leurs codes compliqués, ça
ne me parle pas.
On est centré sur les relations homme/femme, le mariage, la famille,
sujets qui ne m'intéressent pas non plus. On parle sans arrêt
de nourriture (ce qui pourrait être sympa mais est juste obscur),
de maquillage, de bijoux, de vêtements. C'est probablement tout
ce à quoi ces pauvres femmes peuvent penser, mais de mon point
de vue c'est tout de même très limité et ça
ne fait pas un livre. Bien sûr je devrais m'apitoyer sur le sort
de ces femmes, tout m'y invite. Mais à quoi bon ?
Le compartiment du train est un prétexte pas très bien exploité
selon moi. À part un bref moment où il est fait allusion aux odeurs
et aux détritus, quelques arrêts, on pourrait aussi bien
être dans n'importe quelle pièce fermée.
Pourtant, le voyage est assez long : j'ai regardé le parcours sur
Google Maps et j'ai vu qu'en train il fallait compter une vingtaine d'heures.
Ce n'est donc pas qu'un voyage de nuit et je suis surprise que Akhila,
qui voyage pour la première fois, n'ait seulement jamais regardé
le paysage. Pourtant, vu la distance, il y aurait sûrement des changements
intéressants. Mais ce n'est pas décrit.
En outre j'ai été submergée de termes exotiques,
appelant une explication qu'on ne trouve qu'en fin de livre. C'est absolument
mal pratique, il aurait vraiment fallu mettre des notes (de bas de page
ou de fin de chapitre) mais pas ce glossaire décourageant.
Quand je lis — et ce n'est pas le pire exemple — "Tout le monde
sait qu'un Dharmavaram est un succédané du Kanchipuram"
je me demande vraiment ce que je dois en penser. Suis-je totalement inculte
et stupide ? Ou est-ce qu'on se moque de moi ?
Pour finir sur une note positive, j'ai apprécié les nombreux
changements de voix narrative, entre le narrateur omniscient, les monologues
intérieurs, les récits à la première personne,
les dialogues, ainsi que les retours en arrière : j'ai trouvé
que c'était bien construit.
Et je n'oublie pas le sentiment de petite victoire personnelle que j'ai
éprouvé à la lecture de l'ultime page. J'en étais
venue à bout. C'est un plus !
Claire
Pour ton interrogation sur "Tout le monde sait qu’un Dharmavaram
est un succédané du Kanchipuram", lis le paragraphe
précédent : on lui offre un sari et elle dit que la crème
des saris vient de Kanchipuram alors qu'on lui en refile un de Dharmavaram,
donc même une nulle en saris comme moi peut comprendre...
Felina
J'ai
beaucoup aimé le roman.
Je ne connaissais pas l'auteure.
Le livre m'a tout de suite happée par le sujet et par l'écriture,
claire, fluide et rythmée.
Je connaissais un peu la condition féminine en Inde, que je savais
vraiment pas idéale, mais ce texte m'a vraiment fait connaître
dans le détail la situation d'infériorité de la femme.
J'ai apprécié la polyphonie des voix féminines, et
comment chaque personnage représente une facette différente
des femmes indiennes, avec ses propres aspirations, ses contraintes et
ses combats.
Certaines histoires étaient plus développées que
d'autres. Et j'ai été très intéressée
par celle d'Akhila bien sûr, la protagoniste, mais aussi par celle
de Prabha Devi et sa décision de reprendre le contrôle de
sa vie en apprenant à nager et également par Margaret, qui
se venge de son mari tyrannique en le gavant de choses à manger.
Je n'ai malheureusement découvert qu'à la fin du livre,
le glossaire. Mais dès qu'il y avait un mot que je ne connaissais
pas et qui m'empêchait la compréhension du texte, j'allais
le chercher sur Internet. En particulier, j'ai cherché tous les
noms de plats à manger, ce qui a permis un véritable voyage
dans la cuisine indienne...
Les thèmes abordés, tels que la liberté, l'identité,
la famille, l'amour, la tradition et la modernité, sont universels
et invitent à la réflexion sur la place des femmes dans
toutes les sociétés, pas seulement l'Indienne.
Agnès
J'ai
pris le train avec ces dames et je suis allée jusqu'au bout du
voyage, mais sans être transportée.
Ce roman
m'a fait penser au film All
We Imagine as Light
qui met en scène des femmes indiennes et décrit leur condition,
ainsi que leurs désirs de liberté.
Le sujet du livre m'a intéressée, mais j'ai trouvé
le procédé trop répétitif — chaque femme raconte
son histoire au personnage principal qui espère y puiser une réponse
pour mener sa propre vie.
Le dernier témoignage est celui qui m'a le plus accrochée,
sans aucun doute pour la relation amoureuse entre les deux miss anglaises
et celle, sensuelle, entre la jeune femme et la riche épouse qui
l'emploie. Mais c'est aussi l'histoire la plus affreuse et la plus violente
(le viol, l'avortement non abouti, l'enfant abandonné).
Pour conclure, mon avis est mitigé.
Nelly
Tout
d'abord je dirais que je n'ai jamais eu très envie d'aller en Inde.
À la suite de témoignages de voyages, j'ai plutôt
ressenti une crainte envers ce pays, et ce livre ne m'a pas donné
plus envie de le découvrir. En parallèle de la lecture,
j'ai vu aussi le film All
We Imagine as Light où
j'ai trouvé des longueurs, des choses qui me sont étrangères,
et que je ne parviens pas à trouver intéressantes. Globalement
j'ai trouvé le film ennuyeux.
En ce qui concerne Compartiment pour dames, après avoir
lu le premier chapitre, j'étais consternée et me suis demandé
si j'irais au bout de ce livre qui m'a semblé "nunuche",
mais me suis quand même accrochée.
Je n'ai pas aimé les explications détaillées sur
des sujets matériels sans intérêt. Il n'y a pas assez
de profondeur, pas assez d'imagination.
Malgré tout, même si c'est inégal, il y a des moments
où je me suis laissé faire.
J'ai eu du mal à retenir les noms compliqués des personnages,
qui sont cependant bien dépeints. Aucun homme n'est sympathique.
(Marie-Yasmine et Claire citent
alors le mari de Janaki, Prabhakar, patient et attentionné dans
le mariage arrangé.)
J'ai réussi à sourire, à rire, avec la scène
de l'œuf, même si ce n'est sans doute pas le but recherché.
J'ai aussi eu des difficultés à retenir les histoires ;
à part Akhila qui se raconte à travers le récit des
autres femmes, il n'y a pas de fil conducteur. C'est un livre triste,
qui manque de peps et il y a des considérations très convenues
dans la manière de raconter. Je n'y ai pas vu d'humour. Même
l'histoire d'amour d'Akhila est accablante, tant elle est atténuée
par les principes et les règles à respecter.
Le style est parfois ampoulé, par exemple dans une scène
de sensualité : "Avec mes doigts, ma bouche, avec mes yeux
et mon âme, j'irriguai ce corps desséché. Je fis pleuvoir
une averse de plaisir sensuel qu'elle recueillit avec l'avidité
de celle qui est condamnée à errer pour toujours dans le
désert et a perdu tout espoir de jamais découvrir une oasis."
J'ai eu un sursaut d'intérêt au chapitre 10 avec la relation
entre deux femmes, mais c'est décevant.
J'ai dû faire encore un effort pour terminer.
Laetitia
J'ai une connaissance plutôt limitée de la littérature
indienne.
Je
me souviens avoir lu — et apprécié — en 2005 Babyji
; j'avais alors rencontré l'auteure, Abha
Dawesar.
Mon avis sur le livre Compartiment pour dames est mitigé
: le voyage m'a paru quelquefois bien long !
J'ai tout d'abord eu des craintes avec le premier chapitre : des phrases
un peu "clichés", un style pas forcément très
recherché — voire kitsch.
Et cette problématique centrale : une femme a-t-elle besoin d'un
homme pour vivre et s'épanouir ?
D'autres réserves : j'ai trouvé le procédé
du "cheminement" à la fois du train et des pensées
pas très subtil et trop systématique ; les chapitre sont
inégaux et plus ou moins intéressants ; le glossaire
: utile, mais des notes en bas de page auraient également été
bienvenues en complément.
Quelques points positifs :
- la dénonciation de la condition des femmes et de la domination
masculine ; le poids de la religion, des traditions — les règles
de la caste brahmane
- le dépaysement — à travers notamment les spécialités
culinaires !
- le roman donne une place conséquente et la parole aux femmes
- les 6 points de vue : le passage à des focalisations différentes
"casse" la monotonie, laquelle peut quelquefois s'installer
- 6 femmes, 6 personnalités différentes ; celles qui m'ont
le plus intéressée sont Margareth et la dernière
femme, Marikolanthu
- l'humour : la comparaison des personnes à des éléments
chimiques (chapitre 6).
Sophie
Je suis entrée facilement dans le livre. Il y avait beaucoup d'ingrédients
qui me donnaient envie : l'Inde (qui me fascine et me fait peur à
la fois), un récit qui se passe dans un train de nuit (j'adore),
des histoires de femmes.
Je
me suis sentie en connexion avec Akhila dès les premières
pages. J'ai été touchée par cette femme indépendante,
qui s'est sacrifiée pendant des années au profit de sa famille.
Sans mari ni enfants à 45 ans. Rêvant d'évasion et
d'espace. Avide de vie et d'expérience. Brûlant de quitter
sa carapace et d'aller à la rencontre des autres. Et qui a peut-être
laissé passer la chance en quittant son jeune amant il y a des
années.
J'ai lu le livre avec plaisir, certaines des histoires plus que d'autres,
en particulier celles de Margaret et de Marikolanthu. J'ai aimé
ces deux personnages à la psychologie complexe et évolutive.
Globalement, j'ai apprécié la façon dont l'autrice
plonge dans l'intériorité des personnages et leurs différentes
facettes.
Quelques regrets, cependant, qui n'entachent pas mon ressenti positif.
J'espérais me dépayser avec cette lecture, mais il y a assez
peu de scènes descriptives de l'Inde. J'aurais aimé aussi
plus de scènes dans le train, le compartiment. Partager avec ces
femmes la sensation du déplacement, du temps et de l'espace. Je
pensais faire un voyage au sens géographique et finalement le voyage
s'est avéré surtout psychologique.
Je me demande si la société décrite dans le livre
reflète l'Inde d'aujourd'hui. J'imagine un pays où la pauvreté
est prédominante, où la vie est dure, violente pour les
femmes. Le monde décrit par Anita Nair est globalement préservé,
un peu aseptisé.
J'aurais aimé que Akhila continue son chemin au-delà des
normes, qu'elle ne reste pas dans le schéma hétérosexuel
qui la ramène vers Harri. Que la réponse à la question
"une femme a-t-elle vraiment besoin d'un homme pour être heureuse
et épanouie" soit "pas forcément d'un homme".
Ce côté "mainstream" et hétéronormé
du livre m'a retenue tout au long de la lecture.
Patricia
J'ai bien aimé lire ce livre. J'ai trouvé l'écriture
fluide et facile. La construction m'a plu. Même s'il y a parfois
des lourdeurs, je me suis laissé emporter par les histoires de
chacune de ces femmes. Je ne me suis pas ennuyée car les différentes
histoires ne sont ni trop longues, ni trop courtes. Parfois j'ai mélangé
les noms de certains personnages, mais sans gravité par rapport
à la compréhension du livre.
D'ailleurs, je verrais bien une adaptation dans un film sous forme de
huis clos dans un train d'où l'on ne sort que par des flash-back.
Le
livre décrit d'une part le mode de vie des Indiens. D'abord l'hygiène
: ils passent leur temps à se laver corps, dents, visage, mains
; et après, les toilettes. L'alimentation dont il est beaucoup
question, sujet qui m'intéresse, est végétalienne
: aucun produit animal, même pas les vers à soie. En revanche
elle parle également souvent de compléments alimentaires
et de manger des œufs que quand on est malade. Il ne faut pas prendre
le soleil pour ne pas bronzer. Et des choses étranges comme dessiner
le kolam le plus beau
possible pour montrer que notre foyer est harmonieux.
D'autre part, et c'est le côté le plus intéressant,
de très nombreux thèmes sont abordés, comme la corruption
("pots de vin" aux impôts), la religion, les mariages
arrangés, l'inceste, le viol, l'avortement, le devenir des femmes
veuves, l'homosexualité, les règles sociales, la prostitution,
etc. ; il ne faut pas remettre en cause l'ordre social, malgré
les aberrations. Il s'agit de bourgeoises, ayant fait pour certaines des
études universitaires et qui sont d'ailleurs moins enclines à
apprendre à être une bonne épouse et une bonne mère
: c'est le cas d'Akhila, qui est quand même à la base une
rebelle (n'aime pas les kolams, préfère la culture occidentale,
mange des œufs, etc.). Mais aussi brillantes soient-elles, elles
finissent toujours sous la coupe de quelqu'un et abandonnent leurs vrais
désirs.
Le sujet de la différence de classes et du rapport maître/employé
est abordé également avec la dernière femme, qui
s'était isolée par rapport aux autres au début. Elle
paraissait avoir beaucoup vécu, plus sûre d'elle. Cela s'explique
par le fait qu'en tant que pauvre et employée de maison, elle a
subi des choses encore plus horribles, en comparaison avec les femmes
du wagon.
En Inde, comme partout avant, la femme appartient, dans l'ordre, à
son père, puis à son mari, puis lorsqu'ils ne sont plus
là, à la mère puis, si la mère n'est plus
là, à la sœur ou aux frères, ou à son
fils ou fille parfois en vieillissant, etc. Je remarque que ça
ne vient pas à l'esprit de ces femmes de s'émanciper, peut-être
par peur de la stigmatisation sociale. Il leur faut une amie qu'elles
rencontrent par hasard pour leur faire comprendre que c'est possible pour
une femme d'être seule, ou bien il faut un voyage dans le train
et rencontrer d'autres femmes avec qui parler.
On voit aussi que même si les couples sont bien ensemble, ça
n'est pas aussi bien que ça : migraines, dépressions,
cachets pour dormir, etc.
On voit que chaque femme a une histoire et se confie volontiers sans honte
aux autres. À mon avis, ça a un côté libérateur,
comme en psychanalyse. Elles savent qu'elles ne se reverront jamais.
Concernant le thème du voyage pour se retrouver, réfléchir
ou faire un bilan de sa vie, c'est un thème récurrent dans
la littérature, mais aussi dans chacune de nos vies. Ça
m'est aussi arrivé de partir seule à l'étranger (en
l'occurrence au Portugal) suite à une séparation. À
qui cela n'est pas arrivé ?...
D'ailleurs cela me fait penser au livre précédemment lu
à Lirelles Les
grandes aventurières, où on voit Isabella Bird,
écossaise, en 1831, à 40 ans, souffreteuse et vieille fille,
à qui on prescrit un voyage, retrouver la vie.
Je me suis souvenue aussi de deux autres livres sur le même thème,
lus il y a quelque temps :
• Deviens
celle que tu es de Hedwig Dohm, grand-mère de la femme
de Thomas Mann, qui raconte le réveil d'une femme vieillissante
qui cherche à retrouver son indépendance et décide
de mettre tout son argent dans les voyages contre l'avis de son fils
• Un
matin je suis partie d'une journaliste américaine, Alice
Steinbach, qui tout à coup cherche à faire un point sur
sa vie qui ne lui convient plus. Elle décide de faire un grand
voyage en train dans toute l'Europe, Paris, Londres, Rome, etc. J'ai beaucoup
aimé ce livre.
Conclusion, le voyage et les rencontres faites lors de voyages sont souvent
thérapeutiques.
J'ai pensé aussi à un livre et un film indiens évoquant
des amours entre femmes :
• Babaji
(2006), de la romancière Abha Dawesar
•
Fire
(1996), un film de Deepa Mehta : j'ai adoré !
Marie-Yasmine
qui a lu en VO Ladies
Coupé et qui a, à son habitude, concocté
quelque douceur en lien avec le livre, livre où d'ailleurs la cuisine
a une grande place — cette fois des naans : sa recette=>ici.
Mon contact avec la littérature indienne jusqu'à présent
se limitait à une
série de romans historiques et à pas mal de cuisine
et de yoga. J'avais hâte de me plonger dans le livre et d'en découvrir
plus, mais sur ce point j'ai été un peu déçue.
Le thème du train et du voyage est malheureusement un prétexte
peu développé, mais le style est agréable avec des
tournures très visuelles et de jolies métaphores. Il y a
cependant pas mal de répétitions.
Le rythme est très inégal et je m'y suis perdue. J'étais
parfois suspendue aux histoires des femmes rencontrées par l'héroïne,
regrettant qu'elles passent si vite et un peu frustrée par le survol
rapide de toute une vie ; mais le fil rouge principal sur l'héroïne
m'est souvent tombé des mains. Je n'ai pas réussi à
finir le livre à cause de ces longs moments d'ennui.
Je garde toutefois quelques pépites de cette lecture :
• Le passage où l'héroïne transgresse les règles
de sa caste en croquant dans des œufs. J'aime beaucoup le thème
des tabous alimentaires et je trouve que ce passage sert très bien
l'histoire d'émancipation de l'héroïne.
• Le passage très émouvant où la jeune fille
maquille sa grand-mère mourante parce qu'elle sait que c'est ce
qu'elle aurait voulu. Ici aussi cette histoire montre une magnifique transgression
des codes oppressants et un bel acte d'amour filial.
• Toute l'histoire de la professeure qui reprend le contrôle
sur sa vie en manipulant son mari toxique grâce à la nourriture.
Je voudrais un livre entier sur cette histoire où une femme complètement
à la merci de son mari reprend son agentivité avec les maigres
moyens à sa disposition.
Au final je ne suis pas très convaincue par cette lecture. Je ne comptais pas reprendre ma lecture, mais les révélations des autres avis de Lirelles m'ont cependant peut-être convaincue de poursuivre !
Claire
Bo
Je rejoins Felina et Patricia, tout en ayant des réserves qu'alimentent
les avis négatifs, car je suis influençable...
Mes impressions positives viennent du fait que j'ai été
continûment intéressée par l'aspect documentaire sur
l'Inde (l'histoire de l'œuf m'a paru sidérante) ; le poids
de la famille est effrayant. Les histoires, édifiantes certes,
m'ont paru plutôt palpitantes. L'enjeu du livre — l'émancipation
de chacune — ne m'a pas du tout laissée indifférente.
L'artifice — le voyage donnant lieu au récit des parcours —
a marché pour moi, tel un jeu. J'ai trouvé fluide le passage
d'une femme, puis une autre, au personnage principal, et la construction
bien fichue sur la durée, tel un meccano. La midinette toujours
présente en moi a été satisfaite à plusieurs
reprises.
Certes, il ne faut pas se lasser, car le programme est annoncé
par l'artifice déployé, et je pense que c'est l'une des
raisons qui peut causer de la déception. Il est difficile de s'attacher
aux personnages, mais cela ne m'a pas paru grave. Le risque principal
pour moi est l'aspect démonstratif : c'est un peu lourd quant aux
révélations qui adviennent, avec un petit côté
"développement personnel" : comment se trouver, etc.
Le dernier récit me semble le moins vraisemblable, par une narration
à la première personne trop chiadée pour cette femme
décalée socialement, et de plus avec un récit comportant
toutes les misères du monde, comme si l'auteure y fourguait tout
ce qu'elle n'avait pu placer.
Quelle que soit la qualité du film, j'ai été très
contente d'avoir vu en parallèle le film All
We Imagine as Light qui m'a donné des images de ces femmes,
avec un sujet similaire, réalisé par une femme indienne
en plus. J'étais plongée dans leur univers, je les voyais.
Il y a même un compartiment pour women only...
Je serais curieuse de connaître concrètement les réactions
au livre quand il est sorti en 2001 : ce fut un grand succès, d'accord,
mais qu'est-ce qui se dit alors ? Le livre appelle à une émancipation
qui semble peu évidente dans cette société sclérosée
sur bien des points.
Autant je comprends que le rythme déçoive, autant je m'étonne
qu'on ne trouve pas de fil directeur : un personnage principal (qui ne
s'intéresse pas du tout aux paysages qu'elle traverse mais à
ces femmes qui alimentent sa réflexion) et la question qui la mène.
Le côté kitch désigné par Laetitia ou l'aspect
ampoulé par Nelly me font penser au cinéma Bollywood et
ses aspects rose bonbon (je connais mal, mais j'avais apprécié
l'expo
au Musée du quai Branly).
D'Indiens, je ne connais pas la saga lue par Marie-Yasmine, ni Babyji
lu par Laetitia et Patricia. J'ai
lu quelques livres : de Salman Rushdie Haroun
et la mer des histoires, de
Rohinton Mistry
L'Équilibre du monde (grandiose !), de
Naipaul (prix Nobel) À
la courbe du fleuve et L'énigme
de l'arrivée ; et
aussi Ami
de ma jeunesse et Une
étrange et sublime adresse