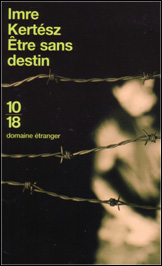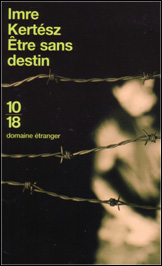
|
|
Imre Kertész
Être sans destin
Nous avons lu ce livre en janvier 2006.
Katell 
C'est difficile de parler de ce livre, mais je suis contente qu'il ait
été mis au programme du groupe. C'est un auteur majeur et
un livre majeur et j'aime quand le groupe me permet d'aller à la
découverte de grands écrivains. Je n'avais pas lu Imre Kertész
il y a deux-trois ans, lorsqu'il a eu le prix Nobel. Après Être
sans Destin, je vais lire ses autres ouvrages.
Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé l'écriture. J'aime cette
façon d'ouvrir sans cesse les guillemets pour citer les propos
exacts de ses personnages. C'est très journalistique et cela donne
à la fois une sensation de proximité (les propos sont rapportés)
et de distanciation (l'auteur/narrateur ne se les approprie pas).
J'ai été très sensible à son regard d'adolescent,
qui éprouve des sensations ou des sentiments parfois inavouables
(envers son père et sa mère), face à ses oncles ou
aux voisins.
Je me suis aussi posé la question de l'homosexualité latente
(?) avec cette façon très particulière de décrire
la beauté et le corps des hommes qu'il croise (notamment les soldats
allemands) et qui se révèle (enfin devine-t-on ?) dans
la scène du lavabo, où l'autre jeune homme devient également
" l'homme " de l'infirmier. Très souvent, on
est comme lui, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Pourquoi a-t-il
été envoyé à l'infirmerie, où malgré
la faim et la soif, ce séjour va lui permettre de passer l'hiver
44-45 et le sauver ?
Liliane,
C'est également très difficile de parler de ce livre. J'ai
freiné des quatre fers pour le lire. Je l'ai acheté avant-hier
et je l'ai terminé il y a une heure. Ce n'est pas encore assez
décanté, j'ai du mal à en parler. Et puis, c'est
un peu indécent dans le contexte d'un groupe de lecture... C'est
un livre qui m'a touchée, secouée...
Jacqueline
Moi aussi, j'ai des difficultés. Je l'avais gagné au Salon
du livre en 2003. J'étais très contente de lire Kertész
parce que je suis en recherche de livres sur la déportation. Cette
difficulté que j'éprouve à en parler tient à
beaucoup de choses : la chape de silence de ceux et celles qui en
sont revenus. Mon père a été à Dachau comme
politique (un an) et d'une certaine manière j'étais au courant
de son expérience mais il n'a rien raconté. Pour moi, dans
cette expérience des camps, il y a quelque chose de sacré.
Plus tard, j'ai lu d'autres livres, mais la chape de silence est toujours
là. J'avais trouvé Primo Levi extraordinaire mais je suis
incapable d'en citer quelque chose.
Donc, j'ai lu et je l'ai relu. Le début du livre ne me plaisait
pas : cette manière de raconter, l'expérience d'un
adolescent, ces choses sans sentiment, cette position subjective. Les
Boutiques de cannelle racontent les mêmes sentiments, cette
étrangeté, cette folie. Cela m'apparaissait pesant. Ces
phrases courtes qui reprennent ses sentiments d'enfant, pour moi, cela
faisait procédé. A partir de la rafle, j'ai été
embarquée. La chose racontée prend le pas sur le procédé.
C'est un livre de témoin, précieux, ce n'est pas de littérature...
C'est assez extraordinaire, il ne comprend rien, il est entraîné,
il est mêlé à ça, il vit ça. Il n'a
pas de jugement. Pour lui, " il faut bien faire ",
puis il apprend à tricher. C'est très touchant. A la fin,
lors de la discussion avec le journaliste, on retrouve la pensée
toute faite des gens : " C'était l'enfer... "
Cependant, à cause de cette distance, l'horreur ne passe pas. Je
recommande par exemple Le Retour de Charlotte
Delbo, qui arrive à rendre mieux le terrible de la situation.
Brigitte,
Je l'ai lu il y a deux ans. Je ne l'ai pas relu, j'écoute vos avis.
Geneviève
Quand il est sorti il y a deux ans, je n'ai pas voulu le lire. La déportation
fait partie de mon histoire familiale, de mon enfance, de mon imaginaire.
J'ai lu une tonne de bouquins sur le sujet et j'en ai ras-le-bol de la
sacralisation et de l'autopunition.
Finalement, je l'ai lu pour des raisons professionnelles. J'ai été
un peu déroutée au début, avec ce point de vue. J'ai
été fascinée par la distance et par son rapport au
temps. Comment il arrive à s'habituer à des choses insupportables.
Son retour l'a beaucoup frappé, sa rencontre avec le journaliste,
la communication impossible et ce moment où il sort de lui-même,
sa colère par rapport aux deux vieux.
En revanche, à la relecture, j'ai trouvé que la technique
à mettre des expressions comme " j'en convenais "
faisait un peu procédé. Je trouve fascinant cette impossibilité
à communiquer. On raconte cette expérience comme quelque
chose de dramatique, mais par exemple, ma mère qui l'a vécue
enfant aussi, n'évoquait pas "le drame".
Dervila
Je n'en ai lu que la moitié et pour l'instant, je l'ouvre aux ¾
pour le témoignage. J'ai trouvé ça plat et froid,
comparé par exemple à La Trêve de Primo Levi.
L'écriture m'a gênée. J'ai été gênée
d'un point de vue technique. J'ai trouvé le personnage très
énervant. Je ne peux pas comprendre qu'il n'ait pas d'émotion.
Je trouve ses réactions bizarres vis-à-vis de son père,
de sa mère, sa manie de l'ordre. Cette absence donne l'impression
qu'il est sous le choc. C'est peut-être son mérite littéraire.
C'est un témoignage très froid, mais un témoignage
complet.
Françoise O
Je n'ose mettre de qualificatif sur ce livre, sur sa construction, son
écriture. Je trouve cela déplacé, indécent.
Comme ceux qui n'ont pas pu comprendre ce qu'il tentait de faire passer
à son retour : ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas
pu entendre, ceux, dont je suis, qui n'ont pas été là-bas.
Et qui n'ont donc aucun droit à porter même l'ombre d'un
jugement. Je dis simplement "chapeau bas". Je lisais en même
temps le livre d'un auteur allemand,
Max Sebald, et j'ai trouvé une citation qui s'applique, selon
moi, à la lecture de Kertész, qui "se caractérise
par une attitude narrative qui (…) reste bienveillante jusque dans
la moquerie et ainsi (…) ne tire pas son ironie de la distance prise
par rapport au sujet, mais du rendu exact d'images vues de très
près."
Claude
J'ai lu d'autres livres sur la déportation, comme Soljenitsyne.
J'ai été surprise car c'est un jeune homme de quatorze ans,
il a l'âge de ma fille aînée. J'ai dévoré
ce livre. Au début, j'ai eu un peu de difficulté à
le lire. Il prend des distances par rapport à ce qu'il vit. Il
est très jeune et ne peut imaginer l'inimaginable. Il s'adapte,
il ne peut faire autrement. Il fait preuve d'une certaine petite fierté.
Il parle aussi des quelques joies mises en miettes : le terrain de
foot à Buchenwald, l'évocation d'un coucher de soleil, lorsqu'il
retrouve quelqu'un qui parle sa langue. Pour lui, c'est une joie. Lorsqu'il
reçoit de la nourriture, c'est une joie de manger. Il savoure son
repos à l'hôpital même s'il meurt de soif et de faim.
Monique
Je l'ai lu aussi il y a deux, trois ans et je n'ai pas pu le relire. J'en
parle sur mes souvenirs. Pour moi, c'est un grand écrivain. Pas
simplement pour le thème mais aussi par rapport à tous les
autres livres, il y a quelque chose de très particulier. J'y vois
plusieurs fils. Celui de l'expérience d'un enfant que je trouve
très difficile. Les premières pages sont capitales pour
comprendre son cheminement. Au moment de l'arrestation, ces jeunes garçons
avaient tout le temps de fuir... C'est fascinant qu'ils aient suivi sans
se poser plus de questions. On sent que c'était un enfant qui n'était
pas averti, que personne n'était là pour le protéger.
On voit aussi le travail de l'écrivain : il veut restituer
son histoire avec sa vision d'enfant.
Autre fil : je n'ai pas lu beaucoup d'autres documents où
sont évoqués la joie et le bonheur au camp de concentration.
Il égrène des grains de bonheur. Quand on ouvre ce genre
de livre, on a envie de comprendre pourquoi les humains ont été
capables de faire ça et comment d'autres humains l'ont vécu
et supporté. Tous ces gens voués à mourir et en fin
de compte, contre tout attente, le destin fait que certains ont vécu.
C'est vivifiant malgré l'horreur. Il a fait son chemin pour construire
sa vie. Le retour est désespérant : personne ne l'attend.
J'ai lu deux autres ouvrages, notamment Kaddish pour l'enfant qui ne
naîtra pas, où il évoque son refus de donner la
vie à un enfant. Kertesz est un très grand écrivain
pour sa vision humaine.
Florence
J'avais lu le livre au moment où Kertész a reçu le
Prix Nobel. Il m'avait beaucoup marquée et je m'en souviens bien.
Je l'ai en partie relu pour le groupe, ce soir.
J'ai ressenti la même stupéfaction à la deuxième
lecture, lorsque le narrateur décrit des horreurs en les qualifiant
"d'assez pénibles" ou de "bien désagréables".
Lorsqu'il annonce la rafle dont il va être victime d'un laconique :
" Le lendemain, il m'est arrivé quelque chose d'un peu
étrange. " J'éprouve véritablement de l'effroi
lorsqu'il parle de sa "joie" d'arriver au camp…
Ce narrateur qui semble ne s'émouvoir ni ne juger de rien, comme
si ce qui lui arrivait ne le concernait pas vraiment, comme s'il était
à l'extérieur de lui-même, c'est la grande réussite
du livre, je crois.
De la quasi impossibilité à raconter l'horreur des camps,
Kertész dit : "La langue est limitée…
Celui qui veut vraiment dire ce qui s'est passé à Auschwitz,
on ne le comprendra pas." Lui, réussit, non pas à
nous émouvoir, mais à nous plonger dans un état d'hébétude
horrifiée face à cette "plaisanterie, cette blague
de potaches" que fut l'invention de la solution finale. Son ironie,
scandaleuse, nous mène au plus près de la monstruosité.
Françoise D
Je partais du postulat : après avoir lu Primo Levi, il n'y
a plus rien. J'ai lu Robert
Antelme, mais ce n'est pas de la littérature.
Encore un livre sur la déportation... Mais que peut-il m'apprendre ?
Au bout de 20 pages, j'ai été accrochée par ce ton
original que je n'avais jamais lu ni entendu ailleurs, l'expérience
d'un enfant. Ce livre dépasse le stade du témoignage. C'est
un grand livre, un talent, une écriture. Il a mis quinze ans à
l'écrire, il y a longuement et mûrement réfléchi,
on le voit à la manière dont c'est écrit. J'ai trouvé
que le ton, cet understatement (euphémisme, minimisation) révèle
beaucoup de l'état d'esprit de cet enfant. Son humour, son ironie
m'ont bluffée. Je recommanderai ce livre. On peut faire de la littérature
avec la Shoah.
Liliane
Le terrain où j'aimerais m'aventurer de manière confortable...
Comme il y a de la vie dans un camp de concentration, il y a du camp de
concentration dans la vie. Dans son point de vue, j'ai toujours senti
l'adulte et ce point de vue d'adulte m'a percutée et m'a amenée
sur le terrain de ma propre vie. C'est une langue très descriptive.
Quand j'animais un atelier d'écriture, lorsque quelqu'un avait
des difficultés à aborder un sujet, le mieux, conseillais-je,
c'est de décrire ce sujet avec la langue la plus neutre possible.
Décrire au plus près permet la juste distance. C'est ce
qui va le plus loin dans la transmission. C'est ce qu'a fait Kertész.
Brigitte
J'avais besoin de faire le point, c'est un peu une seconde lecture pour
moi de vous avoir écoutés. J'ai découvert des choses.
Quand j'avais quatre ou cinq ans, j'ai croisé une femme qui revenait
des camps. Ça m'a marquée même si je n'ai rien compris
à ce qui lui était arrivé. J'avais seulement compris
que c'était important.
Pour moi, c'est l'histoire d'un enfant très respectueux :
tout se passe bien s'il reste bien obéissant. Et dans ce contexte,
il applique son mode de vie habituel. Il est opérationnel pour
aller en camp. Le monde qui est le sien, c'est un monde chaotique. Il
est habitué à subir des événements incompréhensibles
de par sa vie familiale, donc il est mieux adapté à vivre
l'incohérence du camp parce que son monde est déjà
incohérent. Il n'a pas de sentiments car c'est déjà
semblable à son monde habituel. Cette expérience est amplifiée.
Il a une manière d'aborder ce sujet : il a trouvé un chemin
pour mieux aider le lecteur à toucher cette chose qu'on ne peut
mettre en mot.
Claire
Pour moi, c'est un livre comme un autre : je l'ai lu il y a déjà
un ou deux mois et j'ai déjà tout oublié, c'est comme
pour les autres livres. Et pour me soutenir, j'ai Kertész lui-même :
"Après Auschwitz, on ne peut écrire que de la fiction
(…) comment peut-on imaginer que l'art puisse faire abstraction d'un
tel événement historique, d'une telle tragédie ?
D'un autre côté, il serait absurde d'imaginer qu'un poète
qui ressent le besoin d'écrire sur Auschwitz ne répondrait
pas aussi à une exigence esthétique. Il y a une esthétique
d'Auschwitz." (Lire, avril 2005)
Au début, j'étais assez irritée, je ressentais un
énervement devant cette sorte de naïveté, cette absence
de sentiment d'horreur. Les choses arrivent " naturellement "...
Je me suis dit pendant un bon moment : une nouvelle aurait suffi
et puis je suis entrée dans l'horreur, je n'y ai plus pensé.
Florence le trouvait autiste, je trouve qu'il ne l'est pas assez pour
nous faire passer au début - début que je trouve mal
foutu - cette inconscience. C'est un peu comme une pose, un procédé,
disent certaines. Après, cette impression est dépassée.
De Si c'est un homme, de Primo Levi, je retiens les échelles
de la souffrance : avoir faim, c'est horrible, mais il y a pire qui
fait disparaître la première, avoir froid. Là, je
me souviendrai de la possibilité de ressentir du bonheur dans cette
maltraitance systématique. A certains moments, le corps complètement
souffrant devient pour lui un objet, il n'est plus qu'une conscience.
Je me souviens d'avoir lu La Douleur de Duras, en grand partie
en pleurant. Là, c'est une tout autre lecture. Je recommanderai
ce livre, c'est un classique. Je suis certaine d'aller voir le film. Je
trouve les interviews de Kertész très intéressantes
(voir tout en bas de cette page).
Sandrine
J’ai lu Être sans destin il y a quelques années
et cette œuvre m’a laissée sans voix. Tant de films,
de livres traitant de cette tragédie ont, année après
année, émoussé la sensibilité du spectateur
ou du lecteur, qui croit tout connaître de ce drame... et pourtant...
J’ai été profondément touchée par l’immense
pudeur, le respect et la profonde humanité qui émanent d’Imre
Kertész à travers cette œuvre. Plutôt que d’inonder
le public avec des œuvres plus ou moins réussies, plus ou
moins véridiques sur le même sujet, c’est de tels témoignages
qu’on devrait parler : l’écriture est extrêmement
simple et sobre. Pas d’effets de phrases, de grandiloquence déplacée,
de commentaires « à faire pleurer dans les chaumières ».
La description nue des faits. Ni plus, ni moins. Des hommes, des femmes,
avec leurs grandeurs, leurs forces et leurs bassesses. Leur bonté
et leur mauvaiseté. La force de la survie. Une certaine honnêteté
intellectuelle aussi en évitant la facilité de l’amnésie
sur certains sujets délicats. Un récit d’une grande
dignité humaine. Cette œuvre m’a beaucoup impressionnée...
beaucoup plus que tout ce que j’avais pu lire ou entendre jusqu’à
présent sur le même sujet.
Il y a quelques mois, je n’ai pas manqué d’écouter
une interview qu’Imre Kertész donnait à la télévision
française... cet intellectuel qui se fait rare sur notre petit
écran. Cet homme était d’une impressionnante simplicité
et d’une immense profondeur. L’interview se passait à
Berlin et en langue allemande à sa demande... parce qu’il
aime cette langue qui est celle d’écrivains qu’il admire
et apprécie, disait-il les yeux pétillants d’une lumière
que ni Auschwitz, ni le régime communiste hongrois n’ont réussi
à éteindre...
Dervila (plus tard)
Mon avis s'est quelque peu modifié depuis que j'ai lu la seconde
moitié du livre. J'ai trouvé cette moitié beaucoup
mieux faite du point de vue narratif/"littéraire", et
beaucoup plus forte.
Et mes idées ont (un peu) changé aussi depuis que j'ai réfléchi
sur l'avis de Monique, en me souvenant que les garçons mûrissent
moins vite que les filles. Donc à 14 ans, un garçon peut
être un vrai enfant. Pourtant, le contraste avec Anne Frank s'impose
(sauf que nous n'avons que ses écrits d'avant sa déportation,
j'en suis consciente).
Jean-Pierre
Je vais essayer de faire court, c'est promis. Ca ne va pas être
facile car j'aurais tant de choses à dire sur ce livre. Le sujet
d'abord ne peut que m'atteindre au plus profond. Le nazisme et ses crimes,
les camps de la mort en constituent l'arrière-plan. Et c'est là
que le bât blesse, car ils sont très peu évoqués.
L'auteur a pris le parti de raconter son périple personnel en occultant
la situation générale dans laquelle il se déroule.
Dès la 4e de couverture, on est certes prévenu : "...
le mythe d'un univers concentrationnaire manichéen. "
Vous avez dit mythe ? Les premiers, les révisionnistes de
tout poil se sentiront peu touchés car ce n'est pas cette histoire
individuelle qui les convaincra davantage que les preuves matérielles
des camps, de la barbarie nazie, du génocide et de la shoah. Quant
aux seconds, ils risquent de culpabiliser d'avoir fait le tri entre les
bourreaux et les victimes, aveuglés par leur soi-disant manichéisme.
Dans ces conditions extrêmes de l'inhumanité, il faut cependant
choisir son camp, quitte à laisser de côté les pauvres
moments de sérénité que les uns et les autres ont
connu probablement, tant les heures et les minutes sont longues.
En outre, le livre fourmille de passages où les monstres sont si
gentils et les instants si heureux. C'est un comble.
Quant à la forme, le livre ne commence véritablement qu'au
départ du train pour Auschwitz. Tout le début m'a fait l'effet
d'un verbiage sans importance dans le cadre de ce récit, à
part la critique du fatalisme religieux et celle du respect de l'ordre
et de la bienséance. Et alors, le style ! c'est déprimant.
Que de redites ! que de chevilles sempiternellement répétées
: en définitive, pour ainsi dire, d'une certaine manière,
au fond, en fait, quand on y pense, somme toute...., sans parler de choses
carrément risibles comme : "tout cet évènement
a du prendre environ 3 à 4 minutes pour être précis".
C'est insupportable.
Bref, pour l'histoire dans l'Histoire, ça peut aller, mais pour
la petite histoire et l'écriture, zéro.
Claude
Puisqu'on en connaissait le thème, on pouvait imaginer un livre
oppressant et difficile. Je ne l'ai pas trouvé tel. Il n'y a pas
de pathos, c'est un livre pudique sans doute d'autant plus fort. On voit
l'évolution dans les situations, l'installation de la "vraie"
faim.... le regard qu'il porte sur le corps de son ami, le sien et on
ne peut douter de l'affreuse pente. Je l'ai lu trop rapidement, par souci
de le terminer pour ce soir, et par intérêt d'une lecture
qui a envie de se poursuivre. J'ai besoin de relire ce livre ou de vous
écouter pour remettre en place des faits, des personnages, des
situations. Je retiens d'une première lecture un grand souffle
et une grande sympathie pour cet adolescent, pas seulement de la compassion,
mais de l'admiration. Sa jeunesse, sa fraicheur, son envie de bien faire,
sa façon de tenir compte du point de vue de l'autre, son obstination,
sa faculté de voir le beau et le bien.
Lil
Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, c'est qu'il offre à
voir toutes les nuances de la nature humaine, de la plus claire à
la plus sombre. Il évite le piège du manichéisme
(tout comme Primo Levi dans Si c'est un homme) et, installe avec
ce récit linéaire, une distance essentielle tout en renforçant
l'horreur lue en transparence, derrière la banalité de la
forme. Toujours dans le même esprit, la galerie de portraits du
début est décapante. Merci aussi au talent de l'auteur de
me faire comprendre comment l'on peut aller, pas à pas, vers l'indicible,
chaque pas servant à s'adapter à la minute présente,
au vécu présent, pour ne retrouver, au bout du chemin, dans
l'horreur (que l'on n'avait jamais soupçonnée !). J'ai
été très sensible au cheminement naïf de cet
adolescent, plein de bonne volonté et qui garde cet œil nuancé
jusqu'au bout, sans jamais se plaindre. Bien sûr que le bonheur
existe au milieu du malheur, en même temps que le malheur, et c'est
ce qui donne la force de rebondir, de survivre. D'autres l'ont affirmé
(Lydie Violet, par exemple) et je souscris tout à fait à
cette idée, même si, évidemment, ce bonheur, dont
il est question dans ces situations extrêmes, doit être redéfini,
peut-être comme une halte dans le malheur. J'ai, également,
été très sensible à la notion de liberté
intérieure, cette liberté extraordinaire qui, avec la libération
de toute peur, de tout attachement, rend transparent, indifférent,
détaché, totalement libre (Etty Hillesum en parle aussi
très bien).
Nicole
Je n'ai pas pu lire cet ouvrage : je suis incapable de lire les livres
traitant des camps de concentration.
Marie-Thé
J’ouvre ce livre à moitié : lecture terrifiante.
Nous l’avons tous lu, je ne reprendrai donc pas ce long récit
douloureux et inoubliable. Me vient en tête ce « Was ?
du willst noch leben ? » (Comment ? tu veux vivre
encore ?), ou l’incompréhension devant un corps réduit
à l’état de déchet, d’où une voix
balbutie : « Je... Pro... teste... » et ne
veut pas mourir. Puis ce passage parmi tant d’autres : « Je
voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration. »
Le corps n’est pour ainsi dire plus, mais la vie et le désir
d’y vivre, y sont, intacts. Je pense aussi à ce moment où
l’auteur se débarrasse de Bandi Citrom comme d’un fardeau.
Ce dernier l’aura « porté » jusqu’aux
limites du possible. La vie n’est-elle pas ainsi ? On peut être
aidé, porté, jusqu'à un certain point, il faut à
un moment lâcher la main, et finir seul le chemin... Seulement ici,
le soutien était devenu « fardeau ». A méditer
aussi, les « pas » : « Tout le monde
avançait pas à pas, tant que c’était possible... ».
Et le fait qu’ "il n’y a pas de sang différent...
Il y a seulement des situations données et les nouvelles possibilités
qu’elles renferment...", "Ce n’était pas mon
destin, mais c’est moi qui l’ai vécu jusqu’au bout...".
Et ceci, qui me fait encore et toujours réfléchir :
"Il m’est impossible de n’être ni vainqueur
ni vaincu... De n’être ni la cause ni la conséquence
de rien... Je ne pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir n’être
qu’un innocent." Qu’en pensez-vous ? Enfin quand
j’ai lu la dernière page où l’auteur parle de
sa "vie invivable", puis du bonheur qui le guette
"comme un piège incontournable", et de ce "quelque
chose qui ressemblait au bonheur"dans les camps ; quand
j’ai refermé le livre, j’ai pensé à ces
mots de Vladimir Jankélévitch : "Ce qui
a été ne peut pas ne pas avoir été".
Par moment j’ai pensé à Hannah Arendt parlant de ces
moments douloureux de l’histoire, quelquefois encore à J R
Tolkien, etc.
Martine
Au départ, une irritation, rien qu’à voir l’illustration
de couverture avec les barbelés : « Encore un témoignage
sur la déportation !... » Et puis, très
vite, ce sentiment a été gommé par plusieurs atouts
du livre. D’abord, le personnage, sans jugement au plus près
du ressenti d’un adolescent au fil des expériences mais garde
son regard « distancié ». Comment va la vie,
celle de la conscience dans ce temps arrêté de l’enfermement
et de la persécution ? Que faire avec un ado d’une telle
candeur, prêt à coopérer au début ?...
Une part du suspense repose d’ailleurs sur les questions que je me
suis posées quant à l’évolution du ressenti
du jeune homme. Drôle de posture pour l’individu qui raconte
et se raconte ainsi, avec une étrange neutralité. Et puis,
de m’interroger sur le singulier (et non pas le pluriel) choisi ici
pour l’ « Être » (titre), car, de
se vivre ainsi par l’écriture et la conscience, unique et
en même temps entraîné dans une aventure de masse (notamment
dans les moments de confusion), n’est-ce pas cela un « dédoublement »
qui fait que l’on dépasse le témoignage ? Il n’y
a qu’à la fin, lors du terrible retour non attendu, que j’ai
réalisé à quel point il y avait eu un travail sur
l’expression, ou la retenue des émotions pour l’écrivain.
Ensuite, deuxième atout du livre pour moi : La langue, même
s’il s’agit d’une œuvre traduite du hongrois, une
écriture au service de cette forme de psychologie, comme si écrire
était un travail sur la vision du monde ou quelque chose comme
ça (première personne et style indirect ; déictiques...).
J’ai eu comme l’impression que je n’avais pas forcement
une place de lecteur, que le récit se déroulait comme pour
aider le récitant à se débrouiller lui-même
avec son vécu, à s’observer, plus encore que pour s’adresser
à un public quelconque. Ça m’a un peu rappelé
Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne.
Enfin, les problématiques philosophiques sous-jacentes au récit :
la question du bonheur et de ses conditions, celle du destin et du hasard,
de la fragilité de la vie donnée ou reprise, ainsi que celle
du bien et du mal... Pourquoi l’un ou l’autre se retrouvent-ils
qui dans la file de gauche, qui dans celle de droite... J’ai repensé,
à propos du « bonheur des camps de concentration »
(car c’est faux qu’on s’habitue) à la thèse
du Nirvana au-delà du désespoir. Sinon, que reste-t-il de
l’homme limité à son instinct de survie ? (Autre
ouvrage Un si fragile vernis d’humanité). Comment aurais-je
composé moi-même avec l’inacceptable ? Cette question
m’est possible dans ce livre, alors que la claque et la distance
sont si énormes et brutaux dans d’autres témoignages
que je ne pouvais aller avec ceux-ci jusqu’à cette question.
Lona
Ce roman a été écrit 30 ans après les faits
vécus. Je l’ai lu comme un récit d’un adolescent.
En voyant la couverture du livre et le titre, j’ai imaginé
une histoire de vie, derrière les barbelés d’un camp
de concentration, avec toutes les exactions possibles et déjà
décrites. Car dès les premières pages l’histoire
semble toute tracée : une famille juive, dont le père
partant au STO, confie son entreprise, sa famille, ses biens à
son employé. On devine qu’il ne reviendra pas et sera spolié...
Mais l’histoire ne sera pas seulement celle là ! Ce livre
écrit l’histoire de la déportation d’un garçon
de 15 ans, m’a impressionné par la précision des
détails de la vie dans les camps : l’organisation des
détenus, les rituels qui rythment le journalier, les actes barbares
pour l’exemple (pendaisons), les stratégies de survie, les
alliances, les amitiés, la philosophie de la liberté. Trente
années plus tard, rien ne semble avoir été oublié :
aucun détail, aucun nom, aucune odeur, aucune couleur, aucune sensation
de froid, de faim, de peur. Ce jeune a été interné
pendant un an (j’allais dire « seulement un an »).
Pourtant en lisant ce récit, j’aurais pu penser que cette
tranche de vie portait sur des années et des années. Comment
a-t-il fait pour se souvenir de tous ces détails 30 ans après ?
Comment fait-on pour se remémorer avec autant de précisions
et continuer à vivre avec le poids de ces souvenirs ? Comment
fait-on pour que cette charge devienne, à un certain moment salvatrice
et constructive, sans tomber dans le mélo, sans être maso ?
Comment peut-on parler de liberté dans un camp d’extermination ?
La liberté serait donc avant tout intellectuelle et non pas physique ?
Cette forme de liberté permettrait donc de se construire une carapace,
vivre une vie intérieure, se détacher de la réalité,
toucher le fond de la déchéance et rebondir, guérir
ses plaies et s’inscrire dans le futur, rester gestionnaire de ses
pensées et de ses rêves ? L’écriture ne
m’a jamais parue misérabiliste, ni pleurnicharde. C’est
un récit uniforme, très détaché. J’y
trouve une certaine banalité, un détachement dans la retranscription
des faits d’horreur et de malheur, une résignation, j’allais
presque dire une sérénité, voire, une espèce
de paix – je n’ose pas dire une espèce de bonheur !
Ce livre m’a semblé plein de dignité. Il n’est
ni agressif, ni rempli de haine, même si la haine est exprimée,
à son retour comme une haine thérapeutique qui a sa place
et son utilité dans sa reconstruction. Mais je reste convaincue
que sa vraie thérapie sera la parole : malheureusement à
son retour, il est seul, sans aide, sans argent, les gens de son entourage
ne le comprennent pas, car restant eux-mêmes scotchés dans
leur propre histoire de gens opprimés. L’auteur ressent douloureusement
sa solitude, l’incompréhension, l’apathie des autres.
L’écriture sera sa vraie thérapie. Tout comme Primo
Lévi (qui avait 25 ans à son internement). Je retiens ces
phrases, que je pense être des phrases-clé du livre :
« S’il y a un destin, la liberté n’est pas
possible. Si la liberté existe, alors il n’y a pas de destin.
Nous sommes nous-mêmes le destin ». Tout serait donc
« écrit » dès le départ ?
Ou alors est-on soit soi même responsable de son destin ? Le
destin, serait l’ornière, le chemin tout tracé, où
il y aurait un vainqueur/un vaincu, un innocent/un coupable ! Pour
moi c’est un livre plein d’espoir et de liberté. Il fallait
pouvoir écrire un livre sur la liberté en retraçant
la vie quotidienne d’un camp de concentration.
Extrait d'une interview de Kertész :
S'agissant de la Shoah, il est impossible d'écrire sans blesser,
parce qu'on en transmet le poids sur les épaules du lecteur. Il
faut que les mots aient un effet, au sens de "Wirkung", qu'ils
entrent dans la chair. En même temps il y a là un paradoxe.
Le roman qu'on est en train d'écrire doit "plaire" au
sens où le lecteur doit vouloir tourner la page. C'est un piège
dans lequel on l'attire pour qu'il soit réceptif. Si je suis trop
cruel ou odieux, je ne peux pas obtenir ce que je veux.
Mais c'est une réflexion que je me fais a posteriori. Il est évident
que je n'avais pas ça en tête quand j'ai écrit Être
sans destin. Pas du tout. Ce qui m'obsédait, c'était
d'éviter la pose littéraire. Je pensais à la toile
de tente qui couvrait les tables des librairies hongroises - une
toile grossière où étaient posés les livres
que l'on pouvait acheter par cinq ou par dix pour quelques forints seulement.
Je voulais retrouver le grain brut de cette étoffe, quelque chose
de fruste comme dans certains romans populaires ou policiers. Pour cela,
il fallait faire passer les détails au premier plan : devant
un gradé en uniforme, mon narrateur ne pense qu'au pou qui le démange.
C'était aussi une manière de montrer l'impossibilité
d'écrire avec des moyens rationnels sur ce monde-là.
Votre appréhension de la musique n'exerce-t-elle pas aussi une
influence sur la manière dont vous avez reconstruit la langue ?
C'est exact. J'en écoute toujours avant d'écrire. En ce
moment, je suis avec Haydn et Mozart. A l'époque d'Être
sans destin, j'étais hanté par la musique atonale :
Berg, Schoenberg... De la même façon, j'ai voulu créer
une langue atonale. L'atonalité, c'est l'annulation du consensus.
Plus de ré majeur ou de mi bémol mineur. La tonalité
est abolie, comme les valeurs de la société. La basse continue
elle aussi est détruite, ce qui signifie que le sol (pas la note,
mais le sol sur lequel vous marchez) n'est plus fixe et que disparaît
ce socle de références qui donnaient un fondement à
l'action. Des notions comme honneur ou bonheur deviennent risibles. Tout
est en mouvement, rien n'est certain. Du point de vue de la langue, voilà
ce que je pense avoir créé dans Être sans destin.
Après, j'ai continué à jouer avec ces trouvailles.
Dans Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, la perspective n'est
pas aussi aliénée : c'est un homme qui parle, quelqu'un
qui est au clair avec les lois de la vie et qui n'a commis qu'une erreur,
tomber amoureux.
Comment vous situez-vous par rapport aux auteurs qui ont décrit
l'univers concentrationnaire ?
Je hais la peinture des horreurs. Ce qui m'intéresse, c'est la
distance. La langue est limitée et ses limites sont infranchissables.
Il faut donc les briser de l'intérieur. J'admire les auteurs qui
réussissent à travailler avec les moyens de la littérature
pour dépasser les frontières du dicible. Récemment,
j'ai relu La Douleur, de Marguerite Duras : rien de spectaculaire
et pourtant tout est exprimé de ce que Duras appelle le " désordre
phénoménal de la pensée et du sentiment ".
On voit cette femme qui retrouve son mari rescapé du camp. On le
voit lui : " Dans ses pantalons, ses jambes flottent comme
des béquilles. " (…)
D'où vous vient cette distance sarcastique, cet apparent détachement
qui est la marque de tous vos livres ?
J'ai été très influencé par Camus. Pour moi,
le grand exemple de cette " distance " dont vous parlez,
c'est L'Étranger. J'avais 25 ans lorsque je suis tombé
sur ce petit livre. Je me suis dit qu'il était si mince qu'il ne
devait pas coûter trop cher. J'ignorais tout de son auteur et j'étais
loin de soupçonner que sa prose allait me marquer à ce point,
pendant des années. En hongrois, L'Étranger était
traduit par " L'Indifférent ". Indifférent
au sens de détaché - détaché du monde,
détaché de lui-même. Mais aussi au sens d'affranchi,
c'est-à-dire d'homme libre.
(Le Monde du 10 juin 2005)
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|