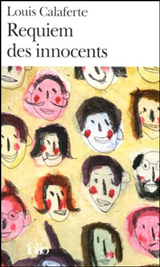
Requiem des innocents, Louis Calaferte, Folio, 224 p.
Quatrième de couverture : Ce livre
n'est pas un roman. Ici, nulle place pour l'imagination. La zone d'une grande
ville, des baraques, le terrain vague, les cris, les coups, la crasse, l'alcool,
la sexualité, la brutalité et l'ignorance, la perversité,
les jeux cruels des enfants désœuvrés, tout est vrai.
Vrai, aussi, le personnage du maître d'école, cherchant à
leur donner le goût et l'ambition de la dignité humaine. "Je
n'ignore point, dit l'auteur, que ces pages n'ont de valeur qu'en
vertu de l'émotion qui, si toutefois j'y réussis, doit sourdre
de cette succession de scènes, de faits, tous réels que j'ai
dépeints."
Salué comme une révélation en 1952, Requiem des
innocents est le premier livre de Louis Calaferte. Il garde aujourd'hui
toute sa virulence et demeure un des grands cris de révolte contre
la misère et l'injustice du monde moderne. |
|
Louis Calaferte (1928-1994)
Requiem des innocents (1952)
Nous avons lu ce livre en juin 2010.
Le nouveau groupe l'a lu 12 ans plus tard, en décembre
2022.
Manuel 
Je remercie Rozenn d'avoir proposé ce livre. Oui c'est plombant,
certains épisodes sont épouvantables (la mort d'un chien)
mais ce livre vous prend aux tripes ! Les personnages ont des gueules,
ils sont très bien campés, on les voit. Des descriptions
sont magnifiques comme celles de ciels. L'auteur a le sens de la formule,
il tombe juste. J'ai aimé la construction du livre, avec ses différents
flashbacks. Il y a d'ailleurs une incohérence à la fin du
livre : Roméo ne peut pas avoir connu Lobe. On mélange
un peu tous les personnages. Je me suis dit que ce n'était pas
vraiment important. L'amitié du directeur m'a beaucoup touché
même si c'est un peu téléphoné. J'ai beaucoup
pensé à ce qu'on a dit sur Florence
Aubenas et comment son livre serait perçu dans 40 ans... Le
monde de Calaferte n'existe plus. Parfois, je me suis demandé si
ce n'était un bon bouquin de gare car le but de l'auteur est d'emmener
le lecteur. Parfois le langage est sarkosien.
Jacqueline
Il n'y a aucun cliché...
Manuel
Le lupanar dans le wagon : on y est ! J'ai eu beaucoup de mal
à lire le meurtre du chien... Faut s'accrocher ! En fait j'aime
ce livre pour l'écriture, le style efficace.
Françoise O 
Je ne peux pas dire que j'aime un livre pour le style ou la construction.
Je l'ai en partie lu il y a deux mois et d'habitude je relis pour le groupe
de lecture, mais là je n'ai pu aller qu'au deux tiers. J'ai avancé
pour voir s'il y avait de l'espoir et je tombe sur l'épisode du
viol de la petite fille qui se termine par "c'est ça ?"
là je n'ai pas pu continuer... Je mets un quart pour ce qu'a dit
Manu. Un quart aussi parce que le livre m'a rendue malade et enfin un
quart pour le mal qu'il m'a fait.
Jacqueline
J'ai commencé sans connaître l'auteur. Je croyais que c'était
un roman étranger traduit. J'ai eu un peur du titre et j'ai lu
auparavant des nouvelles un peu kafkaïennes, un peu surréalistes,
très prenantes, un peu philosophiques. Et je lis Requiem
que je n'arrive pas à prendre au premier degré. Au début,
il n'y a pas une once de tendresse, ce qui me déplaît profondément.
Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. La manière dont c'est
écrit ne me plait pas. Il parle de son père, la haine et
la violence sont invraisemblables. Le personnage de Lobe est bien. Je
ne trouve pas Calaferte très sympathique. J'avais une amie dont
les parents avaient vécu dans la zone. Ça m'a rappelé
des souvenirs.
Françoise D
J'avais lu La
Mécanique des femmes que je n'avais pas appréciée.
C'est un livre érotique : genre que je n'aime pas. Ce livre
ne lui ressemble pas. Ce livre m'a insupportée. Il m'a fait penser
à Céline et à Genet... Mais en moins bien. La descente
aux enfers : c'est trop. Du coup, il n'y a pas d'espoir. Il en rajoute
et c'est répétitif ! Il y a Lobe qui est comme une
parenthèse et quelques pages agréables à lire. C'est
autobiographique. Je l'ouvre un quart pour la partie spécifique.
Il y a une espèce de complaisance et du coup, je ne le conseillerai
à personne ! Je reconnais qu'il y a une écriture. De
temps en temps, on passe de l'apnée à quelques moments où
l'on respire. Ce n'est pas possible que tout soit aussi noir, il n'y a
pas d'entre aide entre ces gens.
Claire
Je me sens assez proche de Manuel. Le meurtre du chien est bien plus terrible
que le viol !... J'ai mélangé tous les personnages.
Je ne les ai pas identifiés : c'est gênant. Il nous
donne à comprendre la violence. Même si c'est daté,
ça peut très bien être une bande d'aujourd'hui. J'ai
été sensible à l'écriture qui n'est pas affectée.
Le mélange du style avec toutes ces horreurs : c'est réussi.
Parfois, c'est complaisant : le viol. Est-ce qu'il y a le sentiment
du crime ? Le livre donne à voir l'immoralité de l'intérieur.
Françoise D
Ils savent ce qu'ils font, il y a la volonté de faire du mal, il
y a du sadisme.
Claire
Il n'y a aucune remise en question, aucune condamnation. C'est ce qui
est choquant. Entre l'adulte qui écrit et l'enfant, il n'y a pas
de recul. Le passage de Lobe est magnifique. La relation aux parents est
vraiment gratinée.
La zone : je ne vois pas où c'est. Où est la ville
par rapport à la zone ? Je ne me représente pas l'école
ni les intérieurs. Il y a des passages marrants : l'épisode
des poux par exemple ! Je n'ai pas vu la construction. Il y a l'histoire
du directeur abominable : quand un livre parle d'école ça
me plait... On peut comprendre la difficulté des enseignants...
Je n'ai pas trop de sympathie pour le narrateur. C'est assez répétitif.
C'est un drôle de livre, je me sens partagée parce qu'il
met mal à l'aise. Mais il vaut la lecture !
Les avis du nouveau
groupe parisien
réuni le 2 décembre 2002
Laure (avis
transmis) (avis
transmis)
J'ai trouvé le livre intéressant mais je ne sais quoi en
dire. Il est bon d'avoir cette perception d'un monde qui nous est étranger.
On constate et après ? Un roman dans la mouvance de Le
seigneur des porcheries de Egolf. Il fait part de la misère,
de la crasse et de la violence d'un milieu ouvrier qui vit l'instant sans
espérer le futur. Un homme d'âge mûr conte un passé,
son passé. Il s'appelle Calaferte.
Monique (avis
transmis) (avis
transmis)
Comment imaginer qu'un tel livre soit le récit d'une expérience
vécue au début du 20e siècle dans la banlieue de
Lyon, dans ces baraques qui longeaient les fortifs, lot de toutes les
grandes villes de l'époque. Livre vérité, livre terrible
où la misère s'infiltre jusque dans la peau, la chair, l'esprit
des personnes qui ont vécu cette vie sordide. C'est épouvantable
de noirceur, de perversité, de brutalité, de rancœur
envers le monde ; c'est à peine croyable que des êtres humains
aient pu subir de telles épreuves, y aient réagi avec une
violence quasi animale, oublieux de leur condition humaine. J'ai eu beaucoup
de mal à avancer dans le récit, je pensais à la justesse
du combat de l'abbé Pierre, je me demandais jusqu'où cela
pouvait aller. Tout sonne tellement juste, la crasse, les poux, l'alcool,
la promiscuité, la saleté à l'intérieur des
baraques, la boue et les détritus dehors, le désœuvrement
des adolescents abandonnés à eux-mêmes, petits caïds
aux jeux cruels à l'égard des plus faibles… L'enfouissement
de Blaise dans le sable et l'assassinat de la mère de Vittorio
par son propre fils encouragé par la bande sont particulièrement
éprouvants. Actes fous de détraqués, détraqués
par le malheur, l'impuissance, le sentiment confus de l'anormalité,
de l'injustice de leur condition, que leur ignorance, leur inculture pousse
aux pires excès. François me faisait remarquer avec justesse
que le style ressemble à celui de Céline, il y a en effet
chez Céline, cette noirceur, cette révolte, ces emportements.
François parle aussi de cette étrange lumière qui
émerge de ce récit, comme dans les tableaux du Caravage,
je pense aussi à Francis Bacon qui porte en lui et à travers
son œuvre une sorte de déchirure, analogue à celle
qu'il perçoit du monde. L'acmé du récit me semble
être l'assassinat du chien, cette lapidation où l'homme et
le chien se suicident mutuellement par le même sentiment d'abandon,
de souffrance, d'identique et effroyable solitude. La lecture de ce livre
est une épreuve, certains passages sont insoutenables, il est cependant
admirable que Calaferte ait mis au jour une telle réalité,
que nous sachions que cela a existé et que la fluidité de
son écriture, la richesse de son vocabulaire et des expressions
qu'il utilise aient su le restituer avec autant de réalisme et
de justesse. J'ouvre aux trois-quarts
Nathalie (avis
transmis) (avis
transmis)
J'ai bien aimé ce récit qui tout en m'emportant dans les
années 50, dans la "zone", m'a traduit et fait toucher
du doigt une réalité actuelle de certaines cités
de nos banlieues. Ce qui prédominait alors était l'alcool
alors qu'aujourd'hui on ne parle que de drogue. L'alcool n'a certes pas
disparu, mais plus dans les mêmes proportions. Sinon la ressemblance
est frappante dans le ressenti et les actes de cette jeunesse misérable.
Du moins à première vue. Car l'âge de Calferte et
de ses camarades avant qu'ils n'aillent finalement à l'école
me semble plutôt tourner autour de 10 ans. Il s'agit d'"enfants",
de "gosses", abandonnés de la société.
Bien qu'alors l'instruction soit obligatoire de 6 à 13 ans, à
l'évidence, ils n'allaient pourtant pas à l'école
puisque n'est qu'après le crime de Calaferte et de Schborn contre
Blaise, le "crétin", "l'idiot", cet "innocent",
qu'il sera procédé à leur "embrigadement scolaire".
Donc la comparaison entre hier et aujourd'hui est à l'avantage
d'aujourd'hui, incontestablement. Cependant, Calaferte nous fait comprendre
les incidences du dégoût qu'ils éprouvaient face à
leur vie. Schborn dira plus tard "Devant
toute cette saloperie de zone, on avait envie d'être plus dégueulasse
encore". Calaferte indique que "nous
n'allons découvrir qu'une échappatoire logique : afin de
nous dégager des monstres qui nous entourent, nous allons faire
appel à ce qu'il y a de plus monstrueux en nous. Seul un acte déroutant,
criminel, qui nous surpassera, pourra nous délivrer de ce mal…
ainsi nous aurons l'impression de faire un pas vers notre liberté
future." C'est grâce à cet acte horrible
que Calaferte devra aller à l'école où il obtiendra
son certificat d'études (il sera le seul de la bande) et rencontrera
surtout ce directeur d'école qui lui ouvrira un autre monde et
lui permettra sans doute de devenir l'écrivain que nous lisons.
Ce roman me permet de mieux analyser les actes de délinquance d'une
certaine jeunesse d'aujourd'hui. J'ai pensé en le lisant à
La
zone du dehors de Damasio, notamment sur l'énergie physique
de ses personnages, et sur les lieux appelés "la zone".
Cet auteur est une belle découverte et j'ai envie de lire d'autres
des romans de Calaferte comme Septentrion.
François 
Un texte autobiographique si j'en crois la quatrième
de couverture qui précise qu'il ne s'agit pas d'un roman. Le détail
a son importance. Tellement l'histoire tient du calvaire. C'est un peu
celle d'un "Christ anar" qui se déroule dans ce "lotissement
d'apocalypse" qu'on appelait autrefois la zone, située aux
abords des grandes villes aux pieds des fortifs. Actualité de Calaferte
qui de ces no man lands fait déjà un lieu de vérité
tragique. Ces terrains vagues sont pour reprendre les mots d'un fripier
qui y tient boutique le lieu d'un écrabouillage sans fin d'où
surgit parfois comme dans les tableaux du Caravage une étrange
lumière. Comment survivre à une telle horreur ? même
si l'histoire nous a appris qu'elle peut être (et reste) sans limite.
De cette horreur Calaferte écrivain unique et inclassable a fait
son miel en suivant le chemin, qui va pour un reprendre un calembour usé,
des maux aux mots. Inutile de rappeler les épisodes qui jalonnent
cette descente dans l'enfer des grandes friches urbaines. L'innocence
se perd durement sur les tas de charbon. Et le récit de Calaferte
serait sans doute littéralement insupportable si à la monstruosité
des faits, il n'opposait je ne sais quelle puissance du rêve, de
l'imagination et de l'écriture. On peut aussi penser au cinéma
et à Fellini quand il évoque la furieuse bacchanales du
dimanche à laquelle les enfants assistent comme des "petits
spectateurs prématurément endurcis à l'inconcevable".
À cette histoire qui a aussi de rares moments de grâce Calaferte
parvient à donner un relief inoubliable. On reste pantois devant
certains épisodes où il fait lui-même figure de bourreau
et de victime. Je pense à l'agonie du chien qu'il lapide et devient
la victime expiatoire d'une honte impossible à laver... "Je
ne peux dire que des mots. Je dis : c'était la zone, c'était
l'enfer." À l'intérieur de cette zone Calaferte
nous entraîne sans illusion dans les recoins les plus improbables.
Mais rien n'est anecdotique et il faudrait entrer dans les détails
du récit pour montrer que c'est de l'humanité tout entière
qu'il tente de parler. "Moi,
aussi, j'avais un rêve. Nous avions tous notre rêve. Le même.
Rêve universel des pauvres qui cherchent à émerger
du chaos." Finalement c'est à Pasolini, qu'il nous
ferait le plus penser s'il fallait absolument lui trouver des ressemblances.
Jean-Paul
L'auteur nous fait pénétrer au cœur des années
1950 dans un bidonville de la banlieue de Lyon où il a grandi.
C'est son histoire qu'il déroule devant nous où il était
parmi les invisibles, les oubliés de ceux qu'on rejette à
la périphérie des villes pour fermer les yeux sur la pauvreté.
Il n'y a pas dans ce monde de règles où seule règne
la loi du plus fort d'une société qui fixe elle-même
ses codes. L'auteur décrit de manière forte ce ghetto qui
survit dans l'alcool, la baise, les rixes, les larcins c'est à
la fois sordide, cruel et parfois amusant. Cruel lorsque l'auteur et celui
qui est considéré comme le meneur Schborn enterrent vivant
l'un de leur compagnon d'infortune "faible
et pleurnichard" juste la tête dépassant.
Ces deux complices l'écoutant gémir et pleurer conscients
malgré eux de leur acte et de leur crime restant soudés
dans le froid. Amusant comme l'essayage par l'auteur du pantalon dans
la boutique du "petit juif" rempli de fripes et de vermine,
ce cadeau de sa mère une nouveauté pour ses copains d'infortune
qui provoque malgré tout une amitié renforcée avec
Schborn à qui il propose de le porter un jour sur deux. Nous ne
pouvons rester indemne de la lecture de cet ouvrage, de son interpellation
qui nous bouscule et nous faisant prendre conscience que 70 ans après
l'écriture de ce livre rien n'a profondément changé
dans notre société actuelle. L'auteur ressuscite à
travers ce Requiem le souvenir de ses camarades d'infortune qu'il évoque
morts ou vivants ("vos
dépouilles sont en moi lourdes et vivantes") dans
un texte puissant servi par une écriture rapide et de phrases courtes.
J'ouvre ce livre en grand.
Margot 
Calaferte précise qu'il ne s'agit pas de roman mais d'un récit
authentique, réel, vrai. Alors, me suis-je demandé, comment
va-t-il faire démarrer son récit et où et comment
va-t-il le terminer ? Comment va-t-il découper le réel qui
contrairement à la fiction n'a ni début ni fin ? Par l'espace,
ou plus exactement les espaces qui se succèdent que nous traversons
et dans lesquels nous déambulons. À chacun de ces espaces
va coïncider un ou une série de personnages. Et va ainsi se
succéder une galerie de portraits et de situations qui ne sont
pas vraiment répétitives mais arrivent en boucles, avec
des rituels (ici la baston et l'alcool) quand dans d'autres groupes sociaux
ce serait les déjeuners, les soupers, les concerts, et l'église.
Or le premier de ces espaces est un "ailleurs" très emblématique
d'un imaginaire, et du symbolique plutôt que du réel : le
bout du monde. "Ça
commence au bout du monde". Et par n'importe lequel :
le bout du monde d'un juif allemand qui parle du Christ écrabouillé
à l'improbable résurrection. Ce qui n'est pas sans faire
penser à la légende (inversée ici par Calaferte)
du Juif errant (condamné à vivre éternellement jusqu'au
retour du ressuscité le jour de la fin du monde, légende
inventée par les Bénédictins au XIIe siècle).
Avec la figure du Juif, nous voilà donc de plain-pied dans l'errance,
à une misère sans fin, et sous la plume de Calaferte, privé
même de la rémission et de la rédemption de la résurrection,
c'est-à-dire sans salut du tout. Voilà qui nous fait entrer
de plain-pied dans le réel. Il s'agit bien d'un requiem : la plupart
des personnages dont il est question sont déjà morts. Et
ce bout du monde est celui de la mémoire de ces morts, de cette
fange, de cette vie crasseuse des bidonvilles des années d'après-guerre.
Une misère dont on ne sort pas même quand on en sort, avec
un langage de pauvre qu'on ne finit jamais de perdre. Bref, dès
le départ, pas d'autre issu pour les gueux d'ici que de ne jamais
connaître de rédemption, si pauvres et miséreux qu'ils
en sont réduits à partager le même espace urbain qu'un
juif allemand. En 52, voilà un personnage peu anodin qui ouvre
le bal, un damné qui a survécu à la fin programmée
de son espèce lors de la Seconde Guerre mondiale. Le récit
décline donc une misère sans fin, et articule chacun des
personnages à des espaces successifs : le magasin dépotoir
du juif allemand, l'école avec un directeur manchot qui se trimballe
sa putain chérie et flanque des beignes à tour de main baguée,
les deux bistrots, la rue et un semblant d'élargissement urbain
avec les mauvais coups tramés, puis les cabanes, ou tôles
ou taudis dans lesquels s'entassent chaque famille. Deux règles
d'or organisent et les espaces traversés et les personnages : ne
pas réussir car réussir c'est trahir, taper à bras
raccourcis sur le plus faible pour se délester de la violence qui
écrase chacun. Que Calaferte le veuille ou non, son récit
est un roman, construit comme un roman, qui puise sa vérité
dans les veines de l'auteur certes mais qui est très composé.
Démarrant "au bout du monde" et dans l'antre d'une crasse
épaisse, il se finit dans un hangar d'hygiène, repeint en
blanc qui comble de l'ironie vendra aux gueux des lavabos et de bidets
qui ne serviront à rien puisque le bidonville n'est pas urbanisé.
Le roman est tout ce cheminement vers un mot, peint en devanture, et dont
les trois premières lettres ne sont déchiffrables par personne.
Excepté le directeur de l'école. Roman encore dans la construction
du temps : composé à l'imparfait, le temps par excellence
du roman, tous les différents membres de cette vie pullulante,
sont morts et se ramassent dans le corps de l'auteur-narrateur. L'auteur
est le cimetière de tous ceux qui n'ont pas duré et ont
tressé son enfance, le cimetière d'une misère rasée.
"Vos dépouilles
sont en moi, lourdes et vivantes." écrit-il. Il
est le dépositaire de la faim, des coups, du froid qui rend soumis,
souriant et veule, et qui "conduit
à tout accepter de tout le monde." A noter également
que ce récit est sans couleurs. Comme une écriture en noir
et blanc. Roman magistral, à lire en grand et à mettre en
toutes les mains.
Julien
J'ai lu le livre : un maillage de scènes de vie si dense qu'il
est difficile de se laisser porter par les descriptions et les petits
moments qui font l'animation du ghetto. L'action a du mal à s'installer
et trop entrecoupée d'anecdotes qui ne servent pas le récit.
Quelques passages restent marquants notamment celui des deux tenanciers
de bars voisins qui tiennent les ardoises des personnes du quartier. J'ouvre
ce livre à moitié.
Anne 
J'ai pas mal aimé ce livre. Sa force, certes liée à
sa violence, est parfois sidérante, toutefois l'humour qui circule
au début m'a permis, plus loin, de le poursuivre et de m'y ancrer
malgré la terrible tempête de cruauté qui le remplace.
Toutes les scènes de sadisme, traiter les autres comme on se sent
traité : violenté, humilié, avec la faim, la crasse
extrême, se sentir au fond d'un trou, oublié du monde, où
même la police ne s'attarde pas, laissant des actes horribles entre
"camarades" impunis, coupent le souffle (ce monde existe à
côté de chez soi ou de chez Swann…). Sans doute Calaferte
nous montre ce que deviennent les hommes quand la vie n'a aucun sens et
que l'on a faim, froid, que l'on s'encroute dans la saleté. Que
deviendraient de tels individus dans une guerre qui n'aurait pas de sens
pour eux ? Des tueurs de Boutcha ? Pourquoi les jeunes enterrent-ils un
camarade jusqu'au cou en l'y laissant la nuit mourir de froid ? Cela
semble un acte gratuit, mais est-ce la seule possibilité de montrer
la façon dont ils se sentent traités ? Mourir comme
un vers de terre, frigorifié, impuissant, comme on l'est dans le
ghetto ? Ce texte montre que pour survivre, mentalement, physiquement,
il faut développer la loi du plus fort, et que là, peuvent
se développer des liens de loyauté. Dépasser l'anéantissement
permet de s'estimer, de partager la misère et les quelques joies
dont elle est parfois composée, comme de faire un concours de crachas
ou de voler à son propre père les vêtements de sa
boutique pour les lui revendre ensuite... Beaucoup d'anecdotes montrent
aussi la tendresse cachée envers des personnages divers du Ghetto,
ou de l'espace "convivial" du lieu malgré sa sordidité,
sa crasse. Tout cela laisse ensuite d'immenses nostalgies devant le vide
de leurs absences, quand plus tard, rien de tel n'est venu les remplacer.
J'ai remarqué dans mon métier de psy combien les enfants
mal traités par leurs parents tiennent à eux et leur sont
plus souvent loyaux qu'on ne peut l'imaginer, même si consciemment
ils ont des pensées de haine à leur égard. Au fond,
dans de telles situations, comment s'infiltrent les sentiments de culpabilité
inhérents aux fonctionnements du psychisme ? Ici l'histoire ne
le dit pas car les liens entre les camarades sont sans cesse actés,
jamais pensés, et ce qu'introduira la société "d'ailleurs",
quand elle va s'en mêler, ne sera pas un regard empathique, mais
une action hygiénique ! C'est là-dessus que s'achève
le livre… On installe des waters !!! Sans que personne n'ait d'ailleurs
les équipements pour les introduire chez eux. L'hygiène
est un paradoxe dans cet univers et démantèle le précaire
équilibre de ce lieu, sans rien apporter en profondeur à
ces abandonnés. J'ai apprécié ce premier livre malgré
les quelques pages que, vers la fin, j'ai passées, trouvant longues
les répétitions de toutes ces horreurs humaines désespérantes,
qui deviennent anecdotiques car n'entrant pas dans un projet plus construit
(mais je pense que Calaferte a voulu ce jaillissement de la parole et
ce texte bouleversé, cette série d'actes qui ne deviennent
jamais à proprement parler action romanesque). Je l'ouvre au trois-quarts
avec l'envie d'aller voir d'autres livres de celui qui a su faire d'un
livre court, un livre fort. Fort, comme l'avait été le livre
intitulé Le
Gone du Chaâba d'Azouz Begag qui avait écrit en 1986
sur les bidonvilles de Lyon, et montré la dépression des
individus quand ils ont été séparés de leurs
espaces et relogés dans des HLM.
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
     |
|
à
la folie
grand ouvert
|
beaucoup
¾ ouvert
|
moyennement
à moitié
|
un
peu
ouvert ¼
|
pas
du tout
fermé !
|
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|









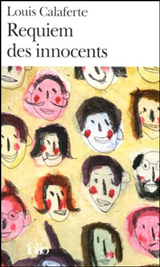
![]() Nous écrire
Nous écrire