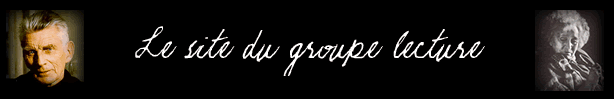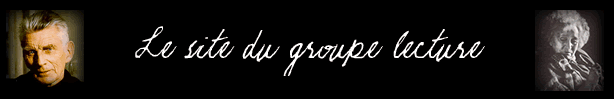|
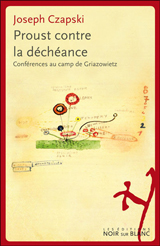 Les
Editions Les
Editions
Noir Sur Blanc
Quatrième de couverture :
« Cet essai sur Proust fut dicté l'hiver 1940-1941 dans
un froid réfectoire de notre camp de prisonniers à Criazowietz,
en URSS. Le manque de précision, le subjectivisme de ces pages
s'explique en partie par le fait que je ne possédais aucune bibliothèque,
aucun livre concernant mon thème. Ce n'est pas un essai littéraire
dans le vrai sens du mot, plutôt des souvenirs sur une oeuvre à
laquelle je devais beaucoup et que je n'étais pas sûr de
revoir encore dans ma vie. Dans une petite salle bondée, chacun
de nous parlait de ce dont il se souvenait le mieux. Je vois encore mes
camarades entassés sous les portraits de Marx, Engels et Lénine.
Je pensais alors avec émotion à Proust, dans sa chambre
surchauffée, aux murs de liège, qui serait bien étonné
et touché peut-être de savoir que vingt ans après
sa mort des prisonniers polonais, après une journée entière
passée dans la neige et le froid, écoutaient avec un intérêt
intense l'histoire de la duchesse de Guermantes, la mort de Bergotte et
tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde de découvertes
psychologiques précieuses et de beauté littéraire. »
Joseph Czapski (extrait de l'introduction, 1944)
Né à Prague en 1896, Joseph Czapski passa
son enfance en Biélorussie. Il étudia le droit à
Saint-Pétersbourg puis la peinture aux Beaux-Arts de Cracovie.
Czapski fut parmi les rares officiers de l'armée polonaise qui
échappèrent au massacre de Katyn en 1940. Son livre Souvenirs
de Starobielsk retrace ses efforts pour faire connaître la vérité
à propos de ce crime.
Comme peintre, Czapski fut le principal animateur du mouvement kapiste,
pendant son séjour à Paris (1924-1933). Après la
guerre, il vécut en exil à Maisons-Laffitte, où il
collabora au mensuel polonais Kultura. Il y est mort en 1993.
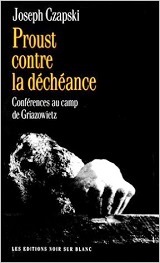
Quatrième de couverture :
Septembre 1939 : la Pologne est envahie, à l'Ouest par les
Allemands, à l'Est par les Russes. Parmi des milliers d'officiers
polonais, Joseph Czapski est emprisonné en Union Soviétique.
Face à la rigueur du camp, il décide de ne pas sombrer dans
la détresse. Il trouve dans l'œuvre de Marcel Proust le réconfort
nécessaire et choisit de le faire partager à ses codétenus.
C'est là l'objet de ce livre étonnant, illustré par
des dessins réalisés par l'auteur, au camp-même de
Griazowietz, et où nous découvrons un Proust différent.
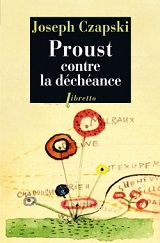 Editions
Libretto (2012) Editions
Libretto (2012)
Quatrième de couverture : Proust contre
la déchéance n’est pas un essai de plus sur la vie
et l’œuvre de celui qui écrivit pour la première
fois un roman-fleuve à la française. Non, ce livre est plutôt
celui qui a contribué à sauver quatre cents officiers polonais
lors de leur internement en Russie au début de la Seconde Guerre
mondiale. On peut légitimement se poser la question de savoir comment
une conférence sur Proust a pu sauver la vie de prisonniers de
guerre. La réponse tient en quelques mots : elle leur a permis
de s’échapper d’un quotidien qui, sans l’aide de
ces abstractions intellectuelles impressionnantes de mémoire et
de talent, aurait été insupportable…
|
|
Joseph Czapski
Proust contre la déchéance : conférences
au camp de Griazowietz
Nous avons lu ce livre en mars 2011.
Renée (avis transmis)
J'avais la ferme intention de venir ; mais comme dit Chirac, "les
emmerdes volent en escadrilles". Je suis pas Chiva quand même !
Alors j'ai lu le livre très vite, sans pouvoir en goûter
toute la densité. Et je l'ai trouvé passionnant. La prison,
la maison de liège, l’étouffement, le délice
de relier Proust avec ses environs littéraires et artistiques.
J'aime aussi le feu discret de ses peintures, les couleurs familières,
"sans pathos ni falbala", comme dit Jil Silberstein dans son
livre consacré à Joseph C. On pense à Primo Levi
et Dante à Auschwitz, Semprun et Goethe à Buchenwald et
il y eut Katyn. Entre les murs de liège, la mémoire. J'ai
retenu ça : "Que pouvons-nous savoir sinon que la
seule voie est la descente patiente, indépendante et désintéressée
au sein de nos sensations".
Monique
J'ai beaucoup aimé Proust contre la déchéance
de Joseph Czapski :
- pour l'éclairage sur l'expérience humaine de ces
hommes qui dans des conditions de vie extrêmement difficiles trouvent
le désir et l'énergie de veiller pour s'écouter,
apprendre aux autres ou des autres afin de conserver leur mémoire,
leurs capacités intellectuelles et lutter ainsi contre l'effort
que font d'autres hommes pour les détruire. Ils se trouvent qu'ici,
ils utilisent dans leur combat de résistance : la culture.
Comme cela fait du bien aujourd'hui en France, où la culture est
tellement malmenée (anecdote de La Princesse de Clèves)
par nos politiques et par la suprématie actuelle de l'économique
dans les médias et les loisirs ;
- pour la qualité de la conférence : la mémoire
du conférencier déjà, et puis la qualité de
son analyse. Tout cela sans notes, sans livres. Je ne sais pas quel effet
peut avoir cette conférence sur ceux qui n'ont pas lu Proust. Est-ce
que cela leur donne en vie de se lancer dans l'œuvre ? En ce
qui me concerne, j'ai eu un grand plaisir à revisiter La recherche
du temps perdu, en déambulant au gré des souvenirs de
l'auteur, des passages qui l'avaient le plus marqués, qui ne sont
pas toujours les miens. J'avais l'impression de me promener dans un jardin
connu, en prenant des chemins de traverse, des sentiers, et de redécouvrir
certains arbres, certains bosquets sous un autre angle, plus intimiste.
Parfois loin, parfois proche, des cours de Tadié.
Ce livre nous donne accès à une lecture de Proust, une grande
leçon sans discours sur l'importance de la littérature dans
la vie humaine, et fait un peu écho (soyons modestes) à
nos rendez-vous du vendredi soir. Pour tout cela, je l'ouvre en grand.
Jacqueline
L’article
du Monde m’avait donné envie de le lire. Je me
suis demandé comment lire ce livre : est-ce un livre d’introduction
à Proust, avec certaines naïvetés ? C’est
intéressant car avec une telle œuvre, tellement longue, chacun
a sa manière de la lire, c’est tellement riche, on est tellement
impliqué que ça rend la lecture de chacun singulière.
Est-ce un livre sur Proust ou sur Czapski ? Cette rencontre autour
de la culture, on la connaît (prison, camp). Au départ, j’ai
peut-être été gênée. Le titre du Monde,
"La duchesse de Guermantes au goulag", m’avait fait imaginer
autre chose : . Le goulag c’est la Sibérie, il était
dans un camp de travail, il avait du papier. C’est le récit
d’un camp de prisonniers. Quand il évoque la mort de Bergotte,
j’ai été vraiment touchée ; jusque là
sa lecture de Proust me gênait par une espèce de simplification,
à la manière des manuels de ma jeunesse, Lagarde et Michard
ou les fascicules Larousse. Quand il raconte la situation de Proust, de
son époque, il y a des jugements rapides sur Proust érudit
et la jeunesse ignorante.
Claire
Alors, qu’est-ce que tu penses de ce livre ?
Jacqueline
Je ne sais pas bien, il m’a fait réfléchir. Je l’aime
bien, ce que je lui reproche, je pourrais me le reprocher à moi-même.
J’ai envie de le remercier. Il me donne envie de (re)lire Proust.
Françoise D. 
Il y a deux choses dans ce livre :
1- le projet : Une conférence sur Proust dans des
conditions extrêmes, qui force l’admiration. La citation très
fidèle de certains passages, donc une mémoire étonnante.
Ce qui confirme la nécessité d’une activité
intellectuelle qui sauve, ce qu’on savait déjà depuis
Jorge Semprun, Primo Levi, etc. De plus, avoir choisi Proust est extrêmement
intéressant car on ne peut imaginer deux univers plus opposés,
aux antipodes, le monde de Proust et celui de ces prisonniers, mais en
même temps il y a une résonance avec l’enfermement.
Ce qui prouve que la littérature n’a pas de frontières,
horizontale ou verticale. Ce contraste est précisément ce
qui peut apporter le plus à cet auditoire ; c’est une
autre dimension, c’est l’évasion. Mais il y a aussi :
2- le contenu : il y a des passages très justes, émouvants,
mais sur la longueur, je n’ai pas été emballée,
l’homme est admirable, mais pas son écriture. Certes, ce n’est
pas un projet littéraire, c’est un texte destiné à
être dit, que la censure exige pour donner son feu vert à
la conférence. Mais il est de fait que je n’ai pas eu un réel
plaisir de lecture. Heureusement que c’était un livre court,
sinon je crois que je ne serais pas allée jusqu’au bout.
Annick A
J’avais très envie de le lire. Je suis fascinée par
les capacités des personnes dans ces conditions. Ce côté
de l’humain me séduit beaucoup. Moi aussi j’avais pensé
à des conditions plus dures. Je suis admirative sur l’exploit
de parler de Proust sans rien, sans livre, sans note. Oui ce n’est
pas une œuvre littéraire. Ce français est un français
sans en être un. J’ai eu un plaisir de lecture. J’ai La
recherche...en un énorme volume sur ma table de nuit, que je
lis depuis des années. Je n’ai pas lu de livre critique de
Proust. Le pont constant entre vie et œuvre est bien discuté ;
ça m’a moins intéressée quand il reprend les
personnages. Ce qu’il appelle le labeur littéraire où
Proust s’enferme dans sa création littéraire est un
moment que j’aime. Il y a l’épisode des pavés
où une illumination lui fait comprendre l’œuvre à
venir d’un coup. Proust n’était pas engagé ;
il n’y a aucun jugement sur ses personnages, il ne dit pas quoi en
penser. La réflexion philosophique sur la mort est intéressante.
Jacqueline
Tu dis qu’il n’est pas engagé politiquement, mais il
parle de Dreyfus.
Annick
Non, il campe les antidreyfusards, sans se prononcer. Czapski dit que
Proust parle à travers Bergotte. Il est sorti du monde snob pour
s’enfermer ; ce serait décidé par quelqu’un
d’autre - dieu - ce qui m’a frappée, c’est
la dimension métaphysique de cet enfermement pour son œuvre.
Françoise
Il y avait aussi sa maladie très invalidante et qui allait en s’aggravant.
Annick
J’ai beaucoup aimé ce livre.
Claire 
Je suis allée à la Guadeloupe où j’ai commencé
Purge :
infernal ! Alors je l’ai laissé tomber et j’ai entrepris
celui-ci : un délice !! Oui, il y a l’arrière-plan,
mais on passe très vite. Vous savez ce que sont les cartes heuristiques ?
C’est une technique de figuration de la pensée (mind mapping)
qui permet – en couleur – de prendre des notes, de
se souvenir, d’organiser la pensée complexe : ça
sert pour tout dans la vie. Comme les magnifiques schémas – en
couleur – reproduits dans le livre dont l’auteur s’est
servi l’ont aidé à faire ses conférences. Par
exemple, il situe les auteurs les uns par rapport aux autres. J’ai
beaucoup aimé. Je n’ai jamais lu La Recherche en entier,
mais c’est comme si, car j’ai lu le résumé, non
je plaisante, je l’ai étudié, à la fac, il y
a 30 ans, j’avais adoré, j’étais amoureuse du
prof, j’avais fait un exposé sur la mémoire liée
à la sensation – les pavés, la madeleine, les
réminiscences... Avec ce livre dont au sujet de quoi que je cause,
j’ai découvert une approche très différente
de la mienne. La précision est incroyable, la vie de Proust, les
mouvements artistiques, etc. C’est d’une finesse extraordinaire.
Il cite Goethe, Conrad, c’est complètement personnel ;
je ne suis pas d’accord avec Jacqueline : rien à voir
avec Lagarde et Michard ! Que j’aime au demeurant... Je trouve
contrairement à Françoise que c’est une œuvre
littéraire, l’écriture est savoureuse. Je suis très
enthousiaste.
Manuel
Ce livre est un bijou et la preuve qu'on peut raconter La Recherche.
Raconter et surtout donner envie de partir à l'aventure de la lecture
du chef d'œuvre de Proust. J'aime ces livres sans prétention
qui dégagent une passion, un amour pour des œuvres en particulier.
Nous avions lu ici Pennac et son Comme un roman ou le Guy Scarpeta
et son Age d'or du roman. Ce Proust contre la déchéance
fait partie de ces livres que j'affectionne car ils ne sont pas un essai
critique mais la volonté de faire partager et connaître une
œuvre. Et puis il y a le contexte absolument incroyable de ces cours
donnés dans un camp. Cette volonté de faire face à
la barbarie et de résister. Rien que pour ça, ce livre est
indispensable.
Voici le bel article qui nous a décidés sans hésiter
à choisir le livre :
LA DUCHESSE DE GUERMANTES AU GOULAG
Certains livres
sont beaucoup plus grands qu'eux-mêmes - infiniment plus, en
tout cas, que les pages censées les contenir. Ceux-là, bien
après qu'on les a fermés, se déploient dans l'esprit
du lecteur comme des substances radioactives. De leurs mots, des situations
ou des pensées qu'ils décrivent, naissent toute une série
d'images qui forment un autre livre caché, parallèle au
premier. Un ouvrage étrange, discontinu, mais transportable partout,
même où l'on va sans bagages - dans un camp de prisonniers,
par exemple.
Tel fut le destin
de l'œuvre de Proust dans la tête d'un lecteur exceptionnel
nommé Joseph Czapski. Issu de l'aristocratie polonaise, ce peintre
né en 1896 avait commencé A la recherche du temps perdu
dès 1925. En français, cela va sans dire. Mobilisé
au début de la seconde guerre mondiale, il fut capturé par
les Soviétiques et interné au camp de Griazowietz, en URSS.
Là, dans cet ancien couvent à moitié bombardé,
400 officiers et soldats polonais se livraient à des travaux harassants,
dans un froid sibérien. Or, parmi ces militaires faméliques,
qui réchappèrent par miracle du massacre de Katyn, certains
avaient imaginé de faire profiter les autres de leurs connaissances
d'avant-guerre. "Dans une petite salle bondée de camarades,
raconte Czapski, chacun de nous parlait de ce dont il se souvenait le
mieux."
Pour Czapski, ce
furent des conférences sur la peinture et la littérature
française, parmi lesquelles un cours sur Proust. Exempté
des tâches les plus rudes, le professeur improvisé n'avait
d'autre corvée, se souvient-il, que d'éplucher les pommes
de terre et de nettoyer le grand escalier du couvent. "J'étais
libre", constate-t-il. Libre de raconter à ses codétenus,
entassés sous les portraits de Marx et de Lénine en plein
cœur de l'hiver 1941, "l'histoire de la duchesse de Guermantes,
la mort de Bergotte et tout ce dont je pouvais me souvenir de ce monde
de découvertes psychologiques précieuses et de beauté
littéraire".
Préparés
sans le moindre document, ces cours ont d'abord été conçus
sous forme de notes, puis retranscrits directement en français.
C'est ce texte, illustré par plusieurs fac-similés des croquis
originaux, qui reparaît aujourd'hui.
Dans une langue
merveilleuse, inventive, dont les incorrections mêmes sont remplies
de grâce, Czapski déroule non seulement des scènes
entières de la Recherche, des épisodes de la vie de Proust,
des analyses éblouissantes sur le processus de création,
mais aussi tout le paysage littéraire, artistique et philosophique
"où trempent les racines de la sensibilité créatrice
de Proust".
Le livre qui en
résulte (Proust contre la déchéance, Noir
sur Blanc, 93 p., 16 €) est stupéfiant. D'abord parce que
l'on imagine ces captifs évoquant un autre prisonnier, Proust,
enfermé dans sa chambre surchauffée tapissée de liège.
Mais surtout parce que la mémoire, thème central de la Recherche,
trouve ici une concrétisation saisissante, même si l'auteur
s'excuse humblement de commettre quelques erreurs ou approximations. Si
bien que le texte de Czapski devient, à son tour, cette chose arborescente,
vivante, qui "travaille" dans l'esprit du lecteur longtemps
après qu'il a fini de lire : un grand livre, et la preuve
que la littérature peut sauver.
Raphaëlle Rérolle
Le
Monde des Livres, 3 février 2011
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|