|

Folio,
édition en un volume, 992 p.,
trad. du russe par Henri Mongault,
précédé de Dostoïevski et le parricide
par Sigmund Freud. Première parution en 1935, nouvelle
édition en un volume en 1994
Quatrième
de couverture :
Dmitri, Ivan et Alexeï, trois êtres que tout sépare,
partagent un même père, et avec lui une honte indicible :
honte de l’origine, de la naissance… Honte d’exister, qui
précipite Dimitri dans l’alcool et les excès de son
père et assigne Ivan à une résignation désabusée.
Alors que la propagation de l’athéisme plonge le peuple russe
dans un doute existentiel, Fiodor Pavlovich, le père de la fratrie,
incarne ce désarroi d’une dévotion en souffrance d’idole.
Condamné à une existence au second degré, il s’affirme
comme une parodie de lui-même. La disparition de Dieu n’a balayé
ni la peine ni la culpabilité, mais laissé insatiable la
faim d’être pardonné : faute de rédemption, Fiodor
mène l’existence dérisoire d’un bouffon et ne
récolte que la haine de ses fils. Seul le cadet Alexeï ouvre,
confiant, le chemin vers une existence vivable, en opposant au règne
généralisé de la honte la ferveur de l’homme
simple.
Exprimant les craintes ineffables qui nous agitent,
Dostoïevski trouve une ultime consolation dans la fièvre des
mots échangés et l’ivresse dangereuse des aveux murmurés.
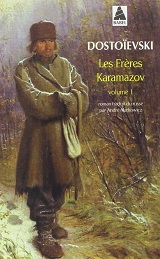
Babel, vol. 1,
600 p.
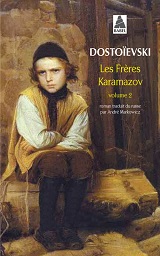
Babel,
vol. 2,
816 p.
Quatrième
de couverture :
Il y a le père, Fiodor Pavlovich, riche,
malhonnête et débauché, et ses trois fils légitimes
: Mitia, impulsif, orgueilleux, sauvage ; Yvan, intellectuel, raffiné,
intransigeant ; Aliocha, sincère, pieux, naïf. Et puis il
y a le fils illégitime, Smerdiakov, libertin cynique vivant en
serviteur chez son père. L’un d’eux sera parricide.
Roman complet et flamboyant, Les Frères
Karamazov rassemble une intrigue policière, plusieurs histoires
d’amour, des exposés théologiques et métaphysiques
éblouissants et des personnages inoubliables déchirés
par leurs conflits intérieurs. Sans doute le chef-d’œuvre
de Dostoïevski.
Avec cette publication se conclut également
l’immense entreprise de retraduction des romans de Dostoïevski
entamée il y a plus de dix ans par André Markowicz.
|
|
Fédor Dostoïevski (1821-1881)
Les Frères Karamazov (1880)
Le nouveau groupe parisien a lu ce livre
pour le 24 avril 2020.
Nous avions lu auparavant L'Idiot pendant
l'été 1988, Une Femme douce en 1994, Le Rêve
d'un homme ridicule en 1995, Carnets
du sous-sol en 2011, et nous lirons en 2022 Le
Joueur.
Laura (internaute
qui rejoindra Voix au chapitre plus tard) (internaute
qui rejoindra Voix au chapitre plus tard)
Bon, évidemment, je n’ai pas eu le temps de terminer l’ouvrage…
Je l’ai en 4 tomes chez moi (vieille édition) et je suis bientôt
à la moitié du troisième. Il faut avouer que j’ai
craqué pour Le Château de Kafka juste avant, alors
j’ai perdu plus d’une semaine, mais ce n’est pas bien grave,
j’imagine que je peux toujours donner mon avis !
On ressent Dostoïevski dans toute sa puissance. Certaines pages (un
grand nombre) sont époustouflantes. Comment être précise ?
Les personnages, bien que caricaturaux par moments (je pense à
Dmitri et Groutchenka particulièrement) ne font que montrer la
réalité dans toute sa vérité. Le roman vit,
les personnages existent. Dès que j’ouvre le livre, je ressens
un sentiment étrange, un soupir de joie et de souffrance mêlées.
Cela me rappelle la réplique d’Hiroshima mon amour :
"tu me tues, tu me fais
du bien". C’est exactement ça. Au fond, on
aime la souffrance, notre propre souffrance, mais aussi la souffrance
des autres, on en jouit. C’est d’ailleurs l’idée
que l’auteur prend presque pour leitmotiv de son roman, répétée
à plusieurs reprises. Je souffre à chaque page, et pourtant
je veux continuer à lire, je ne sais pas comment j’accueillerai
la fin. Je n’ai même pas encore l’idée d’une
possible existence d’une fin dans mon esprit. Je ne veux pas que
ce roman s’achève, après tout il est un accompagnateur
de confinement.
Tout cela n’empêche que je trouve certains passages un peu
longs. Je pense à l’enchaînement des livres sur le caractère
infernal de Dmitri, il est bien infernal, Dmitri est un démon à
mes yeux, fourbe. Bien que fascinée, j’en suis presque fatiguée.
Et j’en viens à me dire : quand apprendra t-il de la
vie ? Quand changera-t-il ? Pourtant je sais qu’il ne changera
pas… Je suis peut-être un peu frustrée dans mon âme
romantique. Mais après tout, il ne siérait jamais à
Dmitri de partir en Sibérie labourer les champs ; et son amour
pour Groutchenka ne peut vivre que dans l’idée qu’elle
ne lui appartient pas. Il y aurait encore beaucoup d’autres choses
à dire, mais je vais m’arrêter là. Grand ouvert.
Valérie
Je dois d'abord dire que je ne parlerai que du premier
volume traduit par André Markowicz, puisque malheureusement
je n'ai pas le second. Et finalement c'est une bonne chose, car je ne
crois pas que j'aurais plaisir à lire le second, même avec
ma volonté tenace de me dire qu'on doit toujours finir ce qu'on
a commencé.
J'ai lu pour la première fois Les frères Karamazov alors
que j'étais étudiante et débordais d'enthousiasme
pour la lecture de la littérature classique russe.
Je m'aperçois avec un certain regret qu'aujourd'hui cette relecture
n'a pas du tout la même saveur.
Tout d'abord, je ne trouve pas passionnants les échanges entre
les différents protagonistes, tout est très théâtralisé
à l'extrême – je pense notamment à la scène
avec les deux femmes qui aiment nos Karamazov. J'ai été
beaucoup gênée par cette grandiloquence verbale, ces caresses
de mains qui n'aboutissent à rien.
Le personnage d'Aliocha reste mon préféré, on sent
chez lui des vraies préoccupations existentielles, psychologiques
et autres, tout au long du premier tome. Ce pourquoi finalement on crie
au chef-d'œuvre.
J'avoue que les considérations spirituelles et religieuses à
presque tous les chapitres m'ont ennuyée. J'avais lu sur Babelio
que le chapitre nommé "Le grand Inquisiteur" valait à
lui seul la lecture de ce livre. C'est donc avec énormément
d'attente et d'espoir et de concentration que j'ai entamé le chapitre.
J'ai eu peine à le terminer et il m'en reste peu de souvenirs,
sinon une longue logorrhée dont on attend impatiemment le point
final et on feuillette avec angoisse le nombre de pages qu'il reste à
lire.
Je suis réellement déçue par ce premier tome et cela
suscite beaucoup de questions. À ce jour, je pense que je lirai
le second tome pour chasser cette désagréable sensation.
J'ai sur mon bureau, à l'école, une photographie de Tolstoï
et le souvenir qui date pourtant de plus de 25 ans de la visite de son
domaine à Iasnaïa Poliana. J'ai toujours aujourd'hui, l'envie
tenace de relire ou lire ses livres.
Peut-être alors que j'ai confondu dans ma mémoire ces deux
grands auteurs russes et qu'au final lire Dostoïevski à 18
ans n'avait été qu'un pensum. J'ai encore le souvenir lumineux
aujourd'hui de la lecture de Résurrection
de Tolstoï. Peut-être ceci explique cela.
Je suis néanmoins heureuse d'avoir relu Les frères Karamazov
même si ce fut une lecture difficile. Je l'ouvre donc au quart.
François
Difficile en cette période de confinement d'échapper à
la force entraînante de ce roman qui tombe vraiment bien. Peu à
peu, la lecture s'est imposée comme la seule possible, presque
à l'exclusive de toute autre. Comme une chance aussi, tellement
elle nous oblige à prendre du recul.
Dostoïevski m'accompagne de loin en loin, et depuis très longtemps,
mais cette lecture qui dure depuis des semaines a pris le pas sur les
autres. Même si (concession aux réfractaires... ?),
il faut reconnaître que la lecture des Karamazov n'est pas
toujours facile ; son écriture hyper foisonnante peut être
parfois déconcertante.
C'est que, comme beaucoup de ses personnages, Dostoïevski paraît
animé par une volonté de tout dire, de ne rien oublier qui
pourrait nuire à la connaissance des faits.
Détail révélateur : si le récit prend
souvent l'apparence d'une chronique judiciaire, il faudra à l'auteur
des centaines de pages pour en venir au procès. Mais des centaines
de pages qui vont nous permettre de prendre la mesure de son génie
visionnaire, pour peu qu'on accepte de le suivre et de s'abandonner à
son lyrisme tous azimuts.
De cette force qui emporte tout sur son passage, que retenir ? La
relation du vieux Karamazov avec ses fils, mais aussi et surtout la personnalité
de chacun d'eux : les portraits sont inoubliables et faits pour mettre
en valeur les conflits qui les habitent et s'enracinent profondément
dans l'histoire familiale, mais aussi dans une Russie en pleine crise
morale, religieuse et politique. Autant que leurs désirs paroxystiques,
c'est la question religieuse qui est au centre du roman. Ce n'est pas
un hasard si le narrateur fait d'Aliocha (un cousin germain de l'Idiot...)
le personnage essentiel du roman. Au déchaînement des passions,
c'est lui qui oppose – même s'il ne renie pas le sang
des Karamazov – une tolérance et une compréhension
dont le modèle se trouve dans les Évangiles et la figure
du Christ.
Mais aucun des frères ne manque d'une certaine grandeur à
la mesure des forces qui les dressent les uns contre les autres. L'athéisme
flamboyant d'Ivan nous transporte aussi. Et ce n'est pas sans une certaine
jubilation qu'on relit le passage de la légende du Grand Inquisiteur
qui nous rappelle opportunément jusqu'où peuvent aller certains
délires religieux. Voir aussi les figures emblématiques
et antagonistes du starets, guide spirituel d'Aliocha et de Fédor,
son vieux débauché de père. Les scènes qui
les opposent sont inoubliables. L'alcool aidant, le père atteint
des sommets dans le registre du cynisme et de la provocation. Et surtout
de l'autodérision qui lui colle à la peau, tant elle fait
partie de sa personnalité de "vieux bouffon" shakespearien...
Mais le besoin d'humiliation est aussi un des centres de ce roman (et
de bien d'autres), tout comme l'irrépressible besoin de confession
que l'on retrouve chez presque tous les personnages et qui nous les rend
si proches. À défaut de toujours partager leurs idées,
nous partageons leurs discours. Au début était le verbe...
et Dostoïevski est bien l'écrivain du verbe. Mais ses héros,
qui semblent atteints d'une logorrhée insurmontable, aspirent aussi
à un silence rédempteur.
Tous ces points devraient être plus étayés, mais il
n'est pas facile de rendre compte de l'extraordinaire profondeur de ce
roman que je vais continuer à relire et sur lequel je voudrais
bien revenir de vive voix avec vous (j'aimerais savoir quels sont vos
passages préférés...).
À signaler qu'il existe des romans plus courts de Dostoïevski
qui sont très intéressants : Le
Joueur, L'Éternel
Mari et Les
carnets du sous-sol.
Anne-Marie
J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le livre, et je n'ai pas
réussi à le finir ; c'est un livre très étrange.
À la fois intéressant et pénible. Je n'ai pas vu
l'utilité de la moitié des actions des personnages pour
faire avancer l'intrigue, qui est au fond, très simple : c'est
l'histoire d'un meurtre, et comment le père insupportable et presque
fou semble avoir provoqué ce qui lui arrive. Il est une sorte de
bouffon symbolique de l'image stéréotypée que l'on
se fait du Russe, ivrogne, sournois, pervers, lyrique, passant du rire
aux larmes, débauché etc. Il est l'image de la faiblesse
humaine. Les frères sont plus ambivalents, ayant des moments de
lucidité et de générosité, aussi bien que
de folie et de sensualité, sauf Aliocha, profondément religieux
et qui essaie de sauver Mitia et Ivan de leurs excès. Le plus énigmatique
est Smerdiakov, le fils illégitime, qui ne semble pas avoir une
seule qualité ; il est, semble-t-il, définitivement
perdu, le mal absolu. Le seul élément vraiment passionnant
du livre, à mon sens, est le contenu philosophique de la pensée
des frères, et celle de l'auteur qui s'exprime au hasard des événements,
de temps en temps, au détour d'un échange, et c'est une
belle surprise à chaque fois.
Par exemple, le dialogue entre le Starets Zosime et une de ses visiteuses
sur la foi, les manifestations de l'existence de Dieu : comment retrouver
la foi si Dieu ne se manifeste pas ? Et le Starets explique qu'on
ne peut prouver l'existence de Dieu, on ne peut s'en persuader que "par
l'expérience de l'amour qui agit", par l'abnégation
dans l'amour du prochain, et la dame lui répond qu'elle ne pourrait
supporter l'ingratitude de ceux à qui elle donnerait son amour :
le dialogue est exemplaire, c'est très bien vu.
On sent la profondeur de la foi de l'auteur dans le poème du Grand
inquisiteur, sur le thème de la liberté que l'homme ne parvient
pas à accepter, puisqu'il préfère l'ordre et la sécurité,
le matérialisme. La démonstration est cependant assez obscure
dans ce passage, je préfère ailleurs les dialogues entre
les personnages qui semblent beaucoup plus vrais, et montrent bien la
faiblesse des humains pour laquelle l'auteur a finalement une grande indulgence.
"Il y a des moments où l'homme aime le crime"
dit Aliocha. Mais il ne juge pas, il est une sorte de miroir, il renvoie
les hommes à leurs turpitudes. Le personnage d'Aliocha est profondément
humain, mais il est en retrait, un observateur.
J'ai pour finir un sentiment mitigé alors que je n'ai pas achevé
le livre, mais il a vraiment trop de longueurs inutiles.
Je l'ouvre aux ¾.
Audrey entre et et

Œuvre théâtrale, œuvre philosophique, œuvre
de vérité. Tout converge pour en faire une œuvre éloge
de la parole.
- Une structure théâtrale
Les chapitres se succèdent dans ce livre comme des scènes,
les parties comme des actes. Les personnages entrent et sortent et leurs
entrées et sorties créent le lien entre les lieux et les
situations. La scène se vide pour se remplir sous un autre décor,
les personnages se croisent et se recroisent. Par hasard, par surprise,
ou parfois par coup fourré.
De la sorte avance le récit, par rencontres successives, comme
des scènes de théâtre qui s'enchaîneraient.
Un exemple parmi des milliers : lors de la rencontre de Kolia et
d'Aliocha devant la maison où est en train de mourir l'enfant,
à la toute fin d'un chapitre où ils se déclarent
tous les deux leur profonde affection, ou leur amour : "Je
vous aimais énormément je vous aimais et je rêvais
de vous (...) Bah, voici le docteur. Mon Dieu, il dit quelque chose, regardez
quelle figure il a !" (p. 704).
Et on passe au chapitre d'après, avec le médecin !
On reste dans des lieux assez restreints géographiquement. L'importance
étant finalement la pensée, l'intériorité
et l'exposé de ces pensées dans des lieux et avec des interlocuteurs
qui se succèdent.
- Très centrales dans l'œuvre les questions autour de la croyance,
du sens que peut prendre la cohabitation du mal avec l'existence de Dieu.
La bonté (dans sa dimension chrétienne, en particulier)
m'a paru magnifiquement exposée, notamment dans les débuts,
lors des rencontres du starets avec les habitants (en particulier la femme
qui a perdu son enfant). Une bonté extrêmement prégnante
aussi dans la biographie du starets.
Et puis Dostoïevski nous décrit de très belles relations
humaines. Un exemple, celle entre le starets et son ordonnance, cet homme
qu'il a battu et par lequel s'effectuera sa révélation sur
lui-même, sa transformation définitive. Leurs retrouvailles
représentent aussi un très beau moment (p. 430). Dans
ce livre la progression de la pensée semble devoir se faire grâce,
et par la confrontation à l'Autre.
Dostoïevski nous livre aussi de très belles pages sur l'amour
(là encore, sous le jour chrétien, mais il est toujours
possible ''d'éponger'' cette dimension chrétienne), desquelles
émane une vaste réflexion sur l'impact de l'homme sur l'Autre,
mais aussi sur son environnement au sens large, et puis sur la nature ;
cela résonne de manière particulière en cette période
d'épidémie mondiale. Lancinante, répétitive
jusqu'à l'obsession, la question de l'existence de Dieu tout au
long de cette œuvre ! Dieu, le bien et le mal, ces questions
traduisent des confrontations intérieures permanentes et nous donne
à voir des pensées qui s'entrechoquent.
Je vois là un auteur qui expose tout à la fois un point
de vue et des contradictions. C'est finalement un roman très philosophique.
- Puis, autour de toutes ces questions métaphysiques, philosophiques,
vont se succéder des problématiques plus concrètes
et non moins profondes sur la nature de l'homme.
Le relief et l'épaisseur de notre nature humaine surgissent après
le crime, à la recherche du meurtrier.
Le personnage de Dimitri incarnera cette complexité humaine, ses
contradictions, ses horreurs, ses beautés, sa bonté sublime,
sa part incontrôlable et obscure, ses pulsions contradictoires.
L'homme dans son imperfection, en somme !
Est-ce de cela dont sera coupable Dimitri ? Est-on coupable pour
avoir tué ou pour avoir souhaité une mort ? Dimitri,
c'est l'homme impulsif, débordant, excessif, emporté, violent,
exalté, dépensier. Il est exactement l'inverse de l'homme
docile, rangé, conforme, méticuleux, au pas, ordonné :
celui dont les apparences sont lisses et rassurantes.
Ô combien, cela nous renvoie à nos sociétés
de la notation où l'on juge en un clic. Simplifiant tout comportement
et le résumant à une note ! Une simple et si pauvre
note. Laquelle fait fi de la personnalité de l'être jugé.
Avec quelle note calamiteuse se retrouverait aujourd'hui Dimitri !!
Un homme pourtant bon, honnête, sincère, aimant. Un homme
touchant par sa complexité précisément. Il est dépassé
par ses tumultes. Il témoigne d'une certaine faiblesse.
Cette épaisseur de l'Être, la force des sentiments et des
comportements contradictoires, donnent une grande force à ce récit
qui échappe à toute tentation de caricature et de simplification.
À travers cette complexité exposée et assumée,
ce livre se fait celui des contradictions, des oppositions des doutes
et des débats où se déploie une très riche
dialectique. Pour tout cela c'est une œuvre qui grandit, nourrit
son lecteur, une œuvre troublante : "l'homme
est large terriblement large'' (p. 958).
Et épais et complexe pourrait-on rajouter à la lecture de
ce milliers de pages qui n'ont fait que le démontrer.
- Un dernier point me paraît très important dans cette œuvre,
c'est la quête de vérité très forte :
tant dans le désir de balayer si largement et profondément
réflexions, doutes, questionnements – que traduit donc
l'approche philosophique –, que par la rigueur du travail produit.
Par exemple : les recherches faites par Dostoïevski afin de
vérifier la vraisemblance et la vérité des faits
évoqués, l'aspect parfois documentaire sur la justice, le
starets, certains faits divers, etc.
Mais avant tout cette quête de vérité ressort à
travers la quête perpétuelle des personnages qui semblent
tous à la recherche d'une vérité personnelle, d'une
analyse fouillée de leur âme, de leurs actes, de leurs intentions
les plus enfouies, les plus inavouables parfois. Tous témoignent
(sauf peut-être Smerfiakov) d'une honnêteté extrême
envers eux-mêmes et les autres. Ils exposent ce qui leur semble
vrai, même s'ils changent d'avis dans la minute. Il y a un eux une
SINCÉRITÉ troublante. Ils exposent honnêtement leurs
craintes, leurs bassesses, sondent le fond du motif de leurs actes, leurs
pensées profondes, ils avouent leurs actes méprisables,
vils, médiocres ou pitoyables. Ils disent leurs hontes, leurs postures,
révèlent (et se révèlent) les mensonges qu'ils
ont tenté de se faire à eux-mêmes. Il y a évidemment
là quelque chose de l'ordre de la confession (un exemple p. 725,
aveux de Katia et de 700 à 703 dans la discussion entre Kolia et
Aliocha).
Une chose aussi surprenante et très touchante : les gens se
croient les uns les autres et savent que l'Autre cherche à dire
vrai. Leurs paroles comptent. Ils s'écoutent et peu importent les
contradictions, ou même quelques mensonges.
Le passage de la dernière rencontre entre Dimitri et Katia résume
d'ailleurs cela parfaitement : "ils se tenaient des
propos presque absurdes et exaltés, mensongers peut-être,
mais ils étaient sincères et avaient en eux une confiance
absolue" (p. 941).
Je terminerai là-dessus parce que cela résonne aussi avec
la fin du livre, cette belle exhortation à se souvenir. À
garder en mémoire les moments forts qui unissent les Hommes entre
eux (en l'occurrence Aliocha et les enfants) et j'aimerais, moi, pouvoir
me souvenir de cette œuvre, m'en approprier des réflexions
fortes et en faire quelque chose dans ma vie...
En écho aussi ... à cette pandémie qui questionne
tant les liens ?? J'ouvre entre ¾ et entièrement.
Monique
Quel livre ! Quelle ode à la Russie, au peuple russe dans
sa diversité et quelle spiritualité ! J'ai adoré
ce livre ; il m'a tenue en haleine pendant toute cette période
de confinement ; j'en ai distillé les pages comme celles d'un
produit rare, précieux, dont on ne veut pas qu'il s'épuise.
L'amour de la Russie et de son peuple explose de la première à
la dernière page : un peuple passionné, écartelé
entre plaisirs terrestres et spiritualité. Un peuple omniprésent
dont la parole s'exprime à tous les niveaux, du plus démuni
au nanti. Un peuple "qui
n'est pas servile après deux siècles d'esclavage, un peuple
libre d'allures et de manières, ni vindicatif, ni envieux",
dit le starets.
Le fait de centrer le livre autour de trois frères aux personnalités
totalement différentes – le mystique, l'intellectuel,
le dévoyé – permet à Dostoïevski une
exploration de l'âme humaine sous toutes ses facettes, avec des
répercussions dans toutes les couches de la société,
où des personnages annexes, eux aussi très typés,
enrichissent le récit, le déploie de façon passionnante.
Nous avons là, une foule de détails piquants sur les mœurs
de l'époque, la vie dans les isbas misérables, les demeures
familiales de la petite bourgeoisie, les troïkas, "les
ruelles, les impasses sombres désertes, théâtre d'aventures,
de surprises, parfois de perles dans la boue". Les descriptions
alternent avec des dialogues tout en rebondissements qui accrochent le
lecteur ; on est suspendu ; c'est très fort, très
riche, c'est l'histoire de tout un peuple aux personnages très
réalistes, pris dans l'engrenage de leurs passions. C'est Dostoïevski
et son regard intérieur, son art d'explorer l'âme humaine,
sa fougue, ses revirements, ses espaces secrets, ses rêves inavoués,
ses interdits. C'est une réflexion extrêmement subtile des
ressorts intimes de l'être humain, de sa complexité. C'est
une plongée dans l'âme russe, passionnée, excessive,
d'êtres hors-sol, sans limites, qui vivent leur destin au bout et
même au-delà de leur être, dans un questionnement permanent
sur leur lutte entre le bien et le mal.
Chaque personnage, très vivant, est ainsi l'objet d'un roman en
soi : Mitia, voyou au grand cœur, écartelé entre
son appétence pour les excès, les ripailles pimentées
de personnages sulfureux, et son sens de l'honneur, illustré par
les deux femmes de sa vie, Grouchenka et Katia. Fiodor Pavlovitch, petit
hobereau rusé, sensuel, corrompu. Aliocha le pieux, le réconciliateur.
Ivan, l'intellectuel, le nihiliste qui se laissera toucher par la grâce.
La spiritualité est omniprésente dans ce livre : "Sur
la terre nous sommes errants… nous avons la sensation mystérieuse
d'un lien vivant qui nous rattache au monde céleste ; les racines
de nos sentiments et nos idées ne sont pas ici, mais ailleurs",
dit le starets Zosime ; et plus loin : "Le
Seigneur sauvera la Russie, c'est du peuple que viendra le salut, de sa
foi, de son humilité". Cette spiritualité
est manifeste dans la parole du starets, mais aussi dans celle des trois
frères aux moments cruciaux de leur vie.
La façon dont Dostoïevski a construit son roman et déroule
l'intrigue maintient l'intérêt du lecteur tout au long du
livre. Il y a des passages magnifiques : le passage où Mitia
se tient dans la nuit à l'ombre d'un massif, sous la fenêtre
du père, est extraordinaire : on sent le désarroi,
la folie, la confusion de son esprit, tout cela est décrit de façon
précise, haletante… Autre passage, celui où Ivan "demeure
immobile, la tête entre les mains lorgnant toujours le même
point sur le divan… Visiblement quelque chose à cet endroit
l'irritait, l'inquiétait". Ce dialogue avec le
diable, ce dédoublement de la personnalité d'Ivan, cette
partie cachée de lui-même qu'il refuse de voir sont fantastiques
et conduits de façon très habile par l'auteur.
J'ai été subjuguée par la beauté de ce livre,
suspendue à l'intrigue, l'action, la vérité, l'humanité
des personnages. La façon dont ils vivent leurs épreuves,
leur réflexion, leurs revirements sont d'une grande richesse. Je
me suis efforcée de lire lentement, de méditer chaque phrase,
alors que mes doigts brûlaient de tourner les pages.
Ce livre est un chef-d'œuvre. Je l'ouvre en grand.
Christine
J'avais lu, il y a près d'une quarantaine d'années, avec
beaucoup d'enthousiasme Les frères Karamazov.
Dostoïevski a mis toute sa vie dans ce livre. La structure du livre
est admirable. Les personnages vivent sous nos yeux de lecteur. Les histoires
annexes, telle celle d'Ilioucha, renforcent l'intérêt de
la lecture.
J'ai apprécié le fond historique. L'intrigue se situe à
une époque où l'ancien monde russe s'estompe. Des idées
nouvelles naissent, la société évolue, mais les rapports
maître/serviteurs que décrit Dostoïevski ne se sont
pas encore affranchis de l'ancien servage. Les trois frères et
leur père sont l'incarnation de cette époque.
Cependant, j'ai relu ce roman avec moins d'enthousiasme que la première
fois. Le récit s'étire à cause des nombreuses digressions.
Dostoïevski expose très longuement son point de vue sur l'intérêt
de la religion. J'ai été déçue par la fin
dont je ne me souvenais pas. Elle ne s'accorde pas du tout à la
psychologie de Smerdiakov telle que je l'avais perçue.
J'ouvre ce livre aux ¾ car c'est un livre à lire ne serait-ce
que pour sa culture générale.
Nathalie
Je suis incontestablement plus Tolstoï que Dostoïevski. Les
300 premières pages n'ont pas été particulièrement
un plaisir de lecture. La frénésie de l'écriture,
souvent convulsive, les mots qui se répètent et se bousculent
sans cesse, l'effusion verbale m'ont pas mal agacée au début.
Il faut dire que je n'étais pas dans le même tempo, confinement
oblige ! Du coup, je me suis intéressée aux différentes
traductions. Il se trouve que j'avais à ma disposition la traduction
de Henri Mongault (Folio
avec en préface un texte de Freud : "Dostoïevski
et le parricide"), celle de Boris de Schloezer (chez Stock) et celle
dans laquelle je me suis réellement plongée de
Markowicz. La comparaison des traductions que j'ai trouvée
passionnante m'a aidée à poursuivre ma lecture.
Les russophones s'accordent à dire que la traduction de Markowicz
serait la meilleure car plus proche de l'écriture de Dostoïevski.
Et Markowicz indique à quel point il lui tenait à cœur
de respecter la structure de la langue de l'auteur qui ne cherche pas
la belle langue. Ce qui pour le moins est incontestable. Les 300 premières
pages passées, j'ai commencé à vraiment être
accrochée et à ne plus pouvoir quitter le livre. Je l'ai
lu de façon addicte sans sauter un seul mot. La rupture du ton
lorsque l'on se trouve au monastère m'a aidée. Une écriture
calme, sereine, qui s'étire notamment grâce au personnage
du Staretz. C'était plus en phase avec ce que je vivais. Et puis
surtout m'apercevoir que Dostoïevski pouvait avoir une autre écriture
que celle qui représente au mieux ses personnages excessifs, exaltés,
bouffons, voire hystériques m'a permis de mieux accueillir la suite
des aventures de Mitia. Car même si Dostoïevski prétend
entreprendre la biographie de son héros Alexeï Fiodorovitch
Karamazov, l'intrigue porte d'avantage sur les dilemmes et le destin de
Dimitri Fiodorovitch Karamazov, le premier fils. Alexeï est une sorte
de passeur (il ne cesse de passer d'un personnage à l'autre) ;
on connaît finalement assez peu de choses sur Aliocha à part
sa croyance en Dieu qui se fond avec son amour du prochain. Il incarne
la bonté, la sincérité, la franchise. Alexeï,
plutôt qu'un héros, est, selon moi, celui que le lecteur
suit pour découvrir ce qui se passe entre les uns et les autres.
Une sorte d'accompagnateur tel Virgile pour Dante. Les frères K.
représentent respectivement selon moi l'idéaliste chrétien
(Alexeï qui en outre a le super pouvoir de lire dans l'âme
des autres, voire de pressentir ce qui va se passer), le Rationaliste
(Ivan), le possédé par ses émotions (Dmitri), et
le Mauvais (Smerdiakov). C'est l'idéaliste chrétien qui
l'emporte. Le Mal se suicide, Le possédé par ses émotions
est condamné et le Rationaliste devient dingue après avoir
discuté avec le diable, lors d'un épisode hallucinatoire.
Ceci étant, le roman construit comme un roman policier n'étant
pas achevé, on peut imaginer que cela change avec les années !
On sait dès le début que le père est mort de manière
tragique et mystérieuse. On saura qui est le coupable, on sait
qu'un innocent sera condamné, mais on ne saura pas si Ivan mourra
ou si Dmitri parviendra à s'enfuir. Dostoïevski travaillait
au second volume quand il est décédé. Le narrateur,
qui est quelqu'un dont on ne connaîtra jamais l'identité,
raconte ce drame 13 ans avant les faits. On ne sait donc pas ce qui se
passera durant toutes ces 13 années. J'ai pensé parfois
en le lisant à Agatha Christie, pour la composition, notamment
dans l'installation des personnages (je me suis demandé si elle
s'était inspirée de Dostoïevski !) et à
Eugène Sue, non seulement par le côté feuilleton avec
ses longueurs, mais aussi par toute cette sentimentalité dramatique.
Il me manque les nuances. Et puis surtout je n'apprécie pas plus
que ça que les personnages soient tous ou quasiment névrosés
ou atteints de psychose, quand le vrai criminel n'est pas un psychopathe !
Sans compter l'hystérie des femmes relativement pénible.
Elles sont toutes à moitié folles ou complètement !
Le dernier livre consacré à l'audience qui se terminera
par la condamnation d'un innocent est pour moi la plus faible partie du
roman, dans laquelle des coupes auraient pu être faites. Mais il
y a de très très beaux chapitres. J'ai apprécié
toutes les discussions d'ordre théologique et métaphysique
qui font apparaître les angoisses des uns et des autres face à
un monde qui est en train de perdre Dieu ("Si
Dieu n'existe pas, tout est permis") ; j'ai beaucoup
aimé le livre (X ; il y en a XII) sur les collégiens,
Kolia et les autres, avec l'histoire très émouvante du gamin
Ilioucha qui lui a un père aimant qu'il aime profondément
(ce qui est censé je suppose faire le pendant aux relations des
frères K. avec leur propre père). Et puis il y a toutes
les notions de honte, d'humiliation, de déshonneur, tous les malheurs
de la dignité humaine que Dostoïevski aborde avec une immense
sensibilité et beaucoup de finesse. C'est pourquoi j'ouvre aux ¾.
Anne  
Par cette période d'immobilité, le livre Les Frères
Karamazov fait galoper, courir d'un chapitre à l'autre sans
discontinuer. Coups de théâtre sur coups de théâtre.
Dostoïevski aurait pu être un auteur de théâtre,
l'acte et le corps sont complètement engagés et m'ont donné
sentiment d'être parmi eux, bouleversée, bousculée,
maltraitée, accompagnée de cette lumière interne
qui illumine. Son exaltation pour la vérité permet à
Dostoïevski d'atteindre, par un renversement étonnant, les
sommets de la spiritualité, et dans les atmosphères les
plus sordides. C'est que, au cœur de chacun de ses personnages, il
montre qu'il y a une âme vivante comme une lumière éternelle
et universelle.
Dostoïevski s'interroge sur la liberté, dont celle de l'homme
moderne qui devient prisonnier de lui-même, en cela il est prophète,
visionnaire. La liberté tue. Mais la religion, la croyance, seraient-elle
salvatrices ? La foi permettrait tout de même de lever un regard
particulier sur la bonté.
Il faudrait étudier le livre longtemps, le relire, pour en tirer
toutes les leçons tant il est complexe.
Il est dit que Dostoïevski est devenu réactionnaire par la
suite ; sans doute voyait-il déjà les limites, les
catastrophes, qu'annonçait ce nouveau monde. En laissant les personnages
aller au bout d'eux-mêmes, il va de soi qu'ils deviennent fous…
ou sages. C'est de circonstance, et cela pose une question actuelle, peut-on
connaître la sagesse sans avoir connu la folie ? Ne sommes-nous
pas en plein dedans, notre folie capitaliste, n'est-il pas temps de tirer
les leçons de l'excès. Le pourrons-nous ?
Sans doute Dostoïevski cherche-t-il des réponses en même
temps qu'il écrit. Il pose ses personnages, il les fait parler,
et il attend leurs réponses. Il est un auteur en quête des
vérités qui surgissent sous sa propre plume.
La dramaturgie de ce livre est extrêmement bien construite. Le rôle
d'Alioucha, au centre, détient la bienveillance sans laquelle rien
ne peut tenir. Elle existe grâce à la transmission du Starets.
Ce sage homme, un bon père dans ce livre qui parle tant de la transmission
du mal. Ceci permet à Alioucha de développer et d'exercer
cet art sur son entourage : "il
faut quand même le dire à quelqu'un. À l'ange dans
le ciel…. Tu écouteras, Alioucha, tu jugeras, tu pardonneras".
Le mal n'est donc pas total, mais cette bienveillance ne peut pourtant
rien changer à l'ordre des choses (ou à leur désordre),
car il est lui-même coupable (plus calmement, plus inconsciemment)
d'un désir de mort du père, et il n'a pas pu empêcher
Ivan de donner la permission à Smerdiakov de tuer le père.
Dans ce livre, les désirs de mort envers le père se présentent
les uns dans les autres comme des poupées russes.
Mais je vais ici un peu parler de moi pour dire plus, précisément
ce que j'ai éprouvé à la lecture. Ce livre m'a fait
faire une petite introspection, et j'ai remarqué combien j'ai laissé
dans l'oubli des choses de moi-même. En vérité, elles
se sont plutôt transformées et ont mué, laissant leur
vieille peau au bord de la route. À bien regarder, je pense que
ma personnalité originaire était microscopiquement constituée
des aspects dramaturgiques de ce livre. Je n'en ai pas fait la même
chose bien sûr. Je regarde loin dans mon passé et me souviens
qu'ayant trouvé un certain confort à vivre, j'ai abandonné
les amours excessives, les haines retenues, la quête d'une liberté
folle... J'ai en mémoire avoir rangé ces sentiments bouillonnants
et un beau jour, comme on dit… Cela a dû se passer après
l'adolescence… j'ai fait le compte, je n'avais rien à y gagner,
et j'ai accédé progressivement au monde de la négociation.
Il y a moins de grandeur à cela. Alors, en consolation, j'ai beaucoup
fréquenté les livres. J'ai retrouvé dans cette région
de la littérature tous ces personnages en moi qui souhaiteraient
tant évoluer hors des chemins battus.
Très impliquée dans la lecture des Frères Karamazov,
j'ai regardé, écouté chacun agir, comme si j'avais
été embarquée dans l'aventure. Je les ai tous aimés.
Les personnages pleurent, rient, mentent comme ils respirent, disent trop
la vérité, aiment tout détruire et, avec les ruines,
reconstruire, ils haïssent pour ne pas mourir, ou pour mourir – mieux
vaut provoquer la mort que la subir – ils ont l'amour de la
mort autant que de la vie, l'amour de la peur aussi. Ils vivent au Mont
Olympe, dans la région superbe et enragée des Dieux, où
survient anachroniquement le Christ Alioucha (sauf que le Christ n'aurait
pas souhaité tuer son père, mais le livre est plein de contradictions
n'est-ce pas) qui prend leur fardeau sur lui en souriant et les fait parler.
S'il s'oppose à son frère athée, Ivan, dans une superbe
conversation, c'est par fidélité, par tendresse, par espoir,
et pour faire la nique à la rancune, la peur, le mépris,
la fierté, la rudesse, la cruauté, la culpabilité,
tous de service au long du livre. Ce roman est une sorte de danse effrénée
des sentiments, qui ouvre pourtant des portes inattendues, celle de Dieu,
comme recelant en son sein la beauté, le mystère situé
au centre de chaque homme dont les plus ténébreux, une lumière.
Dostoïevski délivre un message spirituel.
La dramaturgie de ce livre est constante, les situations sans cesse inattendues,
les atmosphères grandioses, presque fantastiques, comme la scène
de Dimitri dans le jardin le soir du meurtre du père. Par contre
les femmes sont représentées de façon négative.
Elles sont garces, même l'ingénue Lisa. Aucune ne peut rester
intègre. Katerina devient hystérique, aussi misérable
que superbe. Elles sont capables du pire et du meilleur mais toujours
dans la dépendance avec l'homme. Il n'y a pas de figure féminine
entière, une Marianne ; je le déplore car, sous la
plume talentueuse de Fiodor, elle aurait été inégalable.
Sinon, ces personnages presque mythologiques sont comme des arcs bandés
prêts à lâcher leurs flèches qui ne cessent
pas de recharger l'arme de Cupidon. Je n'aime pas les livres longs, force
est de me dire qu'il y a des exceptions. Ce livre aurait-il gagné
à être raccourci ? Non, il est comme il est. Tout est
juste, tout démontre quelque chose, tout va à son paroxysme
et pose des questions sur l'humanité. Libre à moi tout de
même d'avoir passé quelques pages. Au début où
j'ai eu du mal à entrer dans les histoires entre hommes d'église.
Puis à la fin où l'on arrive enfin au procès, que
j'ai trouvé trop long, bien que remarquablement écrit et
laissant une place d'honneur aux questions de la justice.
La dramaturgie dans son ensemble m'a tenue en haleine à 300 %.
La présence des enfants qui termine le livre est très bien,
elle laisse le monde s'ouvrir sur l'avenir. Alors, j'ouvre le livre à
300 %, moins 100 % pour les pages que j'ai laissées un
peu en rade, cela fait donc 200 %, mais on n'a le droit qu'à
100 % à Voix au chapitre, va donc pour 100 %, en entier
quoi.
|
|
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
|
à
la folie
grand ouvert
|
beaucoup
¾ ouvert
|
moyennement
à moitié
|
un
peu
ouvert ¼
|
pas
du tout
fermé !
|
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|









![]() Nous écrire
Nous écrire