Nous
avons lu pour le 7 septembre 2025
des
livres d'Afrique

subsaharienne
|
Nos lectures d'été
|
Notre lecture commune
: un
"classique" de la littérature africaine ET un livre contemporain
:
-
de Mariama
BÂ (sénégalaise, 1929-1981) Une
si longue lettre (publié en 1979), éd.
Litos, coll. "Motifs", 176 p.
- de Nathacha
APPANAH
(de l'Ile
Maurice, née
en 1973), La
mémoire délavée (2023), Folio,
160 p.
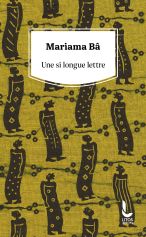

Voir ›ici
la documentation autour de ces livres et de leur choix.
|
Les lectrices
|
Ce 7 septembre 2025, nous
étions 13
sur 16 à participer de diverses manières à
la séance :
- en direct : Anne, Claire, Felina, Flora, Laetitia, Mar, Marie-Yasmine,
Nelly, Patricia, Stéphanie, Véronique
- en visio : Agnès
- par écrit : Sophie de Paris
- prises ailleurs : Aurore, Joëlle, Sophie de Nice.
|
Les tendances
|
Les
deux livres, différents, ont été
tous deux appréciés, voire très appréciés,
par Agnès, Anne,
Claire, Felina, Flora,
Laetitia, Patricia, Stéphanie,
Véronique.
Des réserves ? Sur La mémoire délavée
de la part de Marie-Yasmine et Sophie.
En revanche, certaines qui ont aimé les deux livres ont eu une
préférence pour La mémoire délavée.
Et sur Une si longue lettre ? Mar n'a pas réussi
à y entrer. Nelly, à l'unisson d'un
des livres, avait la mémoire un peu délavée et sa
préférence a semblé aller à la lettre.
L'idée de découvrir un aperçu d'une littérature
mal connue - la littérature africaine subsaharienne - a en
tout cas suscité intérêt et satisfaction. Découvrir
la voix et la vie des femmes décrites s'est accompagné à
la fois d'une approche sensible mais aussi
| La succession des avis |
Sophie
Il y avait deux livres au programme de l'été : Une si
longue lettre et La mémoire délavée. J'ai
consciencieusement emporté les deux dans mes bagages de vacances,
avec l'intention de les lire tous les deux.
J'ai commencé par Une
si longue lettre.
Après quelques pages, rapidement, j'ai pénétré
dans l'univers de Ramatoulaye et parcouru cette "longue lettre"
avec assiduité, facilement. Au fil de la lecture, j'ai ressenti
de nombreux sentiments, de l'empathie à la colère. Colère
de féministe face au sort des femmes africaines et à leurs
maris polygames.
Ces confidences sont partagées avec le lecteur comme avec l'amie
à qui l'on écrit. J'ai eu l'impression d'entrer dans la
maison, dans la famille, avec un sentiment de proximité qui fait
que, plusieurs semaines après la lecture, j'ai toujours des réminiscences
de certains passages, de certaines scènes, comme si j'y avais assisté.
Les personnages du roman me semblent presque réels, comme si je
les avais rencontrés.
C'est cette intimité "universelle" que réussit
à créer Mariama Bâ qui me marque le plus, finalement.
Elle réussit à transmettre le vécu de ces femmes
africaines, leurs émotions, leurs combats, leur résilience
en les rendant accessibles à tout être humain.
L'air de rien, ce livre "si court" s'est fait une place en profondeur.
Comme on garde en mémoire une rencontre, une personne.
J'ai ensuite entamé La
mémoire délavée
avec optimisme. J'y ai immédiatement trouvé une écriture
davantage travaillée que celle de Mariama Bâ et cela m'a
plu.
Mais alors que je m'étais tout de suite sentie en proximité
dans Une si longue lettre, je suis restée à distance
et je n'ai pas réussi à entrer dans le livre, à m'intéresser
à la quête personnelle de Nathacha Appanah. Son histoire,
celle de ses ancêtres n'ont pas réussi à m'absorber
car, contrairement à Une si longue lettre, je n'ai pas trouvé
dans les 40 premières pages de points d'appui pour m'y accrocher.
J'ai renoncé à poursuivre la lecture. Peut-être lui
donnerai-je une deuxième chance ?
Flora
J'ai trouvé les deux livres accessibles d'une manière différente
: ainsi,
celui dont j'ai failli décrocher, cst celui que j'ai préféré,
La mémoire délavée, le trouvant plus personnel,
touchant. Le travail de recherche y est très bien présenté
; j'ai beaucoup appris concernant l'esclavage et ai beaucoup apprécié
: il mérite l'effort que j'ai fait.
Mariama Bâ était davantage connue pour moi et je suis très
contente de l'avoir lu. A priori, j'ai du mal avec la correspondance et
j'ai un peu mélangé personnages et thématiques. Si
l'univers m'était davantage familier, j'ai cependant bien accroché.
J'ai trouvé que les deux livres constituaient un très bon
choix.
Véronique
J'ai commencé par Nathacha
Appanah et ai été surprise de découvrir que l'île
Maurice est en Afrique. Le livre m'a permis également d'apprendre
ce qu'il en a été sur cette île de l'esclavage dont
je n'avais aucune idée. C'est très triste et un peu plombant
- ce qui a rendu ma lecture un peu hachée en raison de cette tristesse.
Ce n'est pas du tout la même écriture que l'autre livre,
beaucoup plus personnel. Cette histoire m'a plu. C'est une autrice à
suivre.
Quant au second livre, rédigé sous une forme de lettre,
cela m'a bien convenu. J'y ai aussi appris des choses. J'y ai vu un rapport
avec Americanah
de Chimamanda Ngozi Adichie : j'avais l'impression d'entendre la même
voix ; il y a une corrélation dans le fait d'être africaine.
J'étais sensible à des propos intéressants, sur les
métiers manuels par exemple. Tout en évoquant la relation
avec son mari, elle évoque des aspects qui ne sont pas exclusivement
africains, qui touchent à l'universel, notamment l'éducation.
Je ne suis pas arrivée à la fin, mais ai l'envie de terminer.
Agnès
J'ai entendu que les livres audio avaient de plus en plus de succès.
J'ai donc décidé, non pas de lire ce roman Une
si longue lettre de Mariama Bâ, mais de l'écouter
grâce au podcast
proposé par France Culture. L'expérience a été
très agréable. J'ai apprécié les voix, la
mise en scène des dialogues et les bruitages, ces techniques m'ont
permis de me sentir plongée dans le bain culturel sénégalais.
En ce qui concerne le livre lui-même, j'ai tout d'abord été
séduite par la beauté de la langue et la qualité
littéraire du texte. Je comprends que ce roman soit un classique
de la littérature africaine moderne et qu'il soit étudié
dans les écoles et les universités. J'en suis d'autant plus
heureuse qu'il dénonce la condition des femmes prises au piège
d'un système patriarcal (qui prend la forme ici de la polygamie).
Ce système est minutieusement décrit, et c'est instructif,
ainsi que ses conséquences sur la vie des femmes : mariages arrangés
de toutes jeunes filles par leurs familles pour des raisons financières,
faisant fi de leur liberté et de leur éducation, grossesses
nombreuses (12 enfants pour l'héroïne, 3 pour sa jeune co-épouse
en 5 ans), veuves dont la tradition veut qu'elles épousent le frère
ou un ami du défunt, lois régissant le patrimoine et l'héritage
en défaveur des femmes, etc.
Ces faits, qui sont dénoncés dans le roman, pourraient accabler
la lectrice, mais l'héroïne trouvant la force de faire face
et de dire non, on sort de cette lecture avec une note d'espoir.
La forme de la lettre à une amie invite à l'idée
de sororité, par l'expérience vécue commune, le soutien
et le courage que les femmes y puisent (ici, l'amie avait rompu avec l'époux
qui avait décidé de se marier une 2e fois).
C'est une adresse pour plus d'égalité. Je proposerai ce
roman féministe à mon autre groupe de lecture.
J'ai lu La
mémoire délavée de Natacha Appanah en version
numérique sur ma liseuse. J'ai tout d'abord été décontenancée
par sa forme, je n'arrivais pas à déterminer le genre de
l'ouvrage : essai, témoignage, notes de travail après l'écriture
d'un roman ? L'intérêt que j'ai ressenti ensuite pour ce
récit, au fil de ma lecture, l'a emporté et j'ai beaucoup
apprécié ce livre, que j'ai trouvé particulièrement
touchant.
Je l'ai également trouvé instructif, car je ne connaissais
pas l'existence des engagés indiens venus travailler sur l'île
Maurice.
J'ai également aimé les photographies qui accompagnent l'histoire
de cette famille.
En règle générale, je suis très intéressée
par les récits personnels et les recherches généalogiques,
ce livre m'a donc vraiment plu, encore plus que le premier.
Felina
Une
si longue lettre, le roman de Mariama Bâ, m'a immédiatement
fait penser aux Impatientes
de Djaïli Amadou Amal, surtout en raison de la thématique
centrale de la polygamie. J'ai cependant un peu moins accroché.
Le livre expose avec force les thèmes de la polygamie et de la
condition féminine, soulignant l'absence de droits pour les femmes
dans cette société. Il est intéressant de noter la
différence avec Les Impatientes qui, bien que plus récent,
dépeint une société du Sahel qui paraît encore
plus dure que celle du Sénégal des années 70.
L'un des aspects les plus fascinants du roman est le contraste entre les
parcours des deux amies, Ramatoulaye et Aïssatou. Aïssatou a
réagi de manière active et a choisi de reconstruire sa vie
aux États-Unis après la répudiation de son mari.
Son choix est celui de l'émancipation et de la révolte.
Ramatoulaye, en revanche, subit les événements de façon
plus passive, à mon avis.
Le thème qui ressort avec le plus de puissance est celui de l'amitié
féminine. Ce lien, décrit comme riche et précieux,
semble être la seule source de réconfort et de soutien, une
émotion plus forte et plus solide que l'amour qu'elle a connu.
J'ai été un peu déstabilisée par les moments
où la protagoniste sort de son récit personnel pour se lancer
dans des discours politiques et sociologiques. Bien que pertinents, ces
passages alourdissent parfois la fluidité du récit.
En conclusion, je comprends l'importance qu'a pu avoir ce roman militant
dans les années soixante-dix pour la première génération
de Sénégalaises instruites, contre la polygamie et reste
toujours bien d'actualité.
J'ai préféré le livre de Nathacha Appanah,
La Mémoire délavée, à Une si longue
lettre. Il m'a fait découvrir une réalité que
j'ignorais complètement : après la fin de l'esclavage, des
travailleurs des anciennes colonies ont été appelés
pour travailler dans les plantations de canne à sucre.
Le livre est un bel objet en soi. Les pages épaisses semblent faire
écho à la profondeur du récit, et j'ai particulièrement
apprécié l'ajout des photos en noir et blanc.
Le roman mêle l'histoire officielle, qui oublie souvent le destin
des dominés, et les oublis et omissions qui existent aussi dans
les histoires de famille. Il parle de ces personnes dont on ne parle pas,
de celles dont il est trop difficile de parler. Plus qu'un roman, c'est
un document essentiel pour la mémoire de sa famille et de ses origines.
J'ai beaucoup aimé la comparaison initiale entre le vol des oiseaux
et la migration des humains. En revanche, j'ai été un peu
ennuyée par les moments où l'autrice cherche comment écrire
son histoire et par ses hésitations.
J'ai été émue par l'histoire, par l'ascension sociale
et par les sacrifices des anciens pour fonder une famille et donner à
leurs enfants les moyens d'évoluer et de s'émanciper de
la pauvreté.
J'ai lu ce livre presque d'une traite, happé par son écriture
simple et par mon intérêt pour le sujet des origines.
Très bon choix pour les deux !
Stéphanie
J'ai lu La mémoire délavée
en second et j'ai adoré. Contrairement à certaines,
le flottement du début m'a tout de suite intriguée, avec
ce vol d'oiseaux très parlant, pour ce roman des origines qui est
parallèle à la difficulté de trouver une forme. C'est
souvent le problème des écrivains qui veulent aller vers
le personnel, la forme à trouver. J'ai adoré. Les photos.
Les pages brillantes. Ce petit objet, un plaisir. Je l'ai lu assez rapidement.
Des choses m'ont beaucoup touchée, avec une pudeur concernant les
grands-parents. Chaque génération lâche quelque chose
pour avoir une meilleure adaptation. J'étais moi aussi surprise
de retrouver Maurice en Afrique. L'aspect historique est très intéressant.
Une lecture touchante et un coup de cœur pour les photos, avec une
subtilité concernant les relations familiales.
Le premier, Une si longue lettre, je l'ai
lu en début d'été. J'ai aussi beaucoup aimé,
apprécié, la langue. J'ai retrouvé des récits
que j'avais pu entendre dans mon précédent travail. La relation
épistolaire me touche beaucoup. La question de la sororité
est fortement présente. J'ai apprécié les deux destins
des amies, différents, mais sans qu'il y ait de jugement de valeur.
Toutes les deux sont courageuses. Les deux destins sont valables. Et pour
la narratrice, l'écriture représente la rébellion.
Je suis très contente de ces deux lectures. Et j'apprécie
les formats courts.
Marie-Yasmine
Je suis beaucoup moins enthousiaste que vous concernant La mémoire
délavée. J'ai été moi aussi surprise de
découvrir l'île Maurice en Afrique. Je n'ai pas adhéré
au genre, que nous avons déjà rencontré avec Un
désir démesuré d'amitié, Triste
tigre et Laure
Murat
: ça ne me correspond pas trop. La lecture en a été
plus difficile. Je ne connaissais pas du tout cette problématique
des coolies de l'ile Maurice et je suis heureuse d'en savoir plus sur
ce sujet, mais le format mi-enquête, mi-souvenirs d'enfance m'a
laissée sur le côté. J'aurais là, aimé
un roman sur ses grands-parents.
En revanche, j'ai beaucoup aimé Une si
longue lettre : son style m'a emportée. Le format d'une
lettre à une vieille amie intime est très plaisant et m'a
tout de suite accrochée.
Les histoires racontées sont très intéressantes,
et le point de vue, de l'intérieur, sur la polygamie était
très nouveau pour moi et très intéressant. La forme
également m'a plu, l'écriture est très fluide, se
lit très facilement et est prenante. J'ai seulement ressenti une
gêne dans la partie finale que j'ai trouvée très essentialisante
concernant les femmes et les hommes.
Patricia
J'ai
dû interrompre, avec regret, ma lecture de Americanah
de Chimamanda Ngozi Adichie, magnifique roman également, pour pouvoir
commencer et finir à temps celle de Une si longue lettre
de Mariama Bâ, autrice dont j'avais déjà entendu parler,
d'abord suite à des recherches personnelles sur des écrivaines
africaines, mais aussi grâce au livre 60
destins de femmes noires, libres et inspirantes, acheté
lors de l'exposition Paris
noir, où un chapitre lui est consacré.
Finalement, je n'ai pas regretté de l'avoir lu. J'ai beaucoup
apprécié la forme originale, un roman épistolaire,
lettre adressée à son amie d'enfance, et constituée
de petits chapitres courts traitant d'un sujet à chaque fois, ce
qui permet de se retrouver facilement dans le texte et dans les différents
personnages.
J'ai trouvé l'écriture très vivante, voire enjouée,
avec des pointes d'humour de temps en temps, très agréable,
malgré les circonstances douloureuses. On y retrouve bien l'ambiance
africaine. J'ai lu le livre presque d'une traite, j'étais captivée.
Les sujets abordés y sont passionnants et nombreux : les rites
africains, notamment lors du deuil d'une femme qui perd son mari, la polygamie,
la succession des biens, la place des femmes et leurs droits dans la société
africaine, l'éducation des jeunes, l'éducation sexuelle
et les évolutions qui se font progressivement tout en suivant la
progression du monde.
Il est difficile de s'imaginer que ce livre date des années 1970
et que l'autrice est de religion musulmane. J'ai trouvé très
progressistes, très modernes, les sujets abordés pour l'émancipation
des femmes bien avant #Metoo. D'ailleurs elle aborde aussi le sujet des
politiques pour faire évoluer les lois. En revanche, elle ne rejette
pas les traditions africaines, sauf celles sur la polygamie. Au contraire,
elle veut garder l'identité de l'Afrique.
Je ne suis pas sûre que maintenant, avec la montée de l'islamisme,
une femme musulmane sénégalaise pourrait écrire ce
genre de choses tout en restant dans son pays… Au final, j'ai beaucoup
aimé ce livre, il est plein d'espoir, et j'ai trouvé aussi
que c'était une belle déclaration d'amour pour son amie
qui a eu le courage de divorcer, et qu'elle s'apprête à retrouver
alors qu'elle aussi est seule après avoir rejeté les différentes
demandes en mariage.
Heureuse de l'avoir lu et de savoir que c'est devenu un classique de la
littérature africaine !
Je me suis aussitôt attelée au second livre de Nathacha
Appanah La
mémoire délavée
(2023). J'ai tout de suite vu qu'au point de vue historique, le livre
allait être très intéressant, situé à
l'époque post-abolition de l'esclavage. J'ai quand même eu
un peu plus de mal à rentrer dedans, car il est beaucoup plus dense
que le premier livre. Ce n'est pas un roman, ni une fiction. Je l'ai plus
vu comme un essai, qui nous renseigne sur l'arrivée des Indiens
d'Inde à l'île Maurice, avec un gros travail de recherche
sur l'arrivée de ses aïeux à la fin du 19e siècle.
L'écriture est fine et agréable, les propos sont profonds
; elle essaie de reconstituer les faits avec justesse, il lui arrive d'imaginer
dans le flou certains faits, mais pas évidents par manque d'archive
(culture orale) et de témoignage familial, car certains sujets
restaient tabous. Elle le signale quand certains faits sortent de son
imagination.
J'ai trouvé le livre bien écrit, chargé d'émotions
et de nostalgie, où on ressent sa douleur (bien qu'elle reste très
pudique là-dessus) par rapport à ce que ses aïeux ont
vécu, jusqu'à ses grands-parents qui ont vécu le
mariage arrangé.
Ce livre m'a permis de voir un autre aspect de la littérature africaine,
celle de l'île Maurice dont on entend peu parler, et qui est bien
classée dans l'Afrique.
En conclusion, j'ai aimé lire ces deux livres, bien que complètement
différents d'époque et de style.
Laetitia
J'ai
apprécié la découverte de ces deux textes très
différents mais complémentaires, un livre "classique"
et un autre plus contemporain.
J'ai également aimé entrer dans l'univers, méconnu
pour moi, de la littérature africaine, à travers les petites
capsules RFI signalées sur le site Lirelles.
Bien que les deux livres aient des contextes distincts - le patriarcat
sénégalais d'un côté, la mémoire coloniale
mauricienne de l'autre - j'ai trouvé intéressant que les
deux aient le même projet : faire de la littérature un lieu
de justice et de réparation.
Au niveau du fond, on retrouve une même lutte contre l'invisibilisation
- des femmes et des ancêtres - et la volonté de redonner
la parole aux oubliés. Mariama Bâ et Natacha Appanah redonnent
ainsi toutes les deux voix au chapitre à celles et ceux que la
société ou l'Histoire a relégués au silence.
Une si longue lettre : bien plus qu'un roman
intime, il s'agit d'un véritable manifeste féministe africain
et d'un livre-plaidoyer, à travers la voix de Ramatoulaye qui s'exprime
pour la reconnaissance de la femme comme sujet autonome. Les autres points
d'intérêts que j'ai notés, liés à cette
problématique centrale :
- les deux formes de féminismes avec deux figures de femmes, Ramatoulaye
et Aïssatou : l'une enracinée dans la société
traditionnelle et l'autre tournée vers l'émancipation radicale
et moderne
- la sororité et la solidarité féminine à
travers leur amitié
- la critique de la polygamie, outil de domestication masculine
- la dénonciation de l'ordre patriarcal, de la domination des belles
familles
- la critique du "lévirat"
(je ne connaissais pas ce terme et cette pratique)
- l'importance de l'éducation et de la culture (le cinéma
notamment), armes garantes d'un avenir plus juste.
La mémoire délavée : à travers la réécriture
des silences familiaux, Natacha Appanah dénonce l'injustice coloniale.
Elle s'intéresse aux traumatismes sociaux et coloniaux ; je ne
connaissais pas l'Histoire des "coolies",
des ancêtres indiens arrivés comme travailleurs engagés
à l'île Maurice ("l'engagisme
indien").
Au niveau de la forme, les deux livres sont
tous les deux très bien écrits, mais ne sont pas identiques.
D'un côté, une forme épistolaire, une "confidence"
; de l'autre, une langue délicate, poétique et des photos
qui viennent illustrer les souvenirs fragmentés. Dans Une si
longue lettre, une unité et une continuité du récit,
une forme de lyrisme à travers l'oralité, un appel à
la révolte, qui n'est pas sans rappeler le texte de Chimamanda
Ngozi Adichi, Nous
sommes tous des féministes. Dans La mémoire délavée,
une forme éclatée qui reflète bien les trous de la
mémoire collective, une sobriété qui invite au recueillement.
En conclusion, je remercie Lirelles d'avoir programmé cette séance qui nous a permis d'une part de découvrir davantage une littérature méconnue en France, la littérature africaine, et d'autre part, d'appréhender la portée politique de deux textes littéraires - féministe et mémoriel - qui dépassent l'intime pour toucher au collectif.
Pour finir - en lien avec l'actualité et la rentrée littéraires - j'ai lu que La nuit au cœur de Natacha Appanah, faisait partie de la première liste des romans en lice pour le Goncourt 2025, le Renaudot et le Médicis !
Nelly
En
reprenant La mémoire délavée que j'ai lu il
y a deux mois, je me suis interrogée sur ma propre mémoire,
car ce matin je ne m'en souvenais plus du tout ; et même en le parcourant,
rien ne me revenait. Il y a parfois des livres qui ne nous laissent pas
de trace, par leur banalité ; ce n'était pas le cas, mais
quand j'ai entendu Véro évoquer la tristesse, je me suis
demandé si ce n'était justement pas cette impression de
tristesse qui en était la cause. Vos commentaires m'ont permis
de refaire surface.
Une si longue lettre m'a paru plus frais : c'est une lecture facile
et narrative. J'ai eu du mal néanmoins à ressentir une réelle
empathie. Je me suis un peu perdue dans les noms, les personnages, les
liens de parenté, et tout ce qui se rattache à la polygamie
: je ne comprends rien à l'acceptation des femmes de ce système.
Pour répondre à ma question S'agit-il de traditions ou
de lois ?, une recherche a bien sûr été effectuée
pour y répondre : lors du mariage civil, l'homme doit déclarer
s'il souhaite un régime monogame ou polygame ; ce choix est inscrit
dans l'acte de mariage et devient juridiquement contraignant ; le nombre
maximum d'épouses autorisé est quatre.
Dans les derniers chapitres, quand l'auteure parle d'amour et de tendresse,
à travers ses enfants entre autres, j'ai été plus
touchée. J'ai aimé l'écriture. Il y a peut-être
un espoir de voir la société évoluer, mais le chemin
est long si on pense que dans les années 80 elles en étaient
encore là, c'est à la limite du pathétique.
Mar
Quand j'ai commencé Une
si longue lettre,
je pensais qu'il allait parler de deuil, puisque le mari venait de mourir.
Mais en réalité, la narratrice avait déjà
traversé ce deuil depuis longtemps. Tandis que son entourage ne
voit en elle qu'un deuil convenu et presque performatif, elle, au contraire,
plonge dans son monde intérieur et partage avec son amie toute
la richesse de sa pensée. J'ai beaucoup aimé la prose, qui
m'a semblé très honnête, et j'ai admiré la
sincérité de la narratrice.
Malgré tout, le livre se termine sur une note d'espoir : elle garde
confiance en l'avenir, et croit encore qu'il lui reste du bonheur à
vivre.
Anne
Du fait de mon changement de travail, j'ai eu vraiment très peu
de temps pour lire cet été, et surtout j'étais trop
fatiguée, alors que le thème m'avait enthousiasmée,
avec un livre venant d'une île et l'autre de l'Afrique de l'Ouest.
Je n'ai pas réussi à rentrer dans
Une si longue lettre, tout en étant sensible à
la douceur de l'écriture.
Claire
Je rejoins tout ce qui a été dit de positif sur les deux
livres.
J'ai été tout de suite étonnée par l'écriture
de Une si longue lettre, son élégance, quelque chose
de hiératique (ça se dit pas pour l'écriture ?).
J'ai trouvé que la correspondance n'était pas un simple
artifice romanesque, car la relation entre les deux femmes et le parallèle
de leurs destins jouent un rôle narratif. J'ai été
vraiment intéressée de vivre de l'intérieur la foi
musulmane, la polygamie, le poids des parents, le rôle positif de
la colonisation à travers l'éducation, notamment l'accès
à d'autres cultures (qui permet de "nous faire apprécier
de multiples civilisations sans reniement de la nôtre"),
l'indépendance et ses combats, un progressisme alliée à
la fidélité à des "vertus anciennes"
et à la religion ("ma raison et ma foi rejetaient les pouvoirs
surnaturels") et - très fort - le rejet de "pesanteurs
millénaires". Marie-Yasmine m'a rappelé un gloups
que j'ai eu, heureusement ponctuel ("je pense que l'une des qualités
essentielles de la femme est la propreté"). Nous avions
lu Les
impatientes de Djaïli Amadou Amal, camerounaise, livre dont
le souvenir me semble moins littéraire et plus dur sur les mariages
; il est pourtant plus récent, avec une situation terrible pour
les femmes ; la question de Nelly m'a amenée à m'interroger
sur la polygamie au Sénégal (voir=>ici)
: j'ai trouvé ça dramatique.
Concernant La mémoire délavée, comme
Stéphanie j'ai apprécié l'objet (les images, le format,
le volume dans la main), comme Felina le papier, ainsi que la collection
("Traits et portraits" - des autoportraits ponctués d'illustrations
- collection dans laquelle j'ai lu L'Africain
de Le Clézio, dont j'avais visité la maison familiale à
l'île Maurice). Pour ma part, j'ai aimé le genre (ni essai
ni roman ni-ni-ni, ou et-et-et), l'écriture délicate
avec une construction relevant d'un tissage subtil, l'intérêt
de ce qui est narré, instructif comme plusieurs l'ont remarqué,
ainsi que les émotions, exprimées ou suscitées à
la lecture : j'ai vraiment admiré.
J'ai par ailleurs plongé dans d'autres livres d'auteurs africains
cet été et je n'avais plus envie de m'arrêter : Tout
s'effondre du Nigérian China Achebe, La
vie et demie du Congolais Sony Labou Tansi, Terre
somnambule du Mozambicain Mia Couto, Les
vies d'après du Tanzanien et Prix Nobel Abdulrazak Gurnah,
Le
pauvre christ de Bomba du Camerounais Mongo Beti et Une
vie de boy du Camerounais Ferdinand Oyono... J'ai ajouté
un texte d'une Afro-Américaine, la seule nouvelle écrite
par Toni Morrison, avec une postface de Zadie Smith plus longue que la
nouvelle, Récitatif,
qui raconte la relation de deux femmes qui se sont connues jeunes dans
un foyer et se retrouvent plusieurs fois au cours de leur vie : on ignore
laquelle est noire, laquelle est blanche, ce qui bien entendu interroge
la lectrice sur nos représentations....
|
Notre choix de lectures
d'été
|
Notre lecture commune
: un
classique de la littérature africaine et un livre contemporain
:
-
De Mariama
BÂ (sénégalaise, 1929-1981) Une
si longue lettre,
au programme des écoles et des universités à travers
le continent. D'abord publié aux Nouvelles
éditions africaines (créés par créées
par Léopold Sédar Senghor) en 1979, réédité
en 2001 dans la collection
"Motifs" des
éditions du Serpent à plumes (rachetées par les éditions
du Rocher), puis aux éditions Litos en 2023 (format poche des éditions
du Rocher), toujours dans la collection "Motifs" (176 p.) ;
traduit en 25 langues, dont le wolof en 2016.
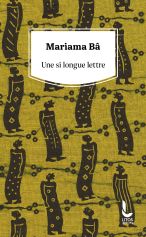

- De Nathacha
APPANAH
(de l'Ile
Maurice, née
en 1973),
La mémoire délavée, Mercure de France,
collection "Traits et portraits", 2023 ; réédité
en Folio en 2025, La
mémoire délavée, (160 p.)
| D'où vient cette idée de choix de lecture ? |
La découverte cette année du livre de Léa MORMIN-CHAUVAC sur Les sœurs Nardal : à l’avant-garde de la cause noire a été déterminante pour choisir ces deux livres : Une si longue lettre de la Sénégalaise Mariama BÂ et La mémoire délavée de la Mauricienne Nathacha APPANAH.
|
Tiens
! Des expos
|
L'Afrique et plus largement le monde noir sont l'objet d'une actualité artistique :
|
Au Centre
Pompidou
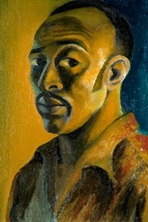 "Paris noir : circulations artistiques et luttes anticoloniales 1950-2000" du 19 mars au 30 juin 2025 |
À
la Bourse de Commerce
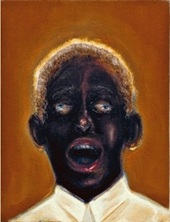
|
Au musée
de l'Homme
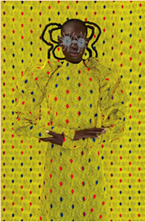 |
Au musée
du quai Branly 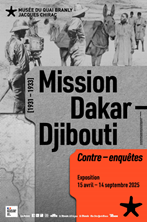 "Mission
Dakar-Djibouti [1931-1933] : Contre-enquêtes"
du 15 avril au 14 septembre
2025
|
|
Qu'avons-nous
déjà lu ?
|
Peu de livres africains depuis 17
ans que Lirelles existe :
- en 2017 : Crépuscule
du tourment de Léonora MIANO (auteure franco-camerounaise)
- en 2021 : Les
impatientes de Djaïli AMADOU AMAL (camerounaise)
Des livres aussi qui ont un rapport à l'Afrique où les
auteures ont vécu, la première au Kenya, la seconde en Afrique
du Sud ; mais elles ne sont pas africaines :
- en 2020 : Ombres
sur la prairie de Karen BLIXEN
- en 2021 : Ce
que je veux ne pas savoir de Deborah LEVY.
|
Sur les autrices et
le livre choisi
|
Quelques
échos pour chacune : presse écrite, radio, vidéo.
Pour Mariama BÂ
- Mariama
Bâ : sa "si longue lettre" aux femmes, Véronique
Tadjo, #CulturePrime, France 24, 9 juillet 2019, 3 min 10.
- "Une
si longue lettre de Mariama Bâ", Tirthankar Chanda,
Littérature classique africaine, RFI, 22 mars 2020, 4 min
39.
- Une
si longue lettre,
de la Sénégalaise Mariama Bâ, récit et
manifeste sur la condition féminine au Sénégal, Kidi
Bebey, Le Monde, 17 juillet 2021.
-"Une
si longue lettre, livre pionnier du féminisme africain",
épisode 1/4 de la série "Je suis noire et je n'aime
pas Beyoncé, une histoire des féminismes noirs francophones",
Perrine Kervran, LSD, France Culture, 7 juin 2021, 55 min.
- Le roman a été adapté en 5
épisodes de 29 min sur France Culture,
par Tidiane Thiang,
du 4 au 8 mars 2024.
- "Alain
Mabanckou explore Une si longue lettre de Mariama Bâ, œuvre
fondatrice du féminisme africain", podcast Les Admirations
littéraires, Xavier Pestuggia, France
Inter, 28 septembre 2025,
35 min.
- Un film, sorti au Sénégal
en 2025, Une si longue lettre
de
Angele Diabang : voir interview dans Le Point par Clémence
Cluzel, "Une
si longue lettre :
46 ans après, le roman de Mariama Bâ renaît au cinéma",
12 juillet 2025.
Et :
- son premier texte publié à 18 ans ›ici
- son autre livre publié : Un
chant écarlate.
- une étude critique : Mariama
Bâ : Une
si longue lettre, Bouba Tabti-Mohammedi,
éd. Champion, 2016
- la page
Facebook du Cercle des Adeptes de la Littérature de Mariama
Bâ.
Pour
Nathacha Appanah
- "Nathacha
Appanah présente son ouvrage La mémoire délavée",
Librairie Mollat, 20 août 2023, 6 min 48.
- "Dans
les pas des ancêtres migrants, avec Nathacha Appanah",
Tirthankar
Chanda, Les Chemins d'écriture,
RFI, 16 septembre 2023, 3 min 42.
- "La
mémoire délavée, de Nathacha Appanah : un retour
sur les traces familiales pour apaiser les douleurs passées",
Carine Azzopardi, France Info, 24 septembre 2023.
- Nathacha Appanah : "Je
me rends compte du balancier éternel de l’histoire qui nous
revient à chaque fois", Xavier Mauduit, Le Cours de
l'histoire, France Culture, 10 novembre 2023, 58 min.
- Le
Masque & la Plume, fasciné par La Mémoire
délavée de Nathacha Appanah, 11 décembre 2023.
- "L'inestimable
gageure de La Mémoire délavée de Nathacha
Appanah", Denys Laboutière, blog de Mediapart, 26 février
2024.
Et :
- ses nombreux autres livres, publiés par Gallimard ›ici
- le dernier, La
nuit au coeur, est sur trois listes de prix. Et, outre un passage
à la Grande Librairie, innombrables sont les émissions de
radio qui lui sont consacrées...
|
La
littérature d'une aire géographique
|
L'été 2018, nous avions expérimenté des lectures d'une grande aire géographique, en choissant parmi une sélection d'une spécialiste de la littérature : "Littérature chinoise contemporaine" (Chine continentale).
Pour cet immense continent qu'est l'Afrique, une
"mine" existe : une série
d'émissions remarquables de moins 5 min chacune sur RFI (Radio
France Internationale) par
Tirthankar Chanda : la série Littérature
classique africaine de
2020 (émission
d'où est extraite la carte africano-livresque ci-dessus)
a été suivie d'une autre série d'émissions,
Chemins
d'écriture,
consacrée aux écrivains d'Afrique et de la diaspora :
une émission toujours très courte chaque semaine, sans interruption
depuis quatre ans : au 1er juin 2025, c'est plus de
250 de ses émissions que l'on peut écouter sur la
littérature !
Tirthankar
Chanda a été
consulté pour Lirelles : il
travaille à RFI depuis 1994 ; il a également contribué
à Jeune Afrique, Le Monde diplomatique ; il a enseigné
les littératures postcoloniales de l'Inde et de l'Afrique à
l'université Paris 8 et à l'Inalco (Institut national des
langues et civilisations orientales).
Intéressante aussi est la
série estivale du Monde "À la (re)découverte
des classiques africains" de Kidi Bebey, journaliste, éditrice
et auteure française, née de parents camerounais, qui présente,
outre son article
sur Une si longue lettre, "Un
caprice de la nature,
de la Sud-africaine Nadine Gordimer" (1987), saga visionnaire
en Afrique du Sud à l'ère de l'apartheid et "Marou,
de la Botswanaise Bessie Head" (1971), un drame qui confronte
les sociétés d'Afrique australe à leurs propres démons.
Kidi Bebey a poursuivi sa chronique littéraire africaine dans Le
Monde : voir ses nombreuses contributions ›ici.
Par ailleurs, de 2006 à 2009, elle
a produit et animé sur RFI l'émission quotidienne Reines
d’Afrique, puis enchaîné avec la chronique L'Afrique
des femmes diffusée chaque matin sur France Culture.
Voici des suggestions complémentaires grâce aux émissions de Tirthankar Chanda présentant des livres d'autrices. Les pays représentés sont nombreux : Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ghana, Guinée, Kenya, Mali, Maurice, Nigeria, Sénégal, Somalie, Soudan, Tanzanie, Zimbabwe... On peut écouter les émissions, mais aussi lire le contenu - pratique ! - parfois même plus développé que l'émission. Les liens ci-dessous donnent accès aux émissions, à leur retranscription et à la présentation des livres sur le site de l'éditeur.
- D'abord, les émissions sur les autrices choisies
L'émission
: Une
si longue lettre de Mariama Bâ (sénégalaise),
22/03/2020, 04:39
Apologie poignante de l'égalité homme-femme dans la société
musulmane, Une si longue lettre de la Sénégalaise
Mariama Bâ est devenu un classique de la littérature africaine
moderne. Il est au programme des écoles et des universités
à travers le continent.
Le livre : Une
si longue lettre, éd. Litos, 176 p.
L'émission
: Dans
les pas des ancêtres migrants, avec Nathacha Appanah, 16/09/2023,
03:42
Nathacha Appanah est l'une des grandes voix des lettres françaises.
Née à Maurice en 1971, elle est l'auteure d'une dizaine
de romans dont les plus connus sont Les Rochers de Poudre d'or
qui l'a fait connaître et Tropique de la violence. Les relations
familiales, la mémoire, les questions géopolitiques sont
ses thèmes de prédilection. Elle vient de publier La
Mémoire délavée aux éditions de Mercure
de France, à mi-chemin entre biographie familiale et autofiction.
Le livre :
La mémoire délavée, Mercure de France, coll.
Traits et portraits, 2023, 160 p.
L'émission : Les
Rochers de Poudre d'Or par Nathacha Appanah (mauricienne), 23/08/2020,
04:45
Née à l'île Maurice, Natacha Appanah a travaillé
dans l'édition, la publicité et la presse, avant de se lancer
dans l'écriture. Considérée aujourd'hui comme l'une
des écrivains majeurs de Maurice, la romancière a à
son actif neuf livres aux tonalités très différentes.
Ses thématiques vont des heurs et malheurs de son île natale
aux enfants fugueurs à Mayotte "impatients d'échapper
à la gravité de leurs destins", en passant par les
dysfonctionnements passionnels au sein des familles en France où
l'écrivaine vit depuis 1998.
Le livre : Les
rochers de Poudre d'Or, Folio, 240 p.
L'émission : Descente
dans les creux et les failles de la conscience, avec la Mauricienne Nathacha
Appanah, 18/09/2021, 04:07
Journaliste de formation, la Mauricienne Nathacha Appanah s'est fait connaître
en 2004 en publiant son premier roman Les rochers de Poudre d'or.
Son œuvre, riche de huit romans, frappe par sa cohérence thématique
et esthétique. Les traumatismes de l'histoire, le drame intime,
la violence sont les thèmes privilégiés de ses récits,
admirablement servis par une écriture lyrique et précise.
Son nouveau roman Rien ne t'appartient est l'un des ouvrages incontournables
de cette rentrée littéraire 2021.
Le livre : Rien
ne t’appartient, Gallimard, 160 p. ; rééd.
Folio, 2023
- D'autres émissions sur des autrices
De Côte d'Ivoire
L'émission : Retour
sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, avec la Franco-Ivoirienne
Véronique Tadjo, 06/10/2024 - 07:17
Poète, romancière, peintre, Véronique Tadjo a une
vingtaine de livres à son actif. Elle est connue pour ses albums
pour la jeunesse qu'elle illustre elle-même. Véronique Tadjo
est à l'honneur ce dimanche dans Chemins d'écriture,
à l'occasion de la sortie cet automne de son nouveau roman Je
remercie la nuit, paru aux éditions Mémoire d'encrier.
Le livre : Je
remercie la nuit, éd. Mémoire d’encrier, 302
p.
D'Afrique du Sud
L'émission : Fille
de Burger de
Nadine Gordimer (prix Nobel), 09/05/2020, 05:00
Célèbre romancière de l'Afrique du Sud, prix Nobel
de littérature 1991, disparue en 2014, Nadine Gordimer avait fait
de sa fiction un puissant outil de dénonciation des brutalités
perpétrées par son gouvernement contre la population noire
du temps de l'apartheid. Paru en 1979, son septième roman, Fille
de Burger, met en scène l'héritage intellectuel d'un
grand activiste anti-apartheid qui a réellement existé,
tout en s'interrogeant sur le coût humain et familial de l'engagement
politique. Ce roman est l'un des grands livres sous la plume de la magistrale
chroniqueuse des heurs et malheurs de son pays que fut Gordimer.
Le livre : Fille
de Burger, trad. de l'anglais Guy Durand, Points, 528 p.
Un autre livre de Nadine Gordimer : Le
conservateur, Grasset, coll. Les Cahiers Rouges, 378 p.
Du Cameroun
L'émission : Dans
le chaos tragique de l'existence humaine, avec Hemley Boum, 13/02/2021
- 03:50
La romancière camerounaise Hemley Boum est
l'auteure de quatre romans. Son dernier opus, Les Jours viennent et
passent (Gallimard, 2019), a été couronné en
2020 par le prestigieux prix Ahmadou-Kourouma, qui récompense tous
les ans un auteur d'expression française. "Chemins d'écriture"
revient ce samedi sur le parcours peu commun de cette auteure talentueuse,
héritière de la tradition littéraire camerounaise
caractérisée par son goût pour l'ironie, la subversion
et l'engagement social.
Le livre : Les
jours viennent et passent, Folio, 416 p.
L'émission : Entre
le Cameroun et la France, avec la Franco-Camerounaise Kiyémis,
28/04/2024 - 03:58
Poétesse, afro-féministe, bloggeuse, la Franco-Camerounaise
Kiyémis est une trentenaire aux multiples talents. Elle vient de
publier ces jours-ci Et, refleurir, un roman inspiré de
la trajectoire riche en témérités féministes
et en rêves d'ailleurs de sa grand-mère maternelle.
Le livre : Et,
refleurir, éd. Philippe Rey, 382 p.
Du Sénégal
L'émission : Le
Ventre de l'Atlantique par
Fatou Diome, 26/07/2020, 04:17
En 2003, avec son premier roman Le Ventre de l'Atlantique, la Sénégalaise
Fatou Diome faisait une entrée fracassante en littérature.
Il s'agissait d'un brillant premier roman, de construction maîtrisée
jusque dans ses exubérances. À la fois caustique et tragique,
le livre raconte "l'aventure ambiguë" d'une jeune femme
sénégalaise, ballottée entre l'Europe qui la rejette
car elle est Noire et son Afrique natale où elle n'a connu que
le malheur et la honte à cause de sa naissance hors mariage. Étrangère
partout, Salie, qui est aussi un peu Fatou Diome, cherche son territoire
sur la page blanche devenue son ultime refuge.
Le livre :
Le
ventre de l'Atlantique, Le Livre de poche, 256 p.
L'émission : Dans
le ventre de la vie, avec la romancière Fatou Diome,13/03/2021
03:53
Vingt ans après La Préférence nationale, le
premier recueil de nouvelles révélant le talent de conteuse
hors pair de Fatou Diome, la Franco-Sénégalaise renoue avec
l'art de la fiction courte en publiant sa dernière collection de
nouvelles. De quoi aimer vivre regroupe dix récits brefs,
bâtis autour des éclopés de la vie et racontés
avec un sens d'urgence et de drame. La Strasbourgeoise Fatou Diome est
aujourd'hui l'auteure d'une œuvre littéraire majeure, composée
d'une dizaine de titres, dont son premier roman, Le Ventre de l'Atlantique,
l'un des plus grands succès de librairie africains de ces vingt
dernières années.
Le livre : De
quoi aimer vivre, Albin Michel, 2021, 233 p.
Du Nigéria
L'émission : L'Autre
moitié du soleil par Chimamanda Ngozi Adichie, 05/04/2020,
04:00
Héritière de la grande tradition littéraire du Nigeria,
Chimamanda Adichie est une grande voix de l'Afrique anglophone. Son superbe
roman tolstoïen sur la guerre du Biafra, L'Autre moitié
du soleil, est entré dans le répertoire des classiques
de la littérature contemporaine.
Le livre : L'autre
moitié du soleil, trad. de l'anglais Mona de Procontal,
Folio, 672 p.
Et aussi Americanah,
trad. de l'anglais Anne Damour, Folio, 704 p.
Nous
sommes tous des féministes, Folio, 80 p.
L'émission : Littérature
: descente dans les bruits et la fureur de Lagos, avec Tola Rotimi Abraham,
27/11/2021, 03:37
Passée par le programme d'écriture créative de l'université
d'Iowa aux Etats-Unis, la Nigériane Tola Rotimi Abraham nous livre
avec son premier roman, Black Sunday, un ouvrage de fiction étonnamment
abouti. Un début prometteur.
Le livre : Black
Sunday, trad. de l'anglais Karine Lalechère, éd.
Autrement, 327 p.
L'émission : Le
jugement de Salomon, revu et corrigé par la Nigériane Oyinkan
Braithwaite, 18/11/2023 - 03:56
Avec un premier roman devenu un best-seller international, la romancière
nigériane Oyinkan Braithwaite est une figure montante des lettres
nigérianes modernes. L'Une ou l'Autre, son second roman
qui vient de paraître en français, est une réécriture
grinçante mais réactualisée du jugement de Salomon.
Antique et moderne.
Les livres :
- L’Une
ou l’Autre, trad. de l’anglais Christine Barbaste, éd.
La Croisée, 152 p.
- Ma
soeur, serial killeuse, éd. La Croisée, 244 p.
L'émission : Dans
la chaleur et la poussière du Londres noir, avec Bernardine Evaristo
(britannique et nigérianne, née en 1959), 12/03/2022, 03:46
Première femme noire à recevoir le Booker Prize en
2019 avec son magistral Fille, femme, autre, Bernardine Evaristo
domine la littérature britannique du haut de son écriture
délicieusement subversive. La parution en traduction française
de Mr. Loverman, l'un des précédents romans de la
Britannique racontant le "coming out" d'un dandy caribéen
dans le Londres d'aujourd'hui, est une belle occasion de découvrir
ou de redécouvrir la plume aux mille talents de cette écrivaine
militante de la cause noire. La voix de l'héroïne
est annonciatrice des douze voix de femmes dans Fille, femme, autre,
roman, qui a fait la renommée littéraire de "Mrs Evaristo".
Le livre : Mr.
Loverman, trad. de l’anglais Françoise Adelstain,
éd. Globe, 302 p, rééd. Pocket, 360 p. (publié
en 2013), traitant de l'homosexualité masculine.
Et aussi : Fille,
femme, autre (Girl, Woman, Other, 2019), Pocket, 576 p.
 Pour
ce livre :
Pour
ce livre :  l'auteure a été colauréate du Booker Prize en 2019,
conjointement avec l'écrivaine canadienne Margaret Atwood (pour
Les
testaments). De 19 à 96 ans, Amma, Dominique, Yazz, Shirley,
Carole, Bummi, LaTisha, Morgan, Hattie, Penelope, Winsome, Grace, "douze
femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté,
chacune à sa manière, d'un bout de siècle à
l'autre".
l'auteure a été colauréate du Booker Prize en 2019,
conjointement avec l'écrivaine canadienne Margaret Atwood (pour
Les
testaments). De 19 à 96 ans, Amma, Dominique, Yazz, Shirley,
Carole, Bummi, LaTisha, Morgan, Hattie, Penelope, Winsome, Grace, "douze
femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté,
chacune à sa manière, d'un bout de siècle à
l'autre".
Auteure de quatre romans et d'un recueil de nouvelles, Chika Unigwe partage sa vie entre le Nigeria et les États-Unis où elle vit aujourd'hui après avoir habité pendant une quinzaine d'années la Belgique. Son roman, On Black Sisters' Street, qui vient de paraître en français sous le titre Fata Morgana, a imposé cette écrivaine comme l'une des voix majeures des lettres africaines.
L'émission : Dans le sillage des femmes puissantes, avec Chika Unigwe, 14/05/2022 - 03:20
Premier roman de la Nigériane Chika Unigwe à paraître en français, Fata Morgana raconte les trajectoires riches en drames et en rêves de quatre prostituées africaines échouées sur les trottoirs d'Europe occidentale. Victimes des circonstances tragiques de la vie, mais aussi du chaos qui règne dans leurs pays, elles tentent de reprendre avec le courage du désespoir la maîtrise de leur vie. Un roman poignant et puissant.
Le livre : Fata Morgana, trad. de l'anglais Marguerite Capelle, éd. Globe, 300 p. (publié en 2007 publié en néerlandais en 2008 et par la suite publié en anglais). L'histoire de Sisi, Ama, Efe et Joyce qui ont quitté le Nigeria...

Du Zimbabwe
L'émission : Les
Vierges de pierre de Yvonne Vera (zimbabwéenne de langue
anglaise), 17/05/2020, 04:47
Disparue en 2005, à l'âge de 40 ans, la romancière
zimbabwéenne Yvonne Vera est l'auteure d'une œuvre littéraire
brève mais prometteuse d'inventivité et de poésie.
Cette œuvre, composée de 5 romans et un recueil de nouvelles,
explore les drames de l'histoire contemporaine du continent africain à
travers le vécu des femmes, réduites trop longtemps à
la domesticité et au silence. Récit tragique de la terrible
guerre civile qui a ensanglanté le Zimbabwe au début de
son indépendance, son dernier roman Les Vierges de pierre est
un chef-d'œuvre représentatif du style éclaté
et puissamment poétique de son auteure.
Le livre : Les
vierges de pierre, trad. de l’anglais Geneviève Doz,
Fayard, 234 p.
L'émission : Dans
le zoo politique du Zimbabwe, avec NoViolet Bulawayo [1/2], 02/09/2023
- 06:14
Romancière zimbabwéenne, NoViolet Bulawayo illumine la rentrée
étrangère 2023 avec son second roman Glory, un récit
allégorique de l'histoire du Zimbabwe. Original, inventif et drôle,
ce livre est une réécriture d'Animal Farm du Britannique
George Orwell. Dans les rôles principaux, un cheval, une ânesse,
un cochon et des chiens habillés en tuniques de toutes les couleurs.
L'émission : Dans
la ferme des animaux, version zimbabwéenne, avec NoViolet Bulawayo
(2/2), 09/09/2023 - 07:12
Dans ce second volet de la chronique consacrée à la romancière
NoViolet Bulawayo et à son nouveau roman Glory, il est question
des lendemains qui déchantent au Zimbabwe et de leur représentation
sous la plume inventive d'une romancière montante, bourrée
de talents. Avec deux romans à son actif et une grande intelligence
narrative, la Zimbabwéenne s'impose comme une nouvelle star dans
le firmament des lettres africaines.
Le livre : Glory,
trad. de l’anglais Claro, éd. Autrement, 449 p.
L'émission : À
fleur de peau par Tsitsi Dangaremgba, 02/08/2020, 04:05
Considérée comme une des figures de féminisme africain,
la Zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga a acquis une notoriété
internationale en 1988, en publiant son roman culte À fleur
de peau. C'est un récit autofictionnel qui raconte, à
travers les heurs et malheurs de son héroïne Tambudzai, les
discriminations contre les femmes dans la société patriarcale
au Zimbabwe. À fleur de peau est le premier volume d'une
trilogie, dont le dernier volet intitulé This Mournable Body
a été sélectionné pour le Booker Prize 2020,
prestigieux prix littéraire britannique.
Le livre : À
fleur de peau, trad. de l’anglais Etienne Galle, Albin Michel,
267 p. (indisponible)
L'émission : Tsitsi
Dangarembga, romancière, cinéaste et militante féministe
05/12/2020 03:45
Tsitsi Dangaermbga est la grande dame des lettres zimbabwéennes.
Elle s'est fait connaître en publiant en 1988 son premier roman
Nervous conditions. "Le livre que nous avons tant attendu
et que nous devrions tous lire", disait Doris Lessing de ce premier
roman. Tsitsi Dangarembga est aussi cinéaste et militante féministe
et politique.
Le livre : Ce
corps à pleurer, trad. de l'anglais par Nadine Carré,
Mémoire d'encrier, 455 p.
L'émission : L'Afrique
fantôme, selon Tsitsi Dangaremgba (1/2), 27/01/2024 - 03:57
La Zimbabwéenne Tsitsi Dangaremgba est romancière, mais
aussi dramaturge, cinéaste, militante féministe. Son œuvre,
partagée entre le politique et l'intime, puise son inspiration
dans les failles de la société zimbabwéenne, préférant
montrer les corruptions à l'œuvre, attirant l'attention sur
leurs impacts sur les êtres et les choses, plutôt qu'à
simplement les critiquer. Son dernier roman Ce corps à pleurer,
récemment traduit en français, renoue avec les thèmes
de la discrimination sociale et des violences patriarcales qui ont fait
le succès de son chef-d'œuvre Nervous conditions, lauréat
du Commonwealth Writer's Prize.
Le livre : Ce
corps à pleurer, trad. de l’anglais Nathalie Carré,
éd. Mémoire d’Encrier, 455 p.
Littérature
: l'Afrique fantôme, selon Tsitsi Dangaremgba (2/2), 03/02/2024
- 07:27
Paru en 2020 en Angleterre et disponible depuis peu en traduction française,
Ce Corps à pleurer est le dernier volet de la trilogie romanesque
de la Zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga. Tambudzai, protagoniste
de la trilogie, avait autrefois de grands rêves, mais elle est rattrapée
aujourd'hui par la réalité du Zimbabwe postcolonial où
se déroule l'action du nouveau roman. Gagnée par l'amertume
et la frustration, elle voit ses rêves s'effilocher au fil des crises
qui frappent son pays. Elle tente de survivre au jour le jour.
De l'île Maurice
L'émission :
La Mauricienne Ananda Devi raconte le "Fardo" millénaire
des femmes, 03/10/2020, 03:39
Le nouveau livre sous la plume de la romancière mauricienne Ananda
Devi n'est pas un roman, mais un exercice original d'écriture publié
en coédition avec le musée des Confluences à Lyon.
Inspiré de la rencontre de l'auteure avec la momie d'une femme
péruvienne, précolombienne, qui a vécu il y a trois
mille ans, Fardo est un texte à mi-chemin entre anthropologie,
histoire et réflexion sur l'art et l'écriture. Original
dans sa forme, ce livre renoue toutefois avec les thématiques obsédantes
de l'œuvre d'Ananda Devi, qui vont de la condition féminine
à la violence sociale, en passant par la prise de parole par ceux
qui n'ont pas droit à la parole. "Chemin d'écriture"
brosse le portrait de cette autrice prolifique et féministe qui
a fait de la littérature son outil d'exploration des continents
de souffrances.
Le livre : Fardo,
co-édition Cambourakis et Musée des Confluences, 65 p.
L'émission : Réfléchir
sur le mystère de l'écriture, avec la Mauricienne Ananda
Devi, 02/04/2022 - 07:12
On ne présente plus Ananda Devi. Figure majeure de l'espace littéraire
francophone, cette romancière d'origine mauricienne est l'auteure
d'une vingtaine de livres dont des romans, des recueils de nouvelles et
de poésies, des récits. Son œuvre primée, célébrée,
est enseignée dans les écoles et les universités
de l'île Maurice et du monde. Elle vient de publier un essai sur
l'écriture intitulé Deux malles et une marmite et
un nouveau roman.
Les livres :
- Deux
malles et une marmite, éd. Project’îles, 2021,
127 p.
- Le
rire des déesses, Grasset, 2021, 240 p. ; rééd.
Livre de poche, 2024, 264 p.
L'émission : "Apocalypse
Now", revu et corrigé par la Mauricienne Ananda Devi,
21/10/2023 - 04:21
Ananda Devi est la grande dame des lettres mauriciennes. Désignée
"Voix de Maurice" par Le Clézio, elle raconte dans son
nouveau roman les dérives de son île, où les bouleversements
tectoniques s'ajoutent à l'avidité des hommes, menaçant
de plonger le pays dans le chaos total. Fable sur la fin de la civilisation
humaine, ce récit futuriste met en scène les caméléons
qui attendent en coulisses que les humains finissent par s'autodétruire
pour prendre leur place.
Le livre : Le
jour des caméléons, Grasset, 272 p.
L'émission : Dans
la prison-musée de Montluc, avec la Franco-Mauricienne Ananda Devi,
25/08/2024, 04:50
"Aussitôt, le poids de la prison de Montluc s'installe,
tel un oiseau lourd et familier, sur mes épaules", écrit
la romancière Ananda Devi dans son nouveau livre, inspiré
de son passage à la prison lyonnaise où elle a passé
une nuit blanche, à l'invitation de son éditeur.
Le livre : La
nuit s’ajoute à la nuit, Stock, coll. "Ma nuit
au musée", 293 p.
Du Rwanda
L'émission : La
quête de la langue perdue et retrouvée, avec Beata Umubyeyi
Mairesse, 03/09/2022 - 03:40
Lauréate 2020 du Prix des Cinq continents de la Francophonie pour
son premier roman, la Franco-Rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse s'est imposée
comme l'une des voix majeures de la littérature africaine contemporaine.
Elle publie cet automne son deuxième roman, Consolée,
qui raconte, à travers la dérive mentale et physique d'une
vieille dame énigmatique à la peau cuivrée, la colonisation
et ses séquelles dramatiques sur les vies.
Le livre : Consolée,
éd. Autrement, 376 p.
L'émission : (1/2) Dans
les confins des mémoires étiolées, avec la romancière
Beata Umubyeyi Mairesse, 12/05/2024
Issue de la génération marquée à tout jamais
par le génocide des Tutsi, l'écrivaine franco-rwandaise
Beata Umubyeyi Mairesse puise autant dans son vécu personnel que
dans l'histoire collective de son pays le matériau de son œuvre
littéraire. C'est une œuvre qui se veut à la fois témoignage
et méditation sur la lente descente de tout un peuple dans l'enfer
génocidaire. A 45 ans, Béata Mairesse est l'auteure d'une
dizaine d'ouvrages dont Le Convoi, à mi-chemin entre récit
et (en)quête, qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
Le cheminement littéraire de cette auteure, considérée
comme l'une des plumes les plus talentueuses des lettres rwandaises contemporaines,
et son nouvel opus sont au menu de la chronique littéraire africaine
de ce dimanche.
L'émission : (2/2) Beata
Umubyeyi Mairesse, incontournable interprète des soubresauts de
la postcolonie rwandaise, 19/05/2024 - 04:14
La romancière franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse est une
survivante du génocide contre les Tutsis dont nous commémorons
cette année le trentième anniversaire. Avec son nouvel ouvrage,
Le Convoi, qui n'est pas un roman, elle livre le récit à
la fois politique et intime de sa traversée de l'enfer génocidaire.
Elle raconte sa propre histoire de fuite et de délivrance en l'inscrivant
dans la grande histoire de la réappropriation de la mémoire
collective par les dominés et les colonisés du monde.
Le livre : Le
Convoi, Flammarion, 333 p.
Du Ghana
L'émission : Eloge
des femmes irrévérencieuses, avec la Ghanéenne Peace
Adzo Medie, 23/09/2023 - 06:27
Universitaire spécialisée dans la politique internationale
et des sujets liés à la question du genre, la Ghanéenne
Peace Adzo Medie signe avec Sa seule épouse un premier roman
lucide et ironique sur le patriarcat. Récit sentimental et social,
ce passionnant tourne-page, riche en intrigues et frustrations, flirte
avec les conventions des romans à l'eau de rose pour raconter le
vécu des femmes africaines contemporaines aux prises avec les préjugés
anti-féministes de leurs sociétés.
Le livre : Sa
seule épouse, trad. l’anglais Benoîte Dauvergne,
éd. de l’Aube, 304 p.
De la Somalie
L'émission : À
la recherche de la patrie imaginaire, avec la Somalo-Italienne Ubah Cristina
Ali Farah, 29/07/2023 -04:14
Romancière, poète, scénariste, librettiste, l'Italienne
d'origine somalienne Ubah Cristina Ali Farah est l'une des figures montantes
de la littérature postcoloniale et de la migration. Titulaire d'un
doctorat sur la culture populaire somalienne, elle partage sa vie entre
l'enseignement, l'écriture et des projets associatifs interculturels.
Elle a trois romans à son actif dont le premier, Madre piccola,
vient de paraître en traduction française aux éditions
Zulma.
Le livre : Madre
piccola, trad. de l’italien François-Michel Durazzo,
Zulma, 345 p.
De Madagascar
L'émission : Dans
l'engrenage de la conquête coloniale à Madagascar, avec Michèle
Rakotoson, 23/07/2022 - 07:37
Dans son nouveau roman Ambatomanga, la romancière malgache
Michèle Rakotoson raconte la conquête coloniale de son pays
au XIXe siècle, revisitant à travers la fiction les brutalités
et la dévastation dont sa société ne s'est pas encore
totalement remise. Auteure de plusieurs ouvrages de théâtre,
nouvelles, essais, récits et romans, elle puise l'essentiel de
son inspiration dans les réalités à la fois dramatiques
et exaltantes de son Madagascar natal.
Le livre : Ambatomanga
: le silence et la douleur, éd. Atelier des nomades, 2021,
268 p.
Programmation des années précédentes – Liens – Nous contacter