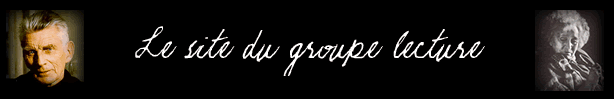
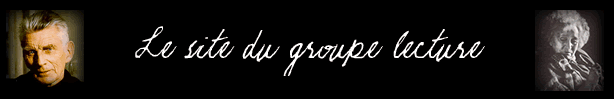 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Quatrième
de couverture : Dans une traduction extrêmement
élégante d'André Beaujard, nous présentons
au lecteur français un des plus beaux livres de la littérature
japonaise, les Notes de chevet de Sei Shônagon. Composées
dans les premières années du XIe siècle,
au moment de la plus haute splendeur de la civilisation de Heian,
au moment où Kyôto s'appelait Heiankyô, c'est-à-dire
"Capitale de la Paix", par une dame d'honneur, Sei Shônagon,
attachée à la princesse Sadako, laquelle mourut
en l'an 1000, les Notes de chevet appartiennent au genre sôshi,
c'est-à-dire "écrits intimes". Avec Les
heures oisives de Urabe Kenkô et les Notes de ma
cabane de moine de Kamo no Chômei, les Notes de chevet
de Sei Shônagon proposent, sous forme de tableaux, de portraits,
d'historiettes, de récits, une illustration du Japon sous
les Fujiwara. Morceaux choisis
des Notes de chevet, trad. André Beaujard : Quatrième
de couverture : Haruha akebono : "Au printemps,
l'aurore." Tous les Japonais connaissent par cœur l'ouverture
du Makura no sôshi (les Notes de chevet), fleuron de la littérature
ancienne dû à une dame de cour de l'an mille. Ses premières
phrases évoquent un paysage en mouvement : cycle des
saisons, parcours du soleil, traînées de nuages, vol
de lucioles ou d'oies sauvages. La toile de fond de montagnes à
la lumière changeante place d'emblée les fastes du
palais de Heian-kyô (l'actuelle Kyôto), que le lecteur
s'apprête à découvrir, sous le signe de la fugacité
des phénomènes et de sa conséquence immédiate,
le mono no aware, "la poignante mélancolie des
choses". Corinne Atlan Le site de Corinne Atlan : ›www.corinne-atlan.fr/ Première parution
Gallimard en 1966, Gallimard / Unesco :
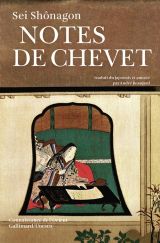
La première édition,
en 1934, était la thèse complémentaire du traducteur
André Beaujard, diplômé de l’École
des Langues Orientales, présentée à la Faculté
des Lettres de l’Université de Paris, publiée par
la Librairie Orientale et Américaine Les NOTES DE CHEVET André Beaujard a également
publié Sei Shônagon, son temps et son œuvre (Une
femme de lettres de l'ancien Japon), préface de Michel
Revon, ancien professeur à la Faculté de Droit de Tokyo,
professeur à la Faculté des Lettres de Paris, Encore plus ancien : Les Notes de l'oreiller,
première traduction intégrale du japonais, par Kuni-Matsuo
et Steinilber-Oberlin, Stock, Delamain et Boutelleau, 1928. Notre
traducteur André Beaujard précisera que la traduction
laisse de côté un tiers du livre. |
Sei SHÔNAGON
(vers 966, après 1025)
|