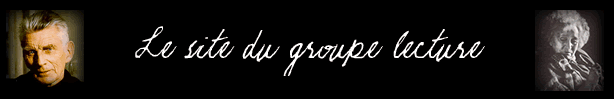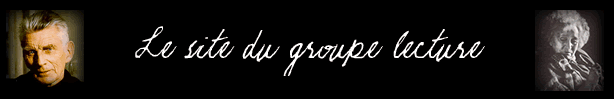|
Cycle
1




Cycle
2





Cycle
3





Cycle
4

|
|
Aki Shimazaki
Nous avons lu en janvier 2021 un livre
au choix, ou mieux encore, un cycle de 5 romans
courts. Les échanges ont lieu à
distance...
| 16
ROMANS EN 20 ANS, tous publiés chez Léméac
au Québec et Actes
Sud. |
|
Premier cycle
|
Deuxième cycle
|
Troisième cycle
|
Quatrième
|
|
|
|
|
cycle
(un titre publié actuellement)
|
|
|
|
|
- 2019 : Suzuran
|
|
|
Annick L (avis
transmis) (avis
transmis)
Je regrette beaucoup de ne pas
partager ce moment avec vous, d'autant que j'ai un véritable coup
de cœur pour cette œuvre romanesque singulière. J'ai
dévoré les dix premiers tomes des deux coffrets (Le
poids des secrets, Au cœur
du Yamato) et je viens d'acheter les cinq derniers que je suis
impatiente d'ouvrir. Cette Japonaise qui a quitté son pays pour
vivre au Japon y a consacré 20 ans de sa vie : le premier
tome est paru en 1999 et le dernier en 2019 ! Et cette fresque balaie
presque tout le 20e siècle : la première histoire remonte
aux années 1920 avec ces Coréens qui ont fui leur pays colonisé
par le Japon. La composition de cette saga est tout à fait originale,
chaque coffret de 5 titres a une unité thématique et se
lit comme la reconstitution d'une histoire à travers les points
de vue contrastés des différents protagonistes ou témoins.
Le premier autour des traumatismes liés à l'histoire belliqueuse
et impérialiste du Japon, à l'extérieur et à
l'intérieur de ses frontières. Le second, qui se situe après-guerre,
est centré sur les contraintes que subissent les individus de la
part de leurs entreprises, ou de la société plus largement,
au détriment de leur vie personnelle et familiale. Mais ces thèmes
ne sont jamais développés de façon abstraite :
ils sont illustrés par des récits de vie. Et j'adore cette
façon de nous raconter toutes ces histoires individuelles, dont
les pièces s'imbriquent comme un puzzle. Tout cela constitue en
soi déjà une initiation très vivante et contrastée
(puisque les personnages se positionnent de façon différente)
à la culture et à la société japonaise.
Mais ce qui m'a fait plonger de façon addictive dans cette série
de petits romans faciles à lire c'est le talent de l'auteure. J'adore
cette façon de raconter des histoires, toujours d'un point de vue
subjectif, d'un Je à l'autre, d'un protagoniste à l'autre,
sans interférence de commentaires ou d'analyses surplombant le
récit. Si bien que le lecteur, en quête de sens sur les enjeux
historiques ou sociétaux, progresse pas à pas, volume après
volume, dans une sorte de compréhension intime des drames évoqués.
Un art de la polyphonie vraiment remarquable !
Et puis j'aime ce genre d'écriture dépouillée, fluide,
mais jamais désincarnée qui me fait penser à Annie
Ernaux. Une simplicité apparente qui est le fruit d'un travail
littéraire indéniable. Avec une petite note exotique, très
japonaise dans l'évocation de la nature, du passage des saisons,
de la symbolique poétique des fleurs et des plantes qui a donné
naissance aux titres des romans, rattachés aux personnages. Saluons
d'ailleurs au passage la beauté de ces coffrets et des couvertures…
qui feront de jolis cadeaux !
Ce que je trouve extraordinaire enfin, c'est la portée universelle
de ces histoires humaines, qui dépasse le contexte spécifique
de ce pays : tensions entre la vie professionnelle et la vie familiale,
entre le désir et l'habitude dans le couple, hypocrisie et pression
des conventions bourgeoises, etc.
Peut-être cela tient-il à la distance qu'a prise Aki Shumazaki
pour observer son pays d'origine depuis le Québec. Sans oublier
la langue française qu'elle a choisie pour écrire son œuvre.
Trois fois ouvert !!!
Je vous souhaite des échanges passionnants autour de cette pépite.
Et je remercie le groupe pour cette découverte.
Nathalie (avis transmis)
(avis transmis)
J'ai lu les deux premiers textes de la série du Poids
des secrets. J'ai aimé lire le
premier. J'ai poursuivi avec plaisir. L'écriture transmet à
petites touches, la douleur, le manque et la perte. Elle sait nous donner
accès à l'intime sans développement. Elle est pour
moi toute de grâce et de légèreté et laisse
voir plus qu'elle ne dit. C'est très suggestif et cela permet facilement
à la lectrice que je suis de "voyager" à l'arrêt.
J'ai été très émue par ces personnages, par
l'alternance des duos, des trios, par ces vies mêlées, entremêlées
et ces alliances qui se forment ou ne se forment pas, au gré des
interdits sociaux (la jeune mère à laquelle on refuse le
mariage parce qu'elle est d'origine douteuse, l'amour impossible entre
le frère et la sœur..., le rapprochement des deux familles
par le biais des maisons mitoyennes), par l'évocation de la catastrophe
nucléaire. J'ai réalisé que ma fille était
née exactement 50 ans après l'explosion de Nagasaki. Je
me suis dit que ce jour-là, j'avais sûrement dû entendre
parler de ce terrible anniversaire, mais je ne m'en souviens plus. Le
parti pris du changement de points de vue donne terriblement envie de
se procurer les trois autres de la série (ce que je ne manquerai
pas de faire dès que j'aurai du temps de libre).
J'ai également beaucoup aimé l'évocation de l'intimité
des couples (les scènes sont très pures et très visuelles).
La beauté des corps enlacés, la blancheur des peaux, la
précision des gestes amoureux. Il y a quelque chose de l'ordre
du conte dans ce texte. Les apparences ne sont pas ce que l'on croit,
les transgressions sont nombreuses (amour incestueux, présence
des témoins silencieux qui épient et accèdent à
des informations interdites..). Bref, c'est une belle découverte.
Katell
Sur les conseils de Claire, j'ai lu cet été trois ou quatre
(je ne me souviens plus...) livres du cycle Le poids
des secrets. J'ai profité d'un séjour à Arles
pour aller les acheter dans la librairie Actes Sud : ce sont de jolis
objets avec des couvertures très réussies. Mais à
plus de six mois de lecture, hélas, il ne m'en reste pas grand
chose... Je me souviens d'une écriture simple mais pas simpliste,
assez fluide, étonnante même dans sa simplicité. Que
chaque roman prenait le point de vue d'un.e protagoniste et que l'action
se situait pendant Hiroshima. Au même moment, Arte diffusait un
documentaire sur Hiroshima,
qui me permettait de mettre des images sur les événements
du livre. Je me souviens d'avoir apprécié ma lecture et
que j'ai pu la recommander et/ou prêter les livres. Mais ce sont
les seuls souvenirs qu'il me reste. Alors j'ouvre à moitié.
Fanny (avis transmis)
(avis transmis)
Voici mon avis histoire de vous accompagner à distance. Bel échange
à vous en attente de vous lire.
J'ai lu les trois premiers du cycle 1 : Tsubaki,
Hamaguri
et Tsubame.
Au tout début de ma lecture, je dois dire que j'ai eu un peu de
mal à entrer dans le roman. Ce n'est pas la première fois
que je constate cet effet avec la littérature japonaise, comme
si pour moi le décalage culturel venait freiner ma capacité
à m'imprégner de récit, à me sentir en quelque
sorte concernée par l'histoire. Ce premier mouvement est assez
limitatif j'en ai conscience, pourquoi faudrait-il se sentir culturellement
proche pour éprouver de la curiosité, de l'intérêt,
et de l'empathie ?
Assez vite cependant j'ai été prise par ma lecture, et j'ai
d'ailleurs lu le troisième quasiment d'une traite.
La lecture a été pour ma part instructive sur l'histoire
du Japon et de la Corée, avec une vue de l'intérieur mêlant
les différents protagonistes dans une vision qui m'est apparue
comme n'étant pas manichéenne.
J'ai été touchée par les différents personnages,
peut-être en particulier par la mère de Yukio à travers
son dilemme et son choix de taire ses origines. J'ai trouvé très
émouvante sa rencontre avec la vieille dame à qui elle se
confie.
Enfin sur le plan de la construction, j'aime bien cette composition en
mosaïque où les histoires au fil des générations
viennent s'imbriquer. Il y a l'effet de surprise à chaque commencement,
de qui va y-on découvrir l'histoire cette fois-ci ? Tout comme
dans
Le quatuor d'Alexandrie, j'aime aussi ce procédé
qui permet de découvrir une même trame à travers le
regard singulier de chacun des protagonistes.
J'ouvre aux ¾. Je vais me plonger dans André
Breton pour les jours à venir, mais avec l'envie de revenir
ensuite sur la fin de ce premier cycle.
Marie-Christine
 (avis
transmis) (avis
transmis)
J'ai lu Zakuro...
délicat et magnifique.
Quelle découverte cette Aki Shimazaki !
Une immersion dans un Japon de tradition et de modernité..., j'ai
adoré !
Danièle (avis
transmis) (avis
transmis)
Contrairement au dernier livre de Martin Walser
lu dans le groupe, où je n’arrêtais pas de noter des
citations tellement le livre était foisonnant et bien écrit,
pour ce livre-ci (Hotaru
dans Le poids des secrets) pas une seule citation à se mettre
sous la dent, sauf, bien sûr, l’image symbolique et fil conducteur
du roman : je vais te raconter l’histoire d’une luciole
tombée dans l’eau sucrée (p. 33). Pas beaucoup
de trouvailles poétiques donc, mais une petite musique tout le
long du roman, sur un rythme équilibré, sans rupture de
style, comme un haïku. C’est une confidence à voix basse,
de la grand-mère à sa petite fille, toujours sur le même
rythme de phrases très simples, une confession sur un sujet tabou
ou honteux. La grand mère, dans sa jeunesse, avant d’épouser
l’homme qui sera son époux pour la vie, a eu un enfant d’un
homme marié, et a continué, plus ou moins contre sa volonté,
d’entretenir encore un certain temps des rapports avec le père
de son fils. (Un peu compliqué, quand même, à la première
lecture !). Personne dans la famille n’est au courant, même
pas le fils en question, père de la narratrice. Autrement dit,
maintenant, c’est la narratrice qui se trouve dépositaire
de ce secret qui va perdurer. C’est une confidence qui arrive en
fin de vie pour dissuader la petite fille de se laisser tenter par l’eau
sucrée elle aussi. C’est donc plus qu’une confidence,
c’est une mise en garde.... à l’usage des jeunes filles !!!
Je ne sais pas si je dois me laisser bercer par le charme de la petite
musique de cette Annie Ernaux japonaise (du point de vue du style), de
cette linéarité obsédante et envoûtante qui
exprime une sorte de fatalité. C’est un drame familial (ou
éprouvé comme tel par la grand-mère) dans le contexte
de l’histoire tragique de Nagasaki, raconté tout aussi sobrement.
J'ouvre aux ¾.
Jacqueline (tranchant
avec ces avis) (tranchant
avec ces avis)
Il y a quelques mois, en fait quand il a été programmé,
j'ai lu la première série Le
poids des secrets et la troisième, L'ombre
du chardon. Cela se lit extrêmement vite et facilement.
La deuxième n'était pas libre dans les bibliothèques
proches : visiblement ces livres ont un grand succès. Depuis,
il ne me reste pas grand chose de ce que j'avais lu et je n'ai guère
trouvé le courage de le relire ou de lire la deuxième série.
Pour ce qui est des thèmes, ils m'ont paru très "littérature
féminine" dans le mauvais sens du terme. Je me souviens que
dans le groupe, il y a longtemps, il avait été question
de lire un "Harlequin'' et
au fond, je m'imagine un peu les Harlequin comme cela. Parler de Nagasaki
pour en faire l'occasion d'un crime parfait ou dans la troisième
série faire jouer les bons sentiments avec le racisme anticoréen
ou les missionnaires dévoués, parsemer les textes de termes
japonais, ne suffisent pas à être à la hauteur de
ce que Pearl Buck
a pu faire avec la Chine ancienne. Shimazaki me paraît avoir créé
une forme effectivement à part, sinon réellement originale.
Les phrases sont très simples, les chapitres courts pour des livres
a minima. Une narratrice (parfois un narrateur) s'exprime comme dans les
"histoires vécues" que l'on trouve parfois dans la presse
féminine. Le principe de la série est, un peu transposé,
de celui des feuilletons, des mangas ou des bandes dessinées. Il
me semble que ces petits livres sont très bien adaptés au
succès commercial qui est le leur. En même temps il faut
au moins un coffret complet pour un voyage en train, tant cela se lit
vite ! J'ouvre un tout petit quart puisque j'ai lu deux séries…
(Voir ci-dessous
une réaction à la Pearl Buck citée par Jacqueline.)
Séverine
J'ai lu Suzuran
que j'ai trouvé gnangnan : cette histoire d'amour c'est pas mon
truc, je reconnais le côté Harlequin dont parle Jacqueline.
Quant au style de l'auteure, est-il simple dans le style haïku où
est parce que ce n'est pas sa langue ? Car j'ai l'impression de lire un
texte dont l'auteur n'écrit pas dans sa langue.
Mais mon avis a évolué en lisant le cycle Au
cœur du Yamato que j'ai lu en entier sauf le 5e, Yamabuki.
Si je n'avais lu que le premier livre, Suzuran,
j'aurais "fermé".
J'ai eu plaisir à replonger dans cette culture. J'ai appris sur
l'histoire du Japon, la Sibérie par exemple. Ma lecture est donc
meilleure.
Mais quand même l'histoire d'amour de Tsukushi
est cousue de fil blanc. Mais je dois dire que je me suis prise au
truc. J'ouvre à moitié.
Mais quand j'ai lu le premier livre, je me suis dit c'est quoi cette blague ?
Et le style me pose question. Je ne sais pas si c'est une œuvre littéraire
ou un texte pour découvrir le Japon. J'ouvre à moitié.
Mais ce sont de beaux objets avec de belles couvertures et l'évocation
des saisons.
Etienne, entre et et 
Ce fut donc une lecture plutôt mitigée de mon côté.
Certes, je reconnais une indéniable qualité d'accroche de
ses pentalogies. On retrouve avec plaisir un personnage laissé
au tome précédent, une nouvelle facette apparaît…
L'univers dépeint est instructif pour celui qui veut un premier
contact avec la culture japonaise et les thèmes abordés
témoignent d'un souci de profondeur. Mais cela n'a pas suffi pour
ma part, je me suis rapidement ennuyé de la simplicité de
la langue, des répétitions, d'une impression de remplissage
parfois. M'est venue l'idée que Shimazaki avait construit ses personnages
comme ses coffrets : élégants, épurés,
gonflés de symboles, mais qu'en fin de compte ce qui reste est
assez mince. Les protagonistes me semblaient, au détour d'une page,
joués par des robots. Choc culturel ? Peut-être, mais l'explication
régulièrement avancer serait trop simple, puisque j'adhère
complètement à la narration de Yoko
Ogawa ou Endo.
J'ouvre et je coupe la grenade en deux ou plutôt entre ¼
et ½.
Lisa
J'ai commencé ce matin le cycle Le poids des secrets
avec Tsubaki.
J'ai aussitôt eu envie de lire le suivant, j'ai mis mon manteau
et je suis allée à la librairie : il ne l'avait pas. Tant
pis.
Je l'ai lu très rapidement, j'ai été intéressée
sans plus. C'est un thème qu'on retrouve dans la littérature,
ce secret, un secret pas si terrible.
Claire
Le secret, c'est quand même la mère qui avoue à sa
fille qu'elle a tué son père...
Lisa
Elle a tué son père parce qu'il a une maîtresse, pourquoi
? Si tous les enfants dont les parents ont une liaison les tuaient, il
ne resterait pas grand monde... Je ne comprends pas cette histoire de
secret déjà vu et revu dans les films, rien de nouveau sous
le soleil.
Quant à la première partie où la grand-mère
parle avec son petit-fils, leurs réflexions sur la guerre ne m'intéressaient
pas du tout. Quant aux dialogues - est-ce parce que ce n'est pas sa langue
? - ils m'ont paru invraisemblables par exemple page 27, entre le fils
et sa mère qui rentre chez elle :
"- Je viens d'aller chez l'avocat. Il faisait froid ce matin,
je me suis mouillée.
- Je crains que tu n'attrapes froid. Je peux te faire du thé."
Ça manque de naturel, j'étais morte de rire.
Mais ça se lit facilement, avec des phrases courtes, on peut penser
à Yoshimura, non
mais rien à voir, je préfère de loin Yoshimura. J'ouvre
à moitié parce que dès que j'avais fini j'avais envie
de lire le second. Je ne sais pas ce qui m'en restera, si j'en garderai
grand-chose.
Monique L
J'ai dévoré ces 5 petits livres.
Bien que le procédé ne soit pas nouveau, j'ai apprécié
que la même tranche de vie nous soit racontée successivement
par les divers protagonistes et à des époques différentes.
La manière dont l'auteur dévoile petit à petit les
différents secrets qui touchent tous les personnages, chacun en
détenant et en confiant un petit fragment m'a plu.
La façon dont les destins et les révélations s'entremêlent
est intéressante. Un bémol : je me demande s'il est plausible
que l'on ne reconnaisse pas une personne que l'on a fréquemment
rencontrée quelques 10 ans après ?
Un roman tout en nuances qui conte les drames d'une famille en parallèle
des grands drames de l'Histoire : le tremblement de terre de 1923 à
Tokyo, la guerre, la déportation, la bombe de Nagasaki.
J'ai apprécié que ce regard soit sans complaisance pour
le Japon en notant ses exactions commises en Asie, notamment à
Nankin.
J'ai découvert une société aux codes plus rigides
que je ne le savais et surtout l'exclusion des coréens et sans
doute de tout étranger.
Les personnages sont attachants et ont beaucoup de pudeur.
Le style est simple avec des phrases courtes. L'écriture délicate,
lumineuse, parfois poétique, s'accorde bien à la sobriété
japonaise. Une écriture juste mais qui ne porte pas de jugement.
C'est sobre et pudique, tout est en retenue, en touches subtiles. Je ne
me suis pas sentie voyeuriste mais en empathie avec les différents
narrateurs.
Les titres des 5 fascicules sont eux-mêmes dépaysants et
symboliques. J'ai préféré le premier et le quatrième :
Tsubaki
(Camélia), raconté par Yukiko
Hamaguri
(coquillage), raconté par Yukio
Tsubame
(hirondelle), raconté par Mariko
Wasurenagusa
(myosotis), raconté par Kenji
Hotaru
(luciole) raconté par Tsubaki petite-fille de Mariko.
Ce fut une lecture très agréable, mais que m'en restera-t-il
si ce n'est une ambiance ? J'ouvre à ½.
Rozenn
J'ai dévoré ça comme une série, j'ai adoré.
J'en ai lu 10 d'affilée, donc 2 × 5 livres. C'était
magnifique de lire des petits livres aussi jolis et pas sur Kindle comme
je lis d'habitude.
Après le premier, j'étais très déçue
et il ne faut vraiment pas s'en tenir à un seul. Surtout que le
premier du Poids des secrets commence par un long
truc historique un peu long et après c'est trop léger, les
personnages sont simplement esquissés et ils n'ont pas le temps
d'exister : ils arrivent à exister par le croisement et l'effet
kaléidoscope des différents livres.
Je crois vraiment qu'il faut continuer à en lire un deuxième,
Lisa.
Lisa
OK, en plus ça se lit vite.
Rozenn
Ça se lit très vite. Quant
au style, oui, ça se lit vite, c'est simple, facile, avec quelque
chose d'un peu trop systématique, comme les couvertures, comme
le choix d'un symbole pour chaque livre.
J'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup sur l'histoire du Japon, de
vivre dans un univers complètement différent : je crevais
d'envie d'aller acheter de la bouffe japonaise, mais je ne sors pas de
chez moi, bon mais ce soir je crois que je vais craquer.
J'ai trouvé très intéressants les rapports familiaux
et hiérarchiques, tout est très codé, tout doit être
respectueux et forcément on arrive aux mensonges, c'est inéluctable.
Avant de lire L'ombre du chardon, j'aurais voulu
voir avec Suzuran
ce que ça donne si elle fait un roman, est-ce
que les personnages ont plus d'existence ?
Séverine
Mais il est de la taille des autres, c'est que, comme c'est le dernier,
il n'est pas encore en poche et semble plus gros.
Rozenn
Là il n'y a de nuances que dans le décalage, pas à
l'intérieur du personnage, c'est la limite que je pense.
Ceci dit, je ne boude pas mon plaisir et je l'ouvre en TRÈS grand.
Françoise
Je n'avais pas du tout compris qu'il y avait des séries... Katell
m'avait prêté Tsubaki.
Puis j'ai pioché dans ce que Claire avait envoyé, j'ai pris
au hasard.
Claire
Je les avais numérotés...
Françoise
Ftttt, ça m'est passé au dessus de la tête.
Avec le premier que j'ai lu, je n'ai pas imaginé qu'il y avait
une suite : le demi-frère caché, l'assassinat du père
par sa fille..., encore que on ne sait pas vraiment si elle l'a empoisonné.
Rozenn
Tu le sauras si tu lis la suite !
Monique L
Faut lire les autres, Françoise !
Claire
Tu te réjouiras qu'il soit tué !
Françoise
J'ai donc lu Azami,
puis Hôzuki
: je n'y ai rien lu concernant la Corée, la Sibérie.
Le style est très simple, très tac-tac-tac. C'est au présent,
à la première personne, très factuel comme récit
: je fais ci, lalali lalala. Comme Séverine, je me demande s'il
s'agit d'un style maîtrisé, voulu ou pas. Certaines expressions
interrogent, mais c'est sans doute du français canadien ;
ça ne m'a pas outre mesure gênée.
Heureusement, ce sont des récits courts, sinon je pense que ce
style (?) m'aurait lassée.
Hôzuki m'a semblé la suite d'Azami avec l'entraîneuse
qui a ouvert une librairie et qui a un enfant sourd-muet qu'elle a trouvé
et qui rencontre la mère biologique, ce qui m'a paru totalement
invraisemblable. À moins qu'on considère que c'est un conte.
La lecture est agréable, ça se lit bien, c'est court. Mais
je n'ai pas trouvé qu'on pénétrait vraiment ni dans
la culture japonaise ni dans l'histoire du Japon, sauf avec le bombardement
de Nagasaki.
J'ouvre à moitié. Ça se lit bien, mais cela ne me
donne pas envie d'en dire plus, je rejoins Lisa, ça m'a suffi.
Monique S
J'ai commencé par deux livres du premier groupe "Le
Poids des secrets".
Tsubaki
raconte l'histoire d'une grand-mère survivante à l'explosion
de Nagasaki et qui cache un lourd secret, car son père n'est pas
mort ce matin-là de la bombe comme on le supposait, mais de son
parricide à elle, par vengeance. Ce livre m'a semblé un
exposé un peu trop pédagogique et un peu simple des faits
historiques autour de la bombe. Longtemps, les Japonais n'ont pas pu parler
de leur version des choses, ni des souffrances vécues par la bombe.
Les Américains ont occupé le Japon durant dix ans et interdisaient
toute expression dans la presse, ou les livres sur le ressenti japonais,
leur instillant dans la tête l'idée qu'ils étaient
"coupables", "mauvais", et devaient taire cette terrible
"humiliation" méritée. Je pense que les premiers
Japonais à oser déterrer les non-dits ont été
ceux qui vivaient à l'étranger...
J'ai lu ensuite Tsubame,
où une vieille femme cache ses origines coréennes, après
avoir été nationalisée japonaise comme orpheline
de guerre. Jusqu'à sa mort, elle ne dira rien, même à
son mari et à ses enfants. Mais dans ses derniers jours, elle retrace
l'histoire des Coréens au Japon dont personne n'avait intérêt
à parler, ni les Japonais ni les Américains. Même
impression d'un livre un peu pédagogique, doucettement engagé.
Et puis j'ai lu deux livres du dernier cycle L'ombre
du chardon, et j'ai beaucoup aimé. Shimazaki délaisse
l'Histoire, et s'attache à décrire les ressorts des relations
humaines, et de la psychologie. C'est un changement de regard total aussi
par rapport à la culture japonaise ; on n'est plus dans ce
qui rattache le groupe social, les conventions. Mais certains personnages
approfondissent leur individualité, développent un chemin
personnel, au risque de laisser sur le bas-côté d'autres
personnes de la famille et du groupe, qui n'ont pas compris que les états
d'esprit ont changé, et qui restent empêtrés dans
les rôles conventionnels qui n'ont plus leur place.
J'ai aimé Suisen,
où un homme narcissique et manipulateur considère sa femme,
ses collègues, ses enfants, ses maîtresses, comme de simples
objets à sa disposition, pour le mettre en valeur. Au fur et à
mesure du livre, sans qu'il ne se rende compte (ni nous lecteurs d'ailleurs),
toutes les personnes qui l'entourent évoluent, prennent conscience
de leur exploitation, et prennent de la distance en le laissant seul sur
le carreau. On explique, on comprend son comportement, ses blocages, sur
des bases d'analyse psychologique. Mais aucune "convention"
ne tient plus, chacun est responsable de ses actes, de ses choix ;
et chacun est libre, contrairement au passé.
Mon livre préféré est Hôzuki.
J'ai beaucoup aimé l'esquisse de cette femme libre, qui ne veut
pas se marier, ne veut pas dépendre d'un homme, ne veut pas d'enfants,
se cultive autant qu'elle peut, devient libraire réputée,
et travaille comme entraîneuse pour élever un enfant "trouvé".
On est hors conventions, mais aussi hors bons sentiments. On surfe sur
la ligne déontologique ténue entre liberté et transgression...
(n'a-t-elle pas volé cet enfant ?)
Pour conclure :
Il y a toujours dans les livres de Shimazaki : du secret,
de fausses apparences, un silence concerté du groupe, jusqu'à
l'explosion finale des ressentiments.
Ce qui est particulier aussi dans ses livres, c'est
qu'on retrouve des personnages principaux ou lointains, comme en ombre
chinoise, d'un récit à l'autre. Copie peut-être sur
la mode des sagas et séries du cinéma ? Cela donne en tout
cas l'impression d'un monde "petit", d'une île ? où
tout le monde retrouve tout le monde.
Shimazaki dépeint très bien ses personnages,
au scalpel, sans sentimentalité. Ses récits sont très
travaillés, tous les détails s'agglomèrent au fil
du livre, rien n'est superflu. Le personnage du narcissique Gorô
dans Suisen,
par exemple, est digne d'un Caractère de la Bruyère.
J'ouvre aux¾. Lecture plaisante ; je suis contente
d'avoir découvert cette auteure, mais je ne sais pas si j'aurais
envie de relire ces livres dans dix ans, vingt ans ; on surfe peut-être
sur des partis-pris à la mode du moment, faits pour plaire. Je
ne pense pas être en face d'une écriture et d'un univers
personnel de grand créateur.
Catherine, entre et et 
J'ai lu les trois premiers du premier cycle. Je suis
restée sur ma faim après le premier livre : cela me paraissait
un peu simple, des phrases courtes tout le monde l'a dit, des personnages
ébauchés, pas approfondis. J'ai lu le deuxième et
le troisième et, certes, le procédé (changement de
narrateur) est connu, mais il donne de l'intérêt à
l'histoire vue par d'autres personnages.
J'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture. Je vais finir cette
série. Monique et Françoise m'ont donné envie de
lire le cycle 3 où il semble que les personnages
prennent plus d'épaisseur.
Par petites touches, on apprend des choses sur le Japon : à propos
de l'occupation en Manchourie et sur la Corée, on ne connaît
pas forcément.
On est frappé par les rapports dans les familles fondés
sur une économie de la relation. L'écriture le rend assez
bien.
J'ai eu un plaisir de lecture. C'est vrai qu'il y a un effet de mode avec
le procédé, mais c'est intéressant. J'ai lu peu d'auteurs
japonais et j'étais contente de lire ça : c'est une lecture
de vacances et j'avais justement quelques jours de vacances. En en lisant
d'autres, je pense que je prendrai sans doute plus d'intérêt
à l'ensemble. J'ouvre entre moitié et ¾, plus
proche de la moitié et peut-être plus après...
Renée
Comme Lisa avec le premier livre, j'ai ressenti quelque chose d'assez
addictif, je n'avais qu'une envie en lire d'autres en lire d'autres, mais
en effet ça ne laisse pas trace indélébile. J'en
ai lu une dizaine, mais dans le désordre, car j'ai emprunté
à la médiathèque de Narbonne ceux qui s'y trouvaient
; ensuite, comme l'auteure me plaisait, j'en ai fait des cadeaux pour
Noël que je lisais avant de faire le paquet cadeau…
J'ai trouvé poétiques des phrases très simples, par
exemple, suspendant le temps : "Elle
coupe le bout d'un rameau avec des ciseaux ; je suis des yeux le
mouvement de ses mains".
J'ai été touchée par la cérémonie du
thé dont j'ignorais tout et d'apprendre que des gens vivent de
ça m'a semblé extraordinaire.
Elle décrit les traditions familiales et de l'entreprise et la
modernité avec les jeunes qui veulent se libérer.
À propos du bébé trouvé dans une consigne,
j'ai pensé à un livre que j'ai adoré Les
Bébés de la consigne automatique : très
fort, très violent. Je ne sais pas s'il y a un autre pays où
l'on abandonne les bébés dans une consigne automatique.
Claire
C'est pratique.
Etienne
On les déposait dans les églises chez nous.
Monique
Quand j'ai travaillé dans l'aide sociale à l'enfance à
Paris, on trouvait des bébés dans des sacs plastiques Monoprix
dans le caniveau
Renée
Les plus vivaces survivaient. Je crois que j'en ai trop lu. Comme Séverine
qui a commencé par Suzuran,
moi j'ai fini par celui-là, que j'ai trouvé ridicule.
Séverine
Aaaahhhh !
Renée
Absolument ridicule. Très manichéen, avec deux sœurs
dont une dévoreuse d'hommes, ça ne tient pas debout, c'est
cucul la praline au possible, j'ai détesté ce livre. C'est
dommage parce que j'avais bien aimé tout le reste.
Ce qui m'a beaucoup plus intéressée, c'est notamment la
pression de l'entreprise sur la vie des gens, quelque chose qu'on ne connaît
pas à ce point en France.
J'ouvre ¾ si ce n'est pas en entier, car j'ai eu beaucoup de plaisir.
C'est vrai qu'il y a un peu un système ; je trouve que l'auteure
est une coquine, parce qu'elle a des ficelles qu'elle reprend ; Suzuran
m'a fait voir les défauts des autres ; par exemple, elle aime bien
répéter, ça fait des lignes... Mais j'ai presque
atteint l'overdose.
Françoise
À propos de la cérémonie du thé, je vous invite
à voir le film magnifique Dans
un jardin qu'on dirait éternel, où on découvre
cette cérémonie, c'est une merveille (plusieurs acquiescent
- à
louer sur Arte pour
4,99€).
Renée
J'ai été étonnée d'apprendre qu'on ne prend
que deux gorgées, une telle cérémonie pour deux gorgées
!...
Muriel 
Je suis là surtout pour écouter les avis des autres car
j'ai lu des livres, quatre je crois, il y a plusieurs mois. J'ai été
malade et j'ai perdu la boule, ce qui fait que je m'en souviens encore
moins.
Mais j'ai été très accrochée par le style.
S'il est vrai que c'est toujours sujet-verbe-complément et que
j'ai attribué ça au fait que c'est une Japonaise qui écrit
en français, j'ai trouvé ça très accrocheur.
C'est une lecture qui m'a beaucoup plu, qui m'a intéressée,
je ne pouvais plus lâcher les livres, tant pour le style que pour
les personnages. Je n'en dirai pas plus car je ne m'en souviens pas très
bien, me rappelant juste mon intérêt pour ce que j'ai lu.
J'ouvre donc aux ¾.
Claire
Tu as vraiment perdu la boule car tu en as lu 7 que je t'ai prêtés
dont un cycle entier…
Laura
Au cœur de l'œuvre "fleuve" de l'autrice, j'ai décidé
de lire Azami et
peut-être d'autres par la suite. Néanmoins, j'avoue que ce
n'était pas un vraiment un choix… j'ai ouvert le premier Epub
(merci beaucoup d'ailleurs) qui est tombé sous ma souris, et c'est
tout… Donc, je n'avais aucune connaissance du sujet abordé,
et je m'y suis lancée comme dans une aventure inconnue. 79 pages,
j'ai été très étonnée. Comment l'autrice
pouvait-elle développer un thème, une idée, ou simplement
une histoire, en moins de 80 pages, et que ce texte soit considéré
comme un roman ? Mais je ne connais pas les critères il est
vrai. Alors je me suis lancée. Spoil : je n'ai pas aimé
du tout, pour plusieurs raisons.
1) Tout le bouquin est écrit au présent. Je crois que cet
argument est celui que j'appelle le plus à ma rescousse pour expliquer
mon désarroi… Pourtant, c'est bien réel, je déteste
les écrits au présent, je n'y trouve pas de profondeur,
c'est plat, c'est sec (dit celle qui écrit cette phrase au présent…
— mais moi je parle en termes de présent de vérité
générale ! Bref.). Donc, avec moi, le présent, ça
ne fonctionne pas… Du moins pas encore. J'ai pourtant tenté
de trouver des bons côtés, parfois je trouvais des rythmes
et poésies agréables. Toutefois, et voici le
2) Je me suis ennuyée. Les phrases sont terriblement courtes, et
n'exposent que des descriptions de faits. Dans mon esprit, le résumé
du livre pourrait être "Demain, je prends le train à
9h". J'ai vraiment été très sceptique au
cours de ma lecture, ponctuée de petites grimaces ; et j'ai
eu la sensation que le personnage était incapable de réflexion.
À un moment, le personnage a "les yeux levés vers
le ciel sans étoiles, [il est] plongé dans [ses] réflexions"
(p. 10). Bien, mais encore ? J'attends ! Quelles réflexions
? Rien. Page blanche et nouveau chapitre. Shimazaki sait parfaitement
me frustrer…
3) J'ai été très étonnée des rapports
entre les femmes et les hommes, rapportés par l'autrice. Il est
vrai qu'elle a vécu 26 ans au Japon, alors, peut-être que
certains comportements sont pour elle normaux. Pourtant, le regard que
le personnage porte sur les femmes était vraiment… je n'ai
pas de mot. Manifestement, selon mon interprétation, aux yeux du
personnage les femmes sont soit des mères soit des putes (employons
le terme que Shimazaki se refuse à écrire), et il n'y a
pas vraiment d'entre-deux. Sauf peut-être lors de sa liaison avec
Mitsuko. Sa femme n'est plus sa femme, elle est la mère de ses
enfants, et, comme il se plaît à le répéter,
le couple est "sexless". Il ôte donc tout pouvoir séducteur
à sa femme, il lui ôte même le pouvoir d'être
une femme, sous-entendu, réelle. Mais réelle pour lui, selon
sa vision. Et, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'une femme, selon ce
qui lui apparaît comme bon ou normal, ne se maquille pas, ne s'apprête
pas, est libre à tout heure de la journée ou de la nuit
pour assouvir ses désirs sexuels, et elle se tait ; "Elle
est bavarde ce soir" (p. 52) : j'ai trouvé que cette
pensée était d'une grande violence. Pour lui, elle ne peut
pas être à la fois femme et mère, et elle ne peut
encore moins faire ce qui lui chante, comme planter des légumes
seule à la campagne. S'il semble l'accepter ouvertement, il est
assez remarquable qu'il se sente abandonné, ce qui culpabilise
le rôle de la femme, qui devrait presque être doublement mère.
Donc la femme est soit mère, soit pute. Et la prostituée
est Mitsuko. Je fais référence au fameux passage du vol
de sac à main : Mitsuko se promène en belle robe blanche,
talons hauts, fume. Et, de suite "Une prostituée ? pensé-je."
(p. 36). Mitsuko n'est plus la femme qu'il imaginait. Immédiatement,
elle se voit dégradée, et ce n'est qu'en retrouvant une
apparence prude et sage qu'elle remontera dans son estime. Bon, donc à
travers ces divers exemples, j'ai essayé de mettre en avant le
fait que l'autrice, en écrivant l'histoire, mettait en lumière
une vision très masculiniste de la société (l'homme
est celui qui est toujours déçu et abandonné, cf.
le départ de Mitsuko), malgré les quelques et faibles appels
féministes (une prostituée paye ses impôts comme les
autres).
Claire
Tu n'aimes pas le livre parce que le personnage est vilain...
Laura
J'ai en fait une lecture un peu ambiguë : soit Shimazaki est vraiment
matricée et il n'y avait aucun but à l'histoire ; soit
l'autrice décide volontairement de pointer un problème de
la société japonaise de notre époque. Je n'ai pas
de réponse. Mais, dans tous les cas, j'ai été impressionnée
par son talent à développer un personnage principal masculin.
Un quart ouvert.
Claire
Quant à la femme dont tu déplores qu'elle soit prude et
sage, je te signale qu'elle va s'éclater érotiquement, mais
il faut que tu attendes le tome
4 de ce cycle...
Geneviève
Je voulais sauter la séance, toujours prise par mon polar
passionnant, quand cet après-midi je me suis dit ils sont courts,
je vais en lire un, ce fut au hasard Tonbo
: ça se lit vite et bien.
Je n'avais pas vu que c'était écrit en français et
très vite j'ai repéré des problèmes de traduction,
par exemple on ne dirait pas "dans un tel endroit", qui est
la traductrice... j'ai alors vu que c'était écrit en français !
Le livre m'a quand même intéressée pour ce qui concerne
la culture japonaise, par exemple le système de scolarité
avec l'école de soir, spécifique ; le rapport au suicide
aussi.
Je suis partisane des écritures plates... mais là c'est
vraiment très plat.
Mais ce n'est pas inintéressant. Et si j'en lis un autre, ce serait
pour la culture japonaise, étrangeté absolue pour moi, par
rapport à des cultures qui m'attirent, africaine, maghrébine.
Le rapport à l'anglais aurait pu m'intéresser, avec la domination
de l'anglais.
Ce fut une expérience pas désagréable, mais par une
révélation.
Ce n'est pas si étrange que ce que nous avions lu d'Ogawa.
Claire (qui
avait proposé cette lecture, appuyée par Katell) (qui
avait proposé cette lecture, appuyée par Katell)
Il me semble que lire un livre et un cycle complet, c'est une lecture
assez différente.
Pour moi qui contrairement à vous tous ne regarde jamais de série,
je reprends le mot de Renée : addictifs, tels ont été
pour moi ces livres. J'ai lu tous les livres d'Aki Shimazaki... (n'en
revenant pas)...
 les 16 publiés...
les 16 publiés...
Le plaisir vient de retrouver des constantes : dans les 16 livres on a
systématiquement un narrateur à la première personne
(homme, femme, enfant, vieillard, sympathique, odieux...), avec un univers
japonais et son lexique à la fin, qui n'est pas le même pour
chaque volume. Tout est bref : le lexique, le livre, les phrases... Et
la retenue de mise, pas d'émotions exprimées, elles sont
sous les mots.
La composition du cycle n'est pas une simple succession de monologues
tournants et simultanés (comme dans Tandis que j'agonise
de Faulkner que nous avions lu jadis), mais on voyage dans le temps ;
de même, oui on est en permanence au présent que tu n'aimes
pas Laura, qui fait coller au récit, mais au sein d'un même
livre, on voyage dans le temps, avec des flashbacks, des enchâssement
de récits, et l'enfance ou la jeunesse du personnage qui surgit
à travers un personnage qui fait irruption dans le récit.
Toujours dans le jeu des temps, l'âge joue : il y a souvent un enfant
qui joue un rôle pour rapprocher ou éloigner les adultes
et l'enfant est souvent extraordinaire ; la relation entre enfants est
parfois centrale quand elle n'est pas incestueuse. De même, les
plantes qui donnent leur titre aux livres sont liées aux saisons,
au temps qui passe.
Ça, ce sont des ingrédients, mais le goût, c'est une
tension, douce mais ferme (ce qui crée l'addiction), donnant pour
moi un vrai suspense, dû à un mystère entretenu, des
secrets, des révélations.
L'opposition tradition/modernité a été évoquée
: on la retrouve au sujet des couples aux modalités diverses et
souvent non conformistes par rapport à la tradition des mariages
arrangés, bien présente : couples sexless, bisexualité,
amours de jeunesse réactivées, attirances passionnelles.
Il y a de nombreuses femmes fortes, non conformistes. Le rôle de
la création est également fréquent, comme si elle
correspondait à une émancipation, à une voie personnelle
hors des sentiers battus. Ces ressorts ont contribué pour moi au
plaisir, me persuadant également que l'auteure n'est pas moins
libre, non conventionnelle. Certains ont soupçonné un savoir-faire
commercial (une recette, à laquelle s'ajoute le coffret aguicheur)
; si Aki Shimazaki au tout début de ses publications remarquées
a donné quelques interviews, elle a rapidement cessé, "à
la Elena Ferrante", mettant en avant ses livres, point final ; ça
n'est pas très commercial.
J'ai une deux réserves et une question : une petite réserve
concernant les symboles liés aux titres - je suis d'accord avec
Rozenn ou Etienne, c'est un peu too much... et une réserve qui
concerne le récit sur des coïncidences (une fois ça
va, mais dix foix ça peut se sentir). Et je m'interroge sur le
travail avec l'éditeur : intervient-il sur la langue ou laisse-t-il
ce qui peut nous paraître bizarre, limite correct ; mais je me suis
laissé avoir plusieurs fois, croyant que c'était une maladresse,
par exemple : il me suffoque qui est en fait une tournure transitive vieillie.
Françoise
Et peut-être du français du Québec.
Claire
J'ai aimé aussi voir l'évolution d'un cycle à l'autre
: d'abord le contexte de l'Histoire, puis du monde de l'entreprise, sur
lequel se tissent les relations qu'on suit, et puis on se dégage
de ces contextes pour se centrer uniquement sur les relations, avec une
place de plus en plus grande au rôle de la création.
Plusieurs ont dit il ne me restera pas grand chose. Pour ma part, j'ai
eu un réel plaisir (qui m'oblige à ouvrir en grand...) :
et s'il m'en reste rien après, et alors ?!
Pour finir, Monique S (qui est japonophile avertie et a gagné
plusieurs concours de haïkus au Japon, voir ICI
les écrits de Monique) nous parle de Ryoko Sekiguchi, dont nous
avions lu La
voix sombre.
Elle évoque ses livres écrits en français : Nagori
: la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter et Manger
fantôme, d'une auteure d'aujourd'hui plus "japonaise",
au sens où elle nous introduit plus dans "une pensée
japonaise qui nous échappe". Mais ce sont plus des essais
littéraires que des récits.
Elle rappelle aussi le coffret de Yôko Ogawa, trouvé par
hasard dans une librairie à Bruxelles, qu'elle avait fait lire
au groupe lecture - avec une dimension fantastique.
Nous recensons les livres japonais que nous avons lus dans le groupe.
Brigitte Duzan (sinologue qui est venue plusieurs
fois dans le groupe et qui suit toutes nos lectures et avis, pour se distraire
de ses chinoiseries)
J'ai failli m'étrangler en lisant de la part de Jacqueline une
apologie de Pearl Buck donnée en exemple pour sa peinture authentique
de la Chine : rien de plus artificiellement faussement chinois que Pearl
Buck !...
Jacqueline
Brigitte Duzan a compris à tort que je faisais l'apologie de Pearl
Buck (lecture d'adolescence) : ce qu'elle dit va tout à fait dans
le sens de ma critique de Shimazaki !
AVIS DU GROUPE
BRETON
réuni par zoom le 21 janvier 2021 :
synthèse
de Yolaine, suivie des avis
Le but du jeu consistait à nous initier à l'œuvre
originale d'Aki Shimazaki, auteure japonaise vivant au Canada et écrivant
dans la langue de Molière, par n'importe quel bout. C'est pourquoi
nous ne nous sommes pas livrés à une étude approfondie
de telle ou telle œuvre, mais simplement à la découverte
d'un univers romanesque au charme particulier.
Les ouvrages d'Aki Shimazaki sont organisés en "pentalogies",
chaque recueil rassemblant cinq variantes très courtes d'une même
histoire, chaque protagoniste devenant à son tour le narrateur
et dévoilant son propre secret, ce qui crée un réel
suspense. Nous avons presque tous lu la première pentalogie, intitulée
"Le poids des secrets". Jean et Suzanne ont aussi lu Suzuran,
qui est sa dernière publication. Le titre poétique de chaque
volume correspond au nom d'une fleur (camélia, myosotis, muguet…),
oiseau ou coquillage, et le tout est réuni dans un joli coffret
précieux et raffiné comme une boîte à bijoux.
L'agrément de la lecture, facilité par la tension narrative
habilement entretenue et l'emploi d'une langue très simple, voire
minimaliste, a été largement partagé, avec des gradations
allant du simple plaisir et envie de terminer le livre commencé,
à l'addiction violente pour les plus vulnérables, qui ont
été contraints de se précipiter sur tous les ouvrages
disponibles de cet auteur en librairie. Il s'agit donc d'un phénomène,
et à ce titre, notre club de lecture se devait sans doute de s'y
intéresser.
Parmi les points ayant suscité notre intérêt unanime
figure aussi le contexte historique (pour "Le poids des secrets")
et ses moments les plus terribles : tremblement de terre de 1923, Seconde
Guerre mondiale, défaite du Japon et explosion des bombes atomiques
d'Hiroshima et Nagasaki ; éclairage sur la présence chrétienne
dans ce pays bouddhiste, avec l'irruption dans le récit d'un prêtre
européen pas très catholique ; massacre des réfugiés
coréens, dont l'évocation atteint une justesse bouleversante.
Ces événements traversent la vie des personnages d'Aki Shimazaki,
mais leur regard est centré sur leur intimité, leurs secrets
familiaux, leurs amours interdites et leurs généalogies
inextricables. Ils sont tournés vers le passé qui les hante
et l'atmosphère feutrée, pleine de retenue et d'interdits,
nous plonge dans un Japon traditionnel où la pression sociale est
intense.
Certaines ont adoré cette atmosphère paisible, intimiste
et délicate, qui semble faire partie intégrante de la culture
ancestrale et de l'exotisme japonais. Elles y ont trouvé sensibilité
et profondeur, amour et humanité.
Mais nous avons semble-t-il été plus nombreux à ressentir
frustration et déception devant la platitude du récit, même
si elle est le résultat d'un travail d'épuration volontaire,
et devant l'absence de chair et d'émotion, quand bien même
elle serait la manifestation d'une éthique asiatique. Voyage dans
un Japon désuet, étriqué et déprimant, qui
manque d'humour, de modernité, de "baroque", et parfois
de vraisemblance. L'utilisation de la langue française est-elle
un atout ou un carcan pour un écrivain né japonais ?
Une remarque de Jean nous offre la conclusion : la façon dont nous
appréhendons ce genre de récit très intime dépend
de l'histoire de chacun. C'est pourquoi cette rencontre fut encore une
fois une jolie découverte.
Marie-Thé (avis
transmis) (avis
transmis)  
J'ai lu Wasurenagusa
(quatrième livre du Poids
des secrets) que j'ouvre aux ¾, et pourtant
que d'aprioris avant d'en commencer la lecture... : l'impression qu'il
s'agissait peut-être de petits livres, genre feuilletons à
l'eau de rose ; c'est quand j'ai su qu'ils étaient édités
chez Actes Sud que j'ai décidé de me mettre à la
lecture, comme quoi... Si je ne l'ouvre pas en grand c'est parce que je
n'y vois pas une grande œuvre littéraire.
Cependant, j'ai aimé cet univers et ses personnages, ce côté
"aérien", lumineux, où triomphent l'amour, la
bienveillance, la générosité, face à ce côté
souterrain et sombre reliant aux racines, au poids de la lignée,
à l'importance de la transmission. Yin et Yang... J'ai été
très sensible à l'importance du souffle, de l'eau, la "Voie",
le cycle de la vie.
Retour aux sources pour Kenji sur la tombe de sa mère Sono. Naissance
d'une petite fille du même nom... "Lorsque
tout se termine, tout ne fait que commencer" dit François
Cheng, évoquant la mort mystérieuse en forêt du Huelgoat
de Victor Segalen dont il se sent si proche : Segalen l'Occidental
parcourant la Chine, face à François Cheng dans son "errance"
en Occident (cf. L'un
vers l'autre : voyage avec Victor Segalen, de François
Cheng : poème "Ultime voyage"). Je pense aussi,
dans Le
Dit de Tian-Yi de François Cheng, aux deux personnages
masculins dans une longue marche à travers la campagne chinoise,
entre ces deux hommes si différents, le personnage féminin.
L'histoire conduit aussi vers l'horreur des camps, et... au bord du fleuve
Amour. Importance du souffle, du fleuve qui part de la source, se jette
dans la mer, s'évapore et devient nuage, le nuage arrose la source
: "Le terme arrose le
germe."
Comme pour Wasurenagusa,
j'ouvre aux ¾ pour Hamaguri,
même si j'ai un peu moins aimé ce livre-ci. J'en ai aimé
la finesse, la délicatesse, l'atmosphère, les personnages,
ce que j'ai aimé dans le premier livre au fond...
Je suis impressionnée par le talent qu'a l'auteure à raconter
des "histoires" captivantes, avec une grande simplicité,
à nous amener vers des dénouements inattendus et forts,
à nous faire ressentir le poids des secrets, avec des personnages
qui ne sont pas à leur place. J'adore l'image des coquillages qui
s'assemblent.
Jean  J'ai
lu Suzuran J'ai
lu Suzuran un
roman intimiste où une femme dans la trentaine élève
son garçon, douée d'une énergie créatrice
qui l'amène à créer un vase en forme de cloche de
muguet, suzuran, également poison mortel. Un cinéma
intérieur est semblable à une mer intérieure sans
vague que troublent des relations familiales. Le livre résonnera
différemment selon l'histoire familiale du lecteur. Est-ce une
écrivaine du bonheur ? Elle reste en tout cas à la
surface de la douleur. Mais pour ma part je me suis ennuyé à
la lecture de cette histoire de famille et de sexe, racontée avec
beaucoup de douceur. Si on a une lecture contemplative, cela peut marcher.
C'est intimiste, mais avec une platitude des réactions, on reste
à la surface disais-je, et j'attendais plus, donc je suis frustré. un
roman intimiste où une femme dans la trentaine élève
son garçon, douée d'une énergie créatrice
qui l'amène à créer un vase en forme de cloche de
muguet, suzuran, également poison mortel. Un cinéma
intérieur est semblable à une mer intérieure sans
vague que troublent des relations familiales. Le livre résonnera
différemment selon l'histoire familiale du lecteur. Est-ce une
écrivaine du bonheur ? Elle reste en tout cas à la
surface de la douleur. Mais pour ma part je me suis ennuyé à
la lecture de cette histoire de famille et de sexe, racontée avec
beaucoup de douceur. Si on a une lecture contemplative, cela peut marcher.
C'est intimiste, mais avec une platitude des réactions, on reste
à la surface disais-je, et j'attendais plus, donc je suis frustré.
Suzanne
J'ai moi aussi lu Suzuran
: c'est une façon de se plonger dans une autre culture. On voit
l'importance de la Chine dans la civilisation japonaise : caractères
chinois, références à Confucius (j'ai aimé
son conseil : "choisissez
un homme qui n'aime que vous et vous n'aurez pas de problème"...).
J'ai aimé la musique des mots (kamataki, la cuisson de la
poterie dans le four...), la création comme un accouchement. Le
style dès la première page apparaît drôlement
simple, facile à lire, paisible, avec un univers du quotidien.
J'ouvre à moitié. Je n'ai lu que celui-ci, ça m'a
suffi.
Marie-Odile
J'ai lu
Myosotis et Coquillage
et Coquillage J'ai aimé ces livres-objets et le puzzle des différents
points de vue. Mais cette écriture délicate m'a apporté
peu d'émotions. Mais il faut dire que j'aime le baroque...
J'ai aimé ces livres-objets et le puzzle des différents
points de vue. Mais cette écriture délicate m'a apporté
peu d'émotions. Mais il faut dire que j'aime le baroque...
Édith
Moi aussi !
Les lectrices suivantes ont lu le cycle entier du Poids
des secrets :
    
Yolaine
Je suis sur la même longueur d'onde que Jean. Je me suis offert
le coffret pour mon petit Noël, mais le rapport qualité/prix
n'y est pas. Cependant, c'est parfait pour la salle d'attente chez le
médecin, avoir un livre dans son sac permet d'attendre et d'en
finir la lecture avec un seul rendez-vous médical.
J'ai d'abord pensé ouvrir à moitié car c'est agréable
à lire, ça se lit vite. Mais quand on a fini, c'est frustrant.
C'est pourtant bien construit, on lit cinq fois la même histoire
racontée différemment ; mais ce sont toujours les mêmes
ficelles, sur le plan technique d'ailleurs c'est bien. Cependant, je n'ai
pas vraiment adhéré lorsque j'ai trouvé des invraisemblances
: par exemple quand le drame de Nagasaki n'apparaît pas très
important par rapport aux histoires de cul ; il y a ainsi plein d'aspects
auxquels je n'ai pas cru.
En revanche ce qui m'a beaucoup plu, c'est le moment où la femme
parle de son enfance et de son origine coréenne, j'ai trouvé
cela très actuel et intéressant et sa souffrance est, elle,
vraisemblable.
Les scènes érotiques m'ont paru plates.
Alors que le contexte des événements est tragique, on n'y
croit pas car on reste à la surface des choses, on ne vibre pas,
c'est frustrant, décevant. Peut-être qu'il s'agit là
d'une façon japonaise de s'exprimer.
C'est une littérature facile, mais avec un monde étroit,
sans fantaisie. Je suis en train de lire un autre Japonais, 1Q84
de Murakami, à côté ça dégage ! Il déborde
d'imagination. Shimazaki, c'est frustrant car trop léger. Les fleurs
j'aime bien, mais là... non ! J'hésite entre ¼ et
½.
Chantal
Je ne me suis pas forcée à lire les cinq livres, qui m'ont
intéressée. C'est facile à lire, un peu trop. Je
me suis attachée aux faits historiques : l'invasion de la
Corée envahie en 1910 (d'autant que les Japonais en 2021 dédommagent
enfin les "dames de réconfort"), en 1923 le tremblement
de terre avec le massacre des Coréens par les Japonais..., la destruction
des avions américains...
Les secrets sont lourds (Le
poids des secrets) : il s'agit des secrets familiaux qui
touchent à la sécurité (secret des origines), à
la tradition (secret de la stérilité, de l'adoption). Mais
je n'ai pas ressenti d'émotions ; j me suis promenée dans
ces drames sans ressentir quoi que ce soit ; sauf quand la mère
fuit sur la colline, ou que l'on exhume les corps, j'ai ressenti là
quelque chose de profond.
Les cinq livres sont construits de la même manière : les
scènes d'amour recourent aux mêmes mots, par exemple les
seins sont toujours... abondants.
Yolaine
Pourtant les Japonaises n'ont pas beaucoup de poitrine...
Chantal
Les symboles - fleur, hirondelle... - ne sont pas inutiles, mais c'est
plat, pas profond. Je suis donc restée sur le bord. Je voulais
de la force, de la profondeur, le plaisir reste plat.
Cindy
Qu'est-ce que je souffre en entendant vos avis...
Édith
Je me suis plongée avec plaisir dans la découverte de ces
jolis livrets de la période Le
poids des secrets.
Je connaissais, avant de les découvrir, plusieurs éléments
de la vie de cette écrivaine, Japonaise vivant au Canada depuis
de nombreuses années et qui avait fait le choix d'écrire
ces livrets en français. Je ne fus donc pas trop étonnée
de la forme grammaticale : de très courtes phrases, des mots
simples et aussi, pour chaque récit, une ligne anecdotique simple,
la révélation d'un des secrets arrivant toujours dans les
derniers chapitres.
J'ai apprécié découvrir ou retrouver dans chacun
des récits des points de l'histoire contemporaine faisant écho
à mes souvenirs tant scolaires (guerre russo-japonaise) que par
les nombreux documents d'archives de la Dernière Guerre mondiale.
Il est intéressant que ces personnages évoluent et traversent
les drames de la grande histoire : la bombe de Nagasaki, Hiroshima,
la guerre en Mandchourie, la Russie communiste et ses prérogatives
de conquêtes, la Corée dans ses rapports avec les Japonais,
et aussi la présence du catholicisme au Japon par les Jésuites,
conséquence de l'occupation fin 19e siècle.
Chaque récit apporte des éléments de la tradition
et de la culture, comme si le fait pour Shimazaki d'être loin de
son pays l'amenait à en expliquer ou plutôt en décrire
certains aspects de la tradition, la culture et la langue japonaises ;
j'ai apprécié le récit émaillé de mots
japonais en écriture latine !
J'ai dû établir un arbre généalogique sommaire
pour qu'à chaque lecture de nouveau livret, je ne sois pas trop
perdue dans les liens familiaux et les âges des personnages. On
les rencontre à différents moments de l'histoire du Japon
mais aussi de leur propre histoire donc de leur âge. On peut aussi
deviner de la lecture précédente le destin du personnage
qui évolue dans le "nouveau" récit : relâchement
de l'intrigue ou plaisir de connaître ?
À part le premier livret Tsubaki
et la révélation du meurtre du père…
effacé par la bombe nucléaire, donc sans conséquence
légale pour la fille, je n'ai pas été très
intéressée par les récits. Comme je l'ai évoqué,
ce sont les éléments de culture et le récit historique
sous-jacent qui m'ont le plus intéressée. Je remarque aussi
que le monde occidental et le monde asiatique, du moins celui de Simazaki,
ont les mêmes procédés dramatiques : enfants
bâtards, enfants adoptés qu'ils l'ignorent ou non, femmes
trompées par leurs conjoints et volonté, au moment de la
mort, de se débarrasser de secrets… de naissance, avec la
présence de carnets "secrets"… et le poids
du silence qui joue sur le destin. Romanesques donc que ces récits
qui ont le mérite de se lire très vite (heureusement) afin
de ne pas oublier les protagonistes.
Plaisir d'objet par les couvertures joliment illustrés de fleurs
ou d'animaux évoquant, de fait, le rapport si particulier du Japon
à la nature et aux saisons. J'ai pensé aux haïkus par
la syntaxe… et les nombreux blancs de la pagination. Belle découverte
que ces livrets : pas de réel plaisir de texte, mais un intérêt
pour la forme choisie. Un "bijou précieux" japonais,
bien joli dans une bibliothèque !!! Ou à offrir… Je
ne lirai pas les deux autres cycles.
Cindy
En lisant les cinq livres, j'ai pensé au film In
the mood for love, l'histoire d'une liaison toute en justesse
et profondeur ; j'en ai retrouvé l'atmosphère et la retenue.
Dans ces livres, on trouve des valeurs, une éthique. J'ai été,
je suis, émue par l'écriture et l'histoire. Chacun des cinq
livres du cycle apporte des compléments au précédent.
On est toujours au bord, jamais direct.
Je me suis sentie invitée à me mettre dans le mental de
chaque personnage. Il y des codes, des obligations, le rôle des
apparences qu'on retrouve dans les personnages. Et un va-et-vient entre
la mémoire et le dire. Il faut bien suivre, car le troisième
livre se passe avant le premier. Il y a un enchevêtrement de deux
récits, des flashbacks. On est en alerte et j'avais hâte
d'ouvrir un nouveau livre qui allait m'apporter de nouvelles explications.
Les livres que j'ai le plus aimés sont le premier et le quatrième
:
  Là,
les personnages m'ont le plus émue et m'ont le plus apporté.
Oui, on entre dans l'intimité. Les scènes d'amour, contrairement
à Chantal et Yolaine, je les ai au contraire appréciées,
elles vont très bien avec l'écriture, TOUT
EST EN DÉLICATESSE. Il y a le non-dit, l'indicible, qu'on
peut ressentir. Là,
les personnages m'ont le plus émue et m'ont le plus apporté.
Oui, on entre dans l'intimité. Les scènes d'amour, contrairement
à Chantal et Yolaine, je les ai au contraire appréciées,
elles vont très bien avec l'écriture, TOUT
EST EN DÉLICATESSE. Il y a le non-dit, l'indicible, qu'on
peut ressentir.
Il y a un cadre historique, des tragédies, mais volontairement,
pour moi, l'auteure est au-dessus. Mais je suis allée voir l'histoire,
par exemple la Manchourie, envahie par le Japon, où un personnage
va vivre. L'humain est au-dessus de tout, et il y a beaucoup d'amour.
Le récit est mêlé à des descriptions qui ont
leur importance ; les images, fleurs, coquillage, constituent un fil conducteur.
Tous ont des liens, les myosotis, on les retrouve en Sibérie.
À travers les quatre générations d'une famille, j'ai
fait un voyage qui m'a beaucoup plu à travers des personnages attachants
que j'aurais envie de retrouver (c'est la première fois que ça
m'arrive...).
Je remercie à nouveau Voix au chapitre de m'avoir permis de découvrir
cette délicieuse écrivaine.
Marie-Thé
N'assistant pas aux échanges, j'ai parcouru vos avis avec intérêt,
me sentant plutôt d'accord avec Cindy. Émotion, sensualité,
sont pour moi bien présentes dans les livres que j'ai lus.
Marie-Jeanne (à qui Claire a passé
quelques mois plus tard d'abord un premier livre, puis sa "collection")
découvre parmi ses nombreuses autres lectures un livre, puis l'autre...
25 janvier
Je viens de terminer Tsubaki
de Aki Shimazaki, et je suis à la fois bouleversée
et sans voix... Quelle force, ou plutôt quelle violence des sentiments
et des événements familiaux sur fond tragique d'Histoire
(avec un grand H), quelle sensualité et parfois quelle délicatesse
des sentiments... C'est vraiment très original, et quand on pense
que c'est écrit par une femme qui a appris le français à
son âge mûr... c'est époustouflant ! Quelle inventivité
aussi dans la trame de cette histoire d'une passion (ou plutôt de
deux passions : celle de l'homme qui a un enfant avec une très
jeune femme qu'il ne veut pas épouser par orgueil, et celle des
deux enfants qui ne savent pas qu'ils sont demi-frères, et dont
on apprend à la fin qu'ils se sont aimés toute leur vie...)
C'est vraiment admirable. Je suis très touchée par ce récit,
par la très belle langue de l'auteure. Et je brûle d'envie
de lire les autres volumes de cette "pentalogie". Merci de m'avoir
permis de découvrir cette auteure, que je ferai sans aucun doute,
à mon tour, découvrir à d'autres.
23 mars
Je viens de lire le deuxième
livre de la première série de l'œuvre de Aki Shimazaki.
Comme dans le premier volume, il y a de très beaux passages sur
la nature, sur la forêt de bambous où les deux adolescents
se retrouvent, sur les plages... mais le fait que les événements
soient présentés d'un point de vue totalement différent
du premier volume donne à l'histoire un éclairage surprenant,
et surtout, comme le lecteur a déjà connaissance d'éléments
concernant le narrateur que celui-ci ignore, cela crée une atmosphère
étrange, très nostalgique, qui m'a laissée dans une
grande tristesse.
J'aime beaucoup la couverture du livre avec une photo des deux coquillages
qui s'assemblent, coquillages que la mère donne à son fils
au moment de mourir et qui lui permettront de rassembler les éléments
épars de sa vie...
C'est très bien conçu ; il y a du suspense, et, je me répète,
beaucoup de tristesse... Que vais-je découvrir dans le 3e volume
? C'est vraiment très original, cette œuvre très prenante
qui sort des sentiers battus.
24 avril
J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la lecture, puis
relecture (et je crois que ce n’est pas fini...) de cette première
“pentalogie”. Voici une œuvre originale qui m'a beaucoup
touchée : Le
poids des secrets de Aki Shimazaki, une Japonaise qui vit au Canada
et écrit en français : un très beau français,
une langue à la fois sobre et riche, qui lui permet de décrire
admirablement le quotidien et l'exceptionnel du Japon.
Aki Shimazaki raconte la vie de gens dont les destinées se croisent
et interagissent, avec leurs drames et leurs bonheurs, sur fond de tragédies
historiques : le tremblement de terre de 1923 et la bombe atomique de
1945 sur Nagasaki. Nous entrons dans l'intimité et les secrets
de ses personnages : leurs amours, les naissances illégitimes,
les "origines douteuses", l'amour paternel et maternel, et surtout
l'éveil, entre deux adolescents, d'un amour intense, d'une grande
délicatesse, infiniment touchant, qui durera jusqu'à la
mort, alors qu'après avoir été brutalement séparés,
ils ne se seront jamais plus retrouvés…
Il y aura des morts violentes, des amours sensuels, des personnages attachants,
des comportements révoltants… Et surtout, beaucoup de secrets,
de non-dits, d'événements non dévoilés…
de confidences révélées peu avant la mort d'un des
protagonistes, de révélations trouvées dans une lettre
après le décès d'une grand-mère…
La grande originalité de cette œuvre, c'est sa construction
: elle se compose de 5 livres ; chacun est écrit par l'un des protagonistes
de l'histoire, qui décrit les événements selon son
point de vue et ce qu'il sait de leur déroulement. Chaque livre
lève le voile sur un nouvel aspect de l'histoire. Le lecteur devient
alors en quelque sorte complice, car il y a des éléments
qu'il connait, mais dont certains personnages n'ont pas connaissance au
moment où ils racontent leur histoire. C'est très étrange.
J'ai beaucoup aimé ce roman émouvant et tragique. Il m'a
d'ailleurs plongée dans une certaine tristesse : une tristesse
en quelque sorte bienfaisante, car née de cette immersion dans
la condition humaine. Une très belle œuvre.
Et je n'oublierai pas les mots "tsubaki", "hamaguri",
"tsubame"…, et surtout "wasurenagusa" (myosotis)
: " Ne m'oublie pas…"
DES INFOS à
propos d'Aki Shimazaki et ses 16 romans en 20 ans
•QUELQUES
REPÈRES BIOGRAPHIQUES
- Aki Shimazaki est née en 1954 au Japon à
Gifu, un village montagneux. Elle est la cadette des trois sœurs
et "se voit comme un mouton noir", rêvant "d'être
seule et reconnue pour ce que j'étais et ce que je faisais".
- Titulaire d'un diplôme de pédagogie, elle travaille au
Japon pendant 5 ans comme enseignante d'une école maternelle (ou
l'équivalent au Japon) ; elle donne également des leçons
de grammaire anglaise dans une école du soir.
- À 25 ans, elle demande un visa d’immigration à plusieurs
pays. "C’est le Canada qui m’a choisie", dira-t-elle.
- Elle vit 11 ans au Canada anglais à Vancouver à partir
de 1981 où elle travaille pour une société d'informatique,
puis à Toronto, avant de s'installer à Montréal,
attirée par l'"ambiance artistique", sans connaître
un mot de français.
- À l'âge de 40 ans, elle commence à apprendre le
français en autodidacte, puis dans une école de langue.
- Elle vit à Montréal depuis 1991, enseigne le japonais
et publie depuis 1999. Shimazaki est son pseudo littéraire.
Une fois ces éléments connus, voir la présentation
désopilante de l'auteure par deux booktubeuses sur leur chaîne
"Personnel
à tout le monde".
•
CE QU'AKI SHIMAZAKI DIT DE SON ÉCRITURE
Sauf précision, les citations qui suivent sont
extraites de l'entretien approfondi avec Linda Amyot, "Aki
Shimazaki : ce qu’on ne peut pas dire", Nuit blanche,
2007.
Aki Shimazaki a joué le jeu des médias au début de
sa carrière puis les a fuis : "Beaucoup d'écrivains
rêvent d'être connus. Moi, c'est le contraire. Pour moi, un
écrivain, ça écrit." ("Aki
Shimazaki : la méthode Shimazaki", Josée Lapointe,
La Presse, 15 novembre 2015)
Quand et comment êtes-vous venue
à la littérature ?
"Entre 13 et 18 ans, j'ai écrit des
nouvelles pour m'amuser ou montrer à mes amies. Mes temps libres
étaient consacrés à la lecture de romans et de
biographies d'écrivains dont la vie était hors de l'ordinaire,
comme celle d'Osamu Dazai. Après 18 ans, j'ai écrit des
essais dans une revue littéraire éditée par ma
sœur, celle qui m'avait donné A Little Princess.
Cette revue était subventionnée par le comité départemental
de l'Instruction publique.
Auriez-vous tout de même écrit
dans votre langue maternelle si vous n'aviez pas choisi d'immigrer ici
?
"J'aurais certainement continué à
écrire. En fait, en 1994, j'ai écrit un petit roman (feuilleton
de 11 semaines) pour le journal japonais hebdomadaire de Toronto.
En vous installant au Québec,
vous avez décidé d'écrire directement en français.
Je suis vraiment retombée dans mon rêve
d'enfance de devenir romancière à l'époque où
j'étudiais le français à Katimavik, une école
pour immigrants. Notre professeur nous a fait lire le roman d'Agota
Kristof, Le
grand cahier
(le premier volet de sa trilogie). J'ai été frappée
par son histoire profonde et puissante et son écriture très
simple et directe. J'ai tout de suite lu le reste de cette trilogie.
Je voulais moi aussi écrire des romans en français, dans
un style similaire.
J'ai alors commencé à écrire mon premier roman,
Tsubaki, dans la langue que j'étais en train d'apprendre.
L'idée d'une histoire d'amour entre un demi-frère et une
demi-sœur m'est venue en lisant Le
troisième mensonge (le dernier volet de cette trilogie)."
"Comme j'ai commencé à écrire
en même temps que j'ai commencé à apprendre le français,
c'était très difficile. J'avais constamment la tête
dans le dictionnaire. Mon ami me disait que mon roman serait un collage
du dictionnaire. Et maintenant, écrire des romans en français,
c'est ma passion." ("Du
pur, du vrai Aki Shimazaki", Danielle Laurin, Le Devoir,
7 février 2009)
"Le français m'a apporté la clarté
et la précision, ce qui est à l'opposé de la mentalité
japonaise" ("Le français, langue d'accueil de tous
les écrivains du monde", Françoise Dargent, Le
Figaro, 8 janvier 2009)
Une critique disait encore tout récemment
que vous écriviez "en français des romans très
très japonais".
"On a raison de dire que j'écris 'en
français des romans très très japonais'. J'ai
vécu au Japon jusqu'à l'âge de 26 ans et je n'avais
jamais été à l'étranger avant cet âge.
Je suis contente de pouvoir conserver mes origines japonaises à
travers mes romans. En même temps, quand j'écris un roman,
ce qui est important, c'est que mon histoire touche le cœur du
lecteur. Je raconte la vie d'individus, ce qui est universel. La société
japonaise ou des événements historiques du Japon que j'utilise
ne sont qu'une toile de fond ou bien un thème secondaire. J'ai
lu une critique sur mes romans qui dit : 'C'est tragique et doux,
léger et profond, universel et parfaitement japonais'. Je
suis contente des mots : universel et profond."
Écrivez-vous différemment
en japonais ?
"Totalement. En japonais, mes phrases sont
plus longues. En français, c'est beaucoup plus minimaliste."
("Aki Shimazaki : la méthode Shimazaki",
La Presse, 2015)
"J'aime écrire très simplement,
les phrases courtes et concentrées comme les haïkus en japonais."
("Du pur, du vrai Aki Shimazaki", Danielle Laurin, Le
Devoir, 7 février 2009)
"Mon style minimaliste, simple et direct est
assez éloigné de la plupart des œuvres littéraires
japonaises. Les écrivains japonais écrivent de manière
plus détournée. On ne dit pas les choses directement au
Japon. Une écrivaine telle Yoko Ogawa, par exemple, qui a aussi
un style simple et très direct, se démarque tout à
fait par rapport à l'ensemble de la production littéraire
nipponne."
Avant de choisir un personnage, Aki Shimazaki
choisit un titre - un seul mot, en japonais, qui est souvent un nom d'objet,
de plante ou de fleur :
"Je vois comment il sonne à mon oreille.
Comme pour Hôzuki [le physalis] et Mitsuko, le personnage.
Je médite alors sur ce que je peux faire avec les deux ensemble."
("Aki Shimazaki : la méthode Shimazaki",
La Presse, 2015)
"Quel est le sens d'écrire ? Je le trouve moi-même
en écrivant, car je ne connais pas la fin. Je crois que si je
déterminais le sujet d'abord, ce serait moins profond, même
un peu ennuyant." ("Aki Shimazaki : la méthode
Shimazaki", Josée Lapointe, La
Presse, 2015)
Concrètement, comment travaillez-vous
? Faites-vous plusieurs versions ? Savez-vous déjà à
l'avance que votre roman fera telle ou telle longueur ?
"Je travaille généralement tous
les jours, tard en fin de soirée. Parfois, j'écris une
seule ligne ; d'autres fois, ça va bien et j'écris plusieurs
pages. Dans l'après-midi, je vais marcher ou je vais au café ;
c'est souvent à ce moment que les idées me viennent. Je
fais plusieurs versions - cinq, six peut-être - avant de faire
parvenir le manuscrit à mon éditeur. La première
version du deuxième roman, Hamaguri, faisait plus de 200
pages. Je me suis rendu compte que je voulais y mettre trop de choses.
Je l'ai donc beaucoup élagué avant de le montrer à
mon éditeur. De façon naturelle, ma version la plus achevée
tourne toujours entre 100 et 150 pages, pas plus."
"Quand je comprends ce que j’avais à
dire, je recommence du début à la fin. Il y a vraiment
beaucoup de différences entre la première et la dernière
version ! Je me psychanalyse moi-même." ("Aki Shimazaki
: la méthode Shimazaki", Josée Lapointe, La
Presse, 2015)
"C'est toujours en terminant un roman que m'arrive
l'idée pour la suite. Au bout du
compte, j'ai fini avec une pentalogie, mais j'aurais pu écrire
un cycle de dix romans. Je suis en train d'écrire le deuxième
volet d'un nouveau cycle, débuté avec Mitsuba,
mais je ne sais pas encore le nombre de romans qu'il comptera. C'est
en écrivant que je le découvrirai."
Traduisez-vous vous-même vos romans
en japonais ?
"Honnêtement, je pense écrire
des romans seulement en français. Alors, quand une Japonaise
de Tokyo, Megumi Suzuki, m'a demandé de traduire Tsubaki,
j'ai accepté. Sa traduction fut excellente. Elle l'a faite de
façon sérieuse, avec passion et respect. J'en étais
très contente. J'apprécie beaucoup cette traductrice,
qui a parfaitement respecté le style minimaliste qui est le mien
en français.
Le métier de traducteur est différent de celui de l'écrivain.
Si je devais traduire moi-même mon roman en japonais, je le récrirais
entièrement. Quand j'écris dans ma langue maternelle,
mon écriture n'est pas la même qu'en français. Mes
phrases sont plus longues, mon style plus lourd."
Vous avez reçu le prix du Gouverneur
général pour Hotaru qui clôt votre premier
cycle romanesque. Que représente cette consécration pour
vous ?
"Ça a été un choc pour
moi de recevoir ce prix. Je n'en revenais pas. Mais je vous dirais que,
pour moi, la véritable consécration a été
de recevoir le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec.
Moi, qui ne suis pas née au Québec et qui écris
des romans qui se déroulent au Japon, je recevais un prix qui
me reconnaissait comme faisant partie intégrante de la littérature
québécoise ! Ce prix m'a vraiment beaucoup touchée."
•
SES INFLUENCES LITTÉRAIRES
- Frances
Hodgson Burnett, auteure de La
Petite Princesse, dont une
statue a été placée en 1936 dans Central Park
à New-York :
"Lorsque j'avais onze ans, j'ai reçu
un livre en cadeau de l'une de mes sœurs aînées. Le
titre était Shôkôjo (A Little Princess). C'était
un roman de Frances Elisa Hodgson Burnett, une Américaine d'origine
anglaise (1849-1924). Ce roman m'a tellement fascinée que depuis
lors je rêvais de devenir romancière." ("Aki
Shimazaki : ce qu’on ne peut pas dire", Linda Amyot, Nuit
blanche, 2007).
- L'écrivaine hongroise, puis suisse, Agota
Kristof, auteure de la trilogie Le
Grand Cahier (1986) écrit en français qui n'est
pas sa langue natale ; elle a été un modèle
particulier d'inspiration et de motivation pour Aki Shimazaki :
"J'ai été fascinée par
son style très simple et son histoire si profonde. À cette
époque, j'avais déjà des idées pour mon
roman Tsubaki. Alors j'ai décidé de l'écrire
directement en français. Il m'a fallu trois ans pour l'achever."
(Le
Figaro, 8 janvier 2009)
"J'ai été passionnée par les romans d'Agota
Kristof, mais cela ne veut pas dire que mes influences se trouvent du
côté de l'Europe. Comme vous le savez, Agota Kristof est
aussi une immigrante qui écrit directement en français.
Sa façon de survivre à l'étranger en tant que romancière
m'a influencée." ("Aki Shimazaki : ce qu’on
ne peut pas dire", Linda Amyot, Nuit
blanche, 2007).
- Osamu
Dazai, écrivain japonais connu pour le style appelé
Watakushi shishosetsu : c'est un genre littéraire japonais
où le roman est centré sur la vie intérieure d'un
héros souvent assimilé à l'auteur, sur le mode de
la confession ; comme l'autofiction, il incorpore donc des éléments
d'autobiographie ; il est souvent écrit à la première
personne.
- Les haïkus : "Tous
vos titres sont des éléments de la nature {Tsubaki,
"camélia" ; Hamaguri, "palourde" ; Tsubame,
"hirondelle" ; Wasurenagusa, "myosotis" ; Hotaru,
"luciole" ; Mitsuba, "trèfle") ; ils
symbolisent des nœuds essentiels de vos romans. La référence
à la nature et son lien avec les étapes de la vie humaine
ou les états d'âme des personnes sont très fréquents
dans les haïkus. Est-ce là chez vous justement un héritage
de la littérature nipponne ?
"J'aime le style du haïku, ce court poème
japonais de dix-sept syllabes. Si l'on trouve chez moi un héritage
de la littérature nipponne comme les haïkus, j'en serais
honorée. J'ai tenté d'écrire de ces poèmes
quand j'étais étudiante, mais sans grand succès.
Pour moi, c'était plus difficile que d'écrire des romans."
("Aki Shimazaki : ce qu’on ne peut pas dire", Linda
Amyot, Nuit
blanche, 2007)
•LE
JAPON D'AUJOURD'HUI et AKI
SHIMAZAKI
Le Japon, ancien Empire du Soleil levant,
n'arrive pas à vraiment implanter la démocratie souhaitée
par plusieurs personnages de vos romans ?
"On pourrait dire que la compagnie
a remplacé l'Empereur et que ses employés sont les nouveaux
soldats".
"Si l'on n'arrive pas encore à y implanter un esprit
démocratique, malgré ces efforts, c'est à cause
de la hiérarchie psychologique qui domine, depuis des siècles,
dans les relations humaines de cette société. Cette
hiérarchie est basée sur la pensée confucianiste :
respecter les aînés, par exemple. L'ordre d'ancienneté
est très important dans n'importe quel contexte. Les gens n'osent
pas s'opposer à ceux qui sont en position d'autorité
ou de pouvoir, que ce pouvoir soit familial, professionnel, social,
politique, etc. 'Le clou qui dépasse se fait taper dessus.'
Voilà le dicton qui représente le mieux la mentalité
japonaise. Autrement dit, il faut être très fort pour
se battre contre les injustices et il faut aussi, en conséquence,
accepter de devenir ce clou."
"Quand je rends visite à ma famille
- mes trois sœurs et mon père - je n'ai pas assez de temps
pour voyager et observer les changements qui ont eu lieu depuis mon
départ en 1981 (se déplacer coûte très
cher là-bas). C'est plutôt par des revues, des magazines
et des journaux japonais que je suis au courant de l'actualité
au Japon. À mon avis, pour ce qui est de la mentalité,
il n'y a pas une grande différence entre les deux époques.
Les gens sont toujours polis, conservateurs, conformistes... et les
vieilles traditions ou coutumes jouent un grand rôle, bon gré
mal gré. Par exemple, il existe encore des mariages arrangés.
Qu'en penser ? Certains mariages d'amour finissent en divorce alors
que des mariages arrangés durent harmonieusement. Quant aux
Japonais de la nouvelle génération, il me semble qu'ils
sont sans but surtout après le dégonflement de la bulle
économique. Je m'inquiète pour l'avenir du Japon."
("Aki Shimazaki : ce qu’on ne peut pas dire", Linda
Amyot, Nuit
blanche, 2007).
"Quand j'habitais encore au Japon, je condamnais
constamment la société japonaise. J'envoyais des lettres
aux journaux, par exemple, pour critiquer le système scolaire.
Une fois, mon opinion a suscité un certain intérêt
parmi des étudiants et des professeurs. Au lapon, à
cause de la hiérarchie psychologique, on est très souvent
confronté à de l'injustice. Je devais me battre constamment
contre des traitements injustes, venant des gens au pouvoir. J'en
étais très fatiguée. Bien sûr, le fait
que je vis maintenant à l'étranger me permet de regarder
la société japonaise plus objectivement. Pourtant, je
ne peux pas arrêter de la critiquer parce que je n'y habite
plus. En même temps, n'oublions pas que l'injustice est omniprésente,
dans n'importe quelle société. C'est un thème
universel, comme la plupart des thèmes que j'explore dans mes
romans.
En général, la plupart des Japonais sont réceptifs
aux critiques négatives de leur société, provenant
de qui que ce soit. À la différence des Américains,
les Japonais sont curieux de savoir ce que les gens à l'étranger
pensent d'eux. Tsubaki est traduit en japonais et j'ai reçu
des lettres de certains lecteurs du Japon qui me félicitaient
d'avoir écrit ainsi sur les problèmes du pays durant
la guerre, d'avoir abordé la question de la bombe nucléaire
de la façon dont je l'ai fait."
•PRESSE
ET ANALYSES
Ce que dit la presse généraliste, puis place aux analyses
universitaires...
› sur les romans
› un
entretien de fond (rare
car l'auteure ne se prête pas au jeu des médias)
› des travaux universitaires
› Sur
les romans : quelques exemples, mais les articles
sont innombrables...
Sur le premier cycle
- "Tsubame"
et "Wasurenagusa",
Linda Amyot, Nuit blanche, 14 janvier 2003
- "Littérature
: Aki Shimazaki, lauréate du Prix du gouverneur général
pour son roman Hotaru", Frédérique Doyon,
Le Devoir, 17 novembre 2005
- "Mitsuba"
et "Zakuro",
Michel Nareau, Nuit blanche, 14 décembre 2008
- "Du
pur, du vrai Aki Shimazaki", Danielle Laurin, Le Devoir,
7 février 2009
- "Tsukushi
:
pudeur émouvante", Josée Lapointe, La Presse,
24 février 2012
- "Yamabuki
:
le roman le plus bouleversant de l'année", Josée
Lapointe, La Presse, 16 décembre 2013
- "Azami
: premier épisode du nouveau cycle romanesque d'Aki Shimazaki",
Laurence Houot, France Info, 4 janvier 2015
- "Aki
Shimazaki, des petits romans comme des bulles", Alice Monard,
Journal du Japon, 5 février 2015
- "Azami
ou ennemi : le nouveau cycle d’Aki Shimazaki", Virginie
Bloch-Lainé, Libération, 19 juin 2015
-"Aki
Shimazaki : la méthode Shimazaki", Josée Lapointe,
La Presse, 15 novembre 2015
- "Amour
maternel", Thierry Guinhut, Le Matricule des Anges, n° 174
, juin 2016
- "Suisen
:
cours de lucidité", Josée Lapointe, La Presse,
7 décembre 2016
- "Aki
Shimazaki : Suisen", Libération, 17 mars
2017
-
"Suisen d’Aki Shimazaki ou le désarroi du narcisse",
Le Temps, 9 juin 2017
- "Suisen",
Pierre Boivin, Nuit blanche, 22 juin 2017.
Sur Maïma
- "Maïmaï
:
histoires de famille", Luc Boulanger, La Presse, 14 novembre
2018
- "Maïma",
Télérama, Martine Landrot, 2 avril 2019
- "L’élégance
cachottière de l’escargot", Le Temps, 7 avril
2019
- "Maïma,
le dernier roman d'Aki Shimazaki, reine de la "pentalogie",
Laurence Houot, France Info,27 avril 2019
- "Suzuran
: état contemplatif", Iris Gagnon-Paradis, La Presse,
10 octobre 2019
Sur Fuki-no-tô
- "Un
univers japonais sans surprise", La Liberté, 17
juillet 2018
- "Aki
Shimazaki : Fuki-no-tô, des amours emmêlées comme un
champ de bambous", Laurence Houot, France Info, 26 avril
2018
- Lecture d'un extrait "Les
lectures d'Alexandra Lemasson", avril 2018, 2 min 23
- "Fuki-no-tô
: l'amour comme un bosquet de bambous", Laila Maalouf, La
Presse, 11 octobre 2017
- Télérama,
Martine Landrot, 22 mai 2018
›
Un entretien de fond
"Aki
Shimazaki : ce qu’on ne peut pas dire", entrevue réalisée
par Linda Amyot, revue québécoise Nuit blanche, n° 108,
automne 2007.
›
Des travaux universitaires (pour des
fanas qui voudraient approfondir...) :
- Un mémoire de maîtrise Poétique
du secret dans la saga d’Aki Shimazaki, Marie-Hélène
Lemieux, Université de Montréal, 2004
- "De
la mémoire vive au dire atténué : l'écriture
d'Aki Shimazaki", Lucie Lequin, revue Voix et images : littérature
québecoise, volume 31, n° 1, automne 2005, "Figures
et contre-figures de l'orientalisme"
- "Le fardeau
des identités dans Tsubane d’Aki Shimazaki", Fred
Dervin, Dialogues francophones, n°15, 2009
- Le poids des identités :
mémoire et traumatisme chez Aki Shimazaki, dir. Frédéric
Dervin, Editions universitaires européennes, 2010 (premier livre
sur cette auteure)
- "Le
mythe du bilinguisme littéraire – cas d’Aki Shimazaki",
Yukiko Kano, Communication au 53e congrès annuel du Conseil
International d'Etudes Francophones (CIEF) à Aix-en-Provence, le
30 mai 2011
- "L'influence
des cultures chez Aki Shimazaki", Marie-Claire Pharand, Revue
du Cavalier Bleu, février 2013
- Une thèse de philosophie de Ziyan YANG : Pour
désorienter une autoethnographie orientale : une étude
des représentations identitaires chez quatre écrivains québécois
d'origine asiatique (dont Aki Shimazaki), Halifax, Dalhousie University,
2014
- Le
traumatisme, la culture, et l'identité chez Aki Shimazaki : Le
poids des secrets et les défauts de la société
japonaise (mémoire de licence en lettres) Devon Michael John
Robert Morgan, Halifax, Canada, 2014
- "Savourer le
Japon d'Aki Shimazaki", Marie-Christine Lambert-Perreault, Cuizine
: la revue des cultures culinaires au Canada, n°1, 2019
- "Le
déchirement du 'wa' japonais : histoire (s) d'Aki Shimazaki",
Peter Schulman, Chimères,
revue des littératures et cultures françaises et francophones,
University of Kansas, printemps 2020.
•SES
ŒUVRES PUBLIÉES (présentations de l'éditeur)
| Premier
cycle de 5 romans courts :
Le
poids des secrets |
 |
Tsubaki,
1999
Prix
de la Société des écrivains canadiens
Quatrième de couverture
: À la mort de sa mère, survivante de la bombe atomique
de Nagasaki, Namiko se voit remettre deux enveloppes. La première
est adressée à un oncle maternel dont elle ignorait
l’existence et qu’elle est chargée de retrouver.
La seconde contient une lettre en forme de confession à sa
fille, sans laquelle elle n’aurait pu partir en paix. Elle y
raconte son quotidien pendant la guerre, son premier amour, et révèle
le secret qui l’a poussée à commettre l’indicible. |
 |
Hamaguri,
2000
Prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec
Quatrième de couverture
: Enfant illégitime, Yukio est très
attaché à une petite fille avec laquelle il joue quand
elle vient au parc avec son père. Le jour où sa mère
se marie, ils quittent Tokyo pour Nagasaki. Une autre vie commence,
avec enfin une figure paternelle, mais Yukio reste d’un naturel
solitaire. Il pense souvent à la fillette qui l’avait
demandé en mariage et dont il garde un souvenir aussi doux
que vague. À l’adolescence, pendant la Seconde Guerre
mondiale, il tombe amoureux de sa nouvelle voisine mais ne peut
oublier sa promesse d’enfant…
|
 |
Tsubame,
2001
Quatrième de couverture
: La jeune Yonhi vit à Tokyo avec sa mère et son oncle,
venus de Corée avant sa naissance. Afin de la protéger
d’émeutes contre leur communauté, à la
suite du tremblement de terre qui a dévasté le Kanto
en 1923, sa mère la confie à un prêtre catholique,
qui la met à l’abri dans son orphelinat. Désormais
cachée sous un nom japonais, coupée de son histoire
familiale, Yonhi ne découvrira que des années plus
tard le secret de ses racines.
|
 |
Wasurenagusa,
2003
Prix
littéraire Canada-Japon du Conseil des Arts du Canada
Quatrième de couverture
: Héritier d’une noble famille de la cour impériale,
Kenji Takahashi a divorcé, au grand dam de ses parents qui
ne songent qu’à #F8FFF2le remarier à une femme
de bonne lignée. Mais il est stérile et préférerait
garder ce secret pour lui. Lorsqu’il tombe amoureux de Mariko,
orpheline et mère célibataire, il sait que ses projets
risquent de se heurter à la volonté parentale. Il
puise son courage dans le souvenir de Sono, la nurse qui s’est
occupée de lui et à laquelle il reste très
attaché, mais qui s’est exilée en Mandchourie.
|
 |
Hotaru,
2004
Prix
du Gouverneur général du Canada
Quatrième de couverture
: L’étudiante en archéologie Tsubaki aime tendrement
sa grand-mère Mariko, à qui elle a toujours confié
ses tourments intimes et amoureux. Depuis une commotion cérébrale,
la vieille dame désormais veuve semble victime d’hallucinations,
et ses jours sont comptés. De la confusion de ses propos
se détache pourtant une histoire d’innocence abusée
qui concerne la jeune fille qu’elle était.
|
| Deuxième
cycle de 5 romans courts : Au
cœur du Yamato |
|
|
Mitsuba,
2006
Premier Prix de l'Algue
d'Or en France
Quatrième de couverture
: Le bientôt trentenaire Takashi Aoki, employé dans
la compagnie d’import-export Goshima de Tokyo, est appelé
à un brillant avenir professionnel. Ne manque à son
bonheur qu’une épouse avec laquelle fonder une famille.
Il résiste aux propositions de mariage arrangé qu’on
lui présente car il est très attiré par la
réceptionniste de sa société. Alors qu’il
parvient à obtenir un rendez-vous avec elle, son supérieur
lui annonce qu’on lui offre un poste important dans une succursale
à l’étranger.
|
 |
|
Zakuro,
2008
Quatrième de couverture
: Voilà vingt-cinq ans que Bânzo Toda est porté
disparu – depuis sa déportation dans un camp de travaux
forcés en Sibérie, à la fin de la guerre. Sa
femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer, n’a jamais
perdu l’espoir de le revoir. Quand leur fils Tsuyoshi découvre
que son père vit depuis des années dans une ville
toute proche, qu’il a changé de nom et s’est remarié,
il veut comprendre.
|
 |
|
Tonbo,
2010
Quatrième de couverture
: Après avoir travaillé sept ans pour la grande compagnie
Goshima de Tokyo, Nobu s’est trouvé contraint de démissionner.
Il a alors ouvert un juku, où il donne des cours complémentaires
pour collégiens. Il réalise ainsi le rêve de
son père, professeur de lycée passionné par
son métier, qui s’est suicidé il y a quinze ans.
Un jour, l’un des anciens élèves de celui-ci
le contacte et insiste pour le rencontre
|
 |
|
Tsukushi,
2012
Quatrième de couverture
: Quand, à la surprise générale, Yûko
s’est fiancée avec un riche héritier, encore
célibataire à trente-cinq ans, elle venait d’apprendre
qu’elle était enceinte d’un autre. Son futur mari
a accueilli la nouvelle avec discrétion et sérénité,
et il s’est montré un père exemplaire pour la
petite fille. Alors que celle-ci fête ses treize ans, Yûko
découvre que leur secret parental en cache un autre, de nature
à ébranler l’harmonie familiale et son bonheur
conjugal…
|
 |
|
Yamabuki,
2013
Prix
littéraire de l'Asie de l'Association des écrivains
de langue française (ADELF)
Quatrième de couverture
: Il y a près de cinquante-six ans, Aïko s’unissait
à celui dont elle était tombée amoureuse au
premier regard échangé dans un train. Après
un mariage raté conclu par un divorce, elle n’espérait
pas vivre une histoire aussi passionnée qu’harmonieuse.
Pour sa petite-nièce, qui va bientôt se marier et s’interroge
sur la pérennité du lien conjugal, elle se remémore
un demi-siècle d’amour profond au côté
de son samurai.
|
 |
|
Troisième
cycle de 5 romans courts : L'ombre
du chardon |
 |
Azami,
2014
Quatrième de couverture
: Mitsuo Kawano, trentenaire, est installé dans une vie qui
lui convient. Père d’un garçon et d’une
fille, il s’est habitué à son couple sans surprise
mais sans problème. Rédacteur culturel, il envisage
de fonder sa propre revue d’histoire. Un soir qu’il accompagne
dans un bar très sélect un camarade d’école
primaire croisé par hasard, il est surpris d’y retrouver
la belle Mitsuko, son premier amour d’enfance, qui travaille
là comme entraîneuse.
|
 |
Hôzuki,
2015
Quatrième de couverture
: Mitsuko tient une librairie d’occasion. Elle vit au-dessus
de sa boutique avec sa mère et son fils de bientôt
sept ans, Tarô, un métis sourd-muet. Chaque vendredi
soir, cette femme séduisante et cultivée travaille
comme entraîneuse dans un bar chic où cadres, intellectuels
et chefs d’entreprise apprécient sa conversation. Cette
activité insolite garantit sa précieuse indépendance.
Un jour, une cliente de la librairie dont la petite fille s’est
spontanément liée d’amitié avec Tarô
les invite chez elle.
|
 |
Suisen,
2016
Quatrième de couverture
: Chef d’une prospère entreprise d’importation
d’alcools, mari et père de famille, Gorô est plutôt
fier de lui. Ses seuls soucis concernent ses premiers cheveux gris,
et l’organisation de son temps privé à partager
entre épouse et maîtresses. Il accorde une grande importance
à l’argent et au pouvoir, signes incontestables de réussite.
Il veut pouvoir compter sur la docilité de ses femmes et
prétend peser sur les choix d’études et de vie
de ses enfants. Il se considère comme un modèle à
suivre, mais certaines circonstances vont l’obliger à
se regarder en face.
|
 |
Fuki-no-tô,
2017
Quatrième de couverture
: Après des années passées en ville, Atsuko
s’est installée avec sa famille dans le village où
elle avait fondé une petite ferme biologique. Une amie de
jeunesse, brusquement perdue de vue à l’époque,
resurgit dans sa vie.
|
 |
Maïmaï,
2018
Quatrième de couverture :
Tarô, artiste sourd-muet et métis, vient de perdre
subitement sa mère. Une jeune fille venue lui présenter
ses condoléances suscite en lui un trouble profond, comme
un amour naissant, comme un précieux souvenir.
|
| Quatrième
cycle (un
titre publié actuellement) |
|
|
Suzuran,
2019
Quatrième de couverture
: Anzu est céramiste. Elle habite
seule avec son fils depuis son divorce et ne souhaite pas se remarier.
Elle s’épanouit pleinement dans un quotidien calme rythmé
par la pratique de son art. Sa douceur nature#F8FFF2lle est à
l’image de sa vie, dans une petite ville au bord de la mer
du Japon et au pied du mont Daisen. Sa sœur aînée,
célibataire et séductrice impénitente qui vient
de se fiancer, annonce qu’elle viendra de Tokyo présenter
à sa famille l’heureux élu.
|
 |
Des objets livres...
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
     |
|
à
la folie
grand ouvert
|
beaucoup
¾ ouvert
|
moyennement
à moitié
|
un
peu
ouvert ¼
|
pas
du tout
fermé !
|
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|