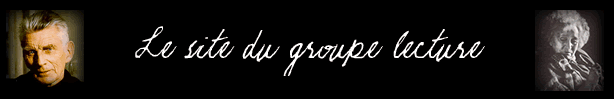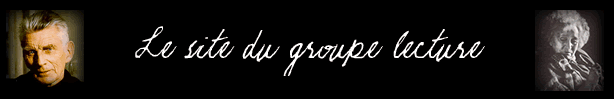|
Quatrième de couverture :
1926. Un jeune docteur en philosophie de Budapest arrive à Paris
pour quelques mois. Étranger à ce pays qui le fascine et
le rejette à la fois, il évolue parmi d’autres étrangers
qui, comme lui, survivent tant bien que mal. Récit initiatique,
fabuleuse peinture de Paris, ce roman largement autobiographique est une
troublante réflexion sur l’exil, autant réel qu’intérieur,
qui a nourri la vie et l’œuvre de Sándor Márai.
"Comme Zweig, Sándor Márai décrit avec
une élégance rare le crépuscule pathétique
d'une civilisation qui va être noyée sous les cendres du
nazisme et du communisme" (La Vie).
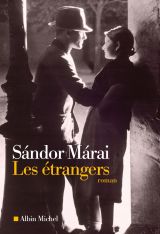 Les
étrangers, Albin Michel, 2012, 464 p.
Les
étrangers, Albin Michel, 2012, 464 p.
(Couverture : Couple
d'amoureux sous un réverbère, Halasz Gyula, 1899-1964,
dit Brassaï, né en Transylvanie, alors partie intégrante
du royaume de Hongrie,
1933, coll. particulière)
Quatrième de couverture :
Écrit en 1930 après un séjour de cinq ans à
Paris, ce "roman français" d'inspiration autobiographique
est un texte important dans l'œuvre de l'immense écrivain
hongrois Sándor Márai.
1926. Après un an d'études à Berlin, un jeune docteur
en philosophie de Budapest arrive à Paris pour quelques mois. Étranger
à ce pays qui le fascine et le rejette à la fois, il évolue
parmi d'autres étrangers. Comme lui, tous survivent
tant bien que mal dans le Paris de la fin des années folles, des
cales de Montparnasse aux hôtels miteux du quartier latin. Philosophe
déraciné, exilé volontaire, promeneur inquiet...
l'identité floue du personnage évolue au gré d'une
errance qui se prolonge dans une Bretagne idyllique où l'entraîne
une femme rencontrée par hasard.
Récit initiatique, fabuleuse peinture de Paris, ce livre est une
troublante réflexion sur l'exil, autant réel qu'intérieur,
qui a nourri la vie et l'œuvre de Sándor
Márai.
|
|
Sándor MÁRAI (1890-1989)
Les étrangers (1930, traduction 2012)
Nos
23 cotes d'amour
 | |