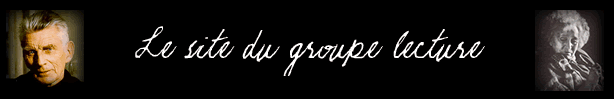
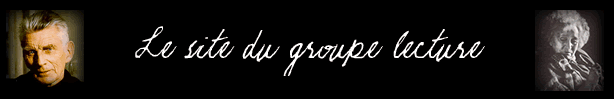 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Quatrième
de couverture : Au jeune étudiant rentré
au pays après un séjour en Europe, Moustafa Saïd entreprend
de raconter son histoire : celle d´un destin déchiré
entre la vie immémoriale de l´Afrique et le mouvement de
l´Occident. Première traduction : |
Tayeb Salih (1929-2009)
|
||||||||||||||||||
|
Nos 17 cotes
d'amour |
Sabine![]() (avis
transmis de Nîmes)
(avis
transmis de Nîmes)
C'est
un livre qui mérite - ou exige - une lecture en continu, sans trop
d'interruptions, et j'ai malheureusement mis plus de dix jours à
le lire, me perdant avec les narrateurs, volontairement mêlés
par l'auteur.
J'ai été saisie par les premières pages et la façon
dont on entre dans le récit très "sexué"
: "Nous avions peur
que tu nous ramènes une chrétienne, non excisée".
Il y a plusieurs passages, notamment la fin avec Jean Morris, consacrés
à la sexualité ; c'est souvent très cru, sanglant
et morbide. Ce n'est pas du Sade, mais ce n'est pas loin. Les femmes ne
sont pas en reste et s'apparentent à des succubes. La description
que Moustafa Saïd fait de lui enfant est étonnante : les liens
avec sa mère sont glaçants (p.
30-31) ; sa précocité nous tient en haleine. Le suspense
alterne avec des moments très poétiques : "la
lumière réfléchie sur son visage, ses yeux séducteurs
au-dedans de lui-même, me sembla-t-il, les ténèbres
alentour complotant, forces démoniaques, à étouffer
l'éclairante lanterne" (p. 52).
Et je saute directement à la page 145 où Moustafa séduit
Ann : "Mais j'étais
inspiré ce soir-là, je sentais les mensonges courir sur
ma langue comme paroles consacrées." Il y a des
passages très forts par l'intensité de l'histoire et par
la force de l'écriture que je trouve vraiment poétique.
Dans le même temps, je me suis sentie un peu perdue parfois. Ce
qui me conduit à n'ouvrir le livre qu'aux trois-quarts, ce qui
est déjà pas mal ! Je vous souhaite une bonne soirée
et j'ai hâte de découvrir vos avis.
Fanny![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Au début de ma lecture, j'ai été saisie par l'intrigue,
j'avais envie de découvrir quel complot ou vengeance avait pu conduire
à la disparition de Moustafa Saïd. Je m'attendais à
une sorte d'enquête à rebours qui permettrait aussi de découvrir
un peu le Soudan. J'ai également trouvé le style poétique.
Cependant j'ai déchanté tout au long de ma lecture. Du parcours
de Moustafa Saïd, tout est dit dès sa rencontre avec le narrateur.
Je n'ai pas réussi à vraiment m'intéresser aux autres
personnages dont le parcours est pour moi resté au stade d'intrigues
secondaires, malgré des portraits de femmes parfois hauts en couleur.
Le style de poétique m'est vite apparu lourd et emphatique.
Je salue l'engagement du livre et son côté probablement subversif
dans le contexte du Soudan, mais cet intérêt n'a pas suffi
à satisfaire mon plaisir de lecteur.
J'ouvre ¼, et comme toujours hâte de vous lire à défaut
de vous entendre.
Danièle![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
À toute vitesse, car je comptais venir, mais me voici pratiquement
aphone et préfère donc vous communiquer quelques notes au
sujet de ce livre.
Je relèverai tout d'abord ce qui fait à mon avis sa particularité :
sa langue, son écriture, sans doute bien rendues par la traduction,
un style relevé (au début, "Messieurs", comme
dans un discours) mais déroutant pour nos oreilles occidentales,
un emploi du passé simple étonnant, des structures de phrases
incongrues ("d'impatience,
je refusais le thé"), une grande élégance
du narrateur qui prend ses distances… Tout cela donne un charme exotique
à la lecture, on plonge dans un monde tout à fait autre.
Et pourtant, les deux narrateurs principaux (le narrateur et Mustafa
Saïd) ont suivi un cursus occidental et cosmopolite. On oscille entre
mentalité africaine et mœurs occidentales, spécialement
en ce qui concerne la place de la femme dans la société.
C'est l'un des grands intérêts du livre.
Souvent la chronologie est bousculée, on passe de la trame événementielle
à des sortes de flashbacks. Le passage d'un narrateur à
l'autre sans démarcation annoncée contribue à un
certain flou qui parfois m'a perdue.
La multiplicité des personnages et quelques grands vides dans la
chronologie m'ont aussi perturbée.
Je retiens l'idée d'une société un peu perdue, ou
alors, c'est moi qui étais perdue !...
J'ouvre à moitié.
Monique L![]()
Ce livre traite principalement du colonialisme et du conflit entre traditions
locales et modèle occidental. Rien de très original donc,
mais ce qui fait la grande force de ce roman est qu'il n'est pas théorique.
Il décrit des situations et des faits vus par un Soudanais qui
aime son pays et le connaît profondément. Ce n'est pas manichéen.
L'auteur nous laisse le soin de se faire notre propre vérité.
C'est très dépaysant. Il est question de divergences de
visions entre deux univers : celui du Soudan traditionnel et celui
de l'Occident, en l'occurrence l'Angleterre, mais aussi de fantasmes et
de fascinations entre ces deux mondes. C'est à la fois critique
et nostalgique.
L'auteur dresse une critique acerbe de la société traditionnelle
soudanaise patriarcale et machiste. Il aborde le poids de la tradition
et de la religion, la condition des femmes, la corruption, le clientélisme
et une critique de l'époque postcoloniale du pays. C'est aussi
un roman sur l'identité et l'altérité. "À
tous ceux qui ne voient que d'un seul œil et parlent une seule langue,
a ceux pour qui les choses sont blanches ou noires, orientales ou occidentales".
C'est très dépaysant de plonger dans la vie d'un clan du
Nord Soudan, où les rites ont la peau dure. Cette confrontation
entre modernité et tradition, entre émancipation et conservatisme,
est décrite par le narrateur grâce à sa propre expérience,
mais aussi à son enquête sur le personnage de Mustafa Saïd.
J'ai été intéressée par ce personnage atypique,
brillant et torturé qui nous est dévoilé petit à
petit.
J'ai trouvé la construction de ce récit très efficace.
Cela nous permet de changer d'angle de vue, on se retrouve avec les yeux
d'un Soudanais. Bien qu'ils soient très différents, un parallélisme
entre le narrateur et Mustafa Saïd saute aux yeux : le narrateur
ressent et vit des expériences qui font écho à la
vie de Mustafa.
Le récit met un certain temps à s'installer, avec des personnages
abordés avec détachement par l'auteur, sans donner des justifications
à leurs actes. J'ai aimé le ton du narrateur et sa façon
très nuancée et pleine de sagesse de se positionner. Certains
personnages m'ont spécialement intéressée : le grand-père,
Mahjoub, Hasna.
Des passages m'ont spécialement marquée :
- la description pleine d'exotisme de l'appartement de Mustafa à
Londres
- le voyage du narrateur à travers le désert en route vers
Khartoum
- la discussion autour du mariage de Hasna
- la description du fossé grandissant entre le narrateur et son
ami resté au village qui reste prisonnier de la tradition.
C'est un roman très bien écrit, avec une écriture
travaillée, poétique, imagée, précise et pleine
de métaphores. Ça a été un vrai plaisir de
lecture.
À noter que le parallèle entre le narrateur et Saïd
est mené jusqu'à la fin. Alors que Saïd meurt noyé
dans le Nil, le narrateur qui risque de subir le même sort se ressaisit
et rassemble ses dernières forces pour crier : au secours !
J'ouvre le livre aux
¾.
Catherine![]()
Je ne connaissais sais pas cet auteur et n'ai d'ailleurs jamais lu d'auteur
soudanais. Je me suis laissé embarquer par l'histoire et je l'ai
lu d'une traite. C'est un roman intéressant, j'ai beaucoup aimé
l'écriture et la construction avec cette double narration. Mais
au fond, je ne sais pas très bien ce que j'en pense.
Moustafa est un personnage assez fascinant mais perturbant. Il quitte
le Soudan pour aller faire des études à Londres, il est
extrêmement brillant mais semble dénué de sentiments.
Il se venge des colonisateurs anglais à travers les femmes, en
usant des clichés et des fantasmes des Occidentaux sur l'Orient.
À cet égard, la description de la chambre à Londres
dans laquelle il emmène ses conquêtes est extraordinaire.
Il séduit ces femmes jusqu'à les conduire au suicide. Il
tombe ensuite sur une femme qui lui résiste, avec laquelle il a
une relation complètement sadomasochiste, qui se finit par un meurtre.
Celui-ci est décrit avec un luxe de détails. C'est donc
poussé assez loin, un peu au-delà de la vraisemblance, ce
qui m'a un peu gênée.
On découvre son histoire petit à petit, à travers
le narrateur, plus jeune, qui a un destin assez similaire puisqu'il va
lui aussi étudier en Angleterre, mais à son retour retrouve
sa place dans sa famille et devient haut fonctionnaire.
J'ai beaucoup aimé la description du village, des habitants, du
Nil, du désert. Il y a des moments d'humour, en particulier la
soirée avec le grand-père, Bint Mahjoub et Wade Rayyes.
Et il y a aussi de la poésie, la traversée du désert
en voiture et la fête improvisée à l'arrivée
de la nuit est un des plus beaux passages. Il y a aussi une critique acerbe
des élites soudanaises, de leurs richesses et de leur éloignement
du quotidien du peuple. La place des femmes soudanaises, excisées,
mariées contre leur gré, à la merci de leurs maris,
frères et pères, est aussi largement évoquée.
J'ai appris beaucoup de choses sur le Soudan (je ne savais pas que Soudan
était de langue arabe donc je partais de loin !).
Il y a une vraie tension dramatique dans le récit qui m'a tenue
en haleine jusqu'à la fin, le mariage contre son gré, avec
un homme de 40 ans plus âgé, de Hasna, la femme de Moustafa,
qui veut lui rester fidèle et tue son mari avant de se suicider,
scène là aussi décrite avec un luxe de détails,
et la presque noyade du narrateur, dans une espèce de fascination
morbide avec son double Moustafa. La découverte de la chambre secrète,
remplie de livres occidentaux sans aucun ouvrage arabe, achève
la description du personnage de Moustafa écartelé entre
deux mondes. J'ai plutôt considéré que le narrateur
survivait, mais il reste une incertitude, de même que l'on n'est
pas tout à fait certain de la noyade de Moustafa. L'ensemble est
troublant.
Mais c'est un livre très dense et très riche, magnifiquement
écrit. Au final, après hésitation, je l'ouvre aux
¾.
Annick
L![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
C'est un roman très intéressant, vraiment dépaysant,
qui nous fait adopter un point de vue insolite sur les effets de la colonisation,
mais aussi sur le poids des traditions dans ce paysà l'époque,
en particulier en ce qui concerne le statut des femmes.
Les descriptions sont concrètes, imagées, voire poétiques...,
celles de la vie quotidienne dans les campagnes, du fleuve Nil avec ses
caprices, des relations sociales, voire de l'évolution de la société
soudanaise dans la capitale pour les élites. La scène du
retour en 4X4 à travers le désert jusqu'à Khartoum
est magistrale. Et les dialogues entre les personnages qui vivent encore
au pays complètent ce tableau.
Le narrateur ne manque pas lui-même de dénoncer tous les
travers qu'il peut observer, lui qui a fait ses études en Europe
et qui, du coup, a pris du recul.
Mais j'ai été très gênée par la figure
de Moustafa Saïd, qui émerge peu à peu à travers
son propre récit et les témoignages de plusieurs témoins.
Je trouve qu'il est trop cynique, trop mégalomane, trop odieux,
ce brillant économiste qui gâche son talent, trop occupé
à enrichir son tableau de chasse de femmes blanches en quête
d'aventures exotiques. Ce personnage est presque une incarnation du Mal
- on dirait aujourd'hui qu'il est toxique - avec son cortège de
"victimes" féminines. Il ne tient que par la relation
de miroir qu'il entretient avec le narrateur, d'abord fasciné,
qui, lui, a su retrouver sa place parmi les siens. J'ai trouvé
enfin excessive la violence de la scène sado-maso avec Jean Morris,
ainsi que celle du massacre final au village entre Hasna et le vieux Wad
Rayyes. Qu'est-ce que ça apporte au récit ?
J'ouvre donc à moitié, pour la découverte de ce "continent"
inconnu.
Rozenn![]()
J'ai lu le livre deux fois, quand il était question de le programmer
et pour cette séance. La première fois, il m'avait intéressée
et j'avais poussé à ce qu'on le programme. J'ai aimé
les dialogues au village entre les vieux, surtout la façon de parler
de la sexualité de la vieille femme. Agréable à lire,
intéressant, différent.
Quand je l'ai relu, je l'ai découvert beaucoup plus subtil, plus
riche encore.
Il est construit en miroir, avec deux personnages, avec les parcours du
narrateur et du héros ; et deux chambres à Londres et au
village.
Il met en scène l'opposition des deux cultures (occidentale et
orientale), les difficultés qu'elle suscitent chez les migrants,
l'impossibilité d'être pluriels.
Les articles
mis en ligne m'ont fait comprendre que l'exagération des deux chambres,
la violence des rapports du héros avec les femmes qu'il séduit
à Londres, dénoncent les préjugés sur l'orientalisme,
ce qui m'avait gênée, mais qui se justifie alors.
Il faudrait peut-être le relire une troisième fois.
J'ai commencé à lire ses nouvelles : pas assez pour avoir
un avis mais je continuerai certainement.
Brigitte![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
Je ne connaissais absolument pas cet écrivain du siècle
dernier. Bien que racontant des événements vieux de presque
cent ans, ce roman se lit quasiment comme un roman moderne. Il s'agit
du choc de deux cultures : celle de l'Occident (britannique) et celle
de l'Orient (Égypte, Soudan).
L'intrigue n'a que peu d'importance ici, ce qui compte c'est l'écriture
tellement flamboyante, originale… Elle prend beaucoup de libertés
avec les règles usuelles, mais le lecteur s'y retrouve.
Quelques citations de passages qui m'ont particulièrement frappée
:
p. 40 : "Je la prenais et c'était prendre un nuage, cerner un météore, chevaucher un hymne militaire prussien."
p. 97 : "Malgré tous les efforts que nous avons fournis à vous éduquer, vous avez continuellement l'air de sortir pour la première fois de la forêt vierge."
p. 112 : "Où donc était l'ombre, ô mon Dieu ! Une pareille terre ne produit que des prophètes !"
p. 145 : "Mais j'étais inspiré ce soir-là, je sentais les mensonges courir sur ma langue comme paroles consacrées."
p. 146 : La rencontre entre Ann Hammond et Moustafa : Ann l'anglaise, orientaliste passionnée, et Moustafa le Soudanais, qui "rêve du Nord et de la blanche gelée" ; "Malgré la certitude de nos mensonges, je pressentais que, d'une certaine façon, nous disions la vérité."
Je remarque que les deux personnages
(Moustafa et le narrateur) qui ont pénétré profondément
la culture occidentale, considèrent comme normal que Hasna Bint
Mahmoud décide seule de la façon dont elle va organiser
son existence de veuve. On aurait pu attendre de leur ami Mahjoub une
semblable ouverture d'esprit, mais non !
J'ouvre aux ¾.
Clarisse![]()
C'est amusant parce que je me souviens de la couverture du livre et je
suis persuadée d'avoir lu ce livre, sans en avoir aucun souvenir.
L'histoire n'est guère marquante et l'enchevêtrement des
récits l'un dans l'autre n'a pas d'intérêt particulier.
Néanmoins quel bonheur de lire un livre aussi court et concis après
La Storia de Morante !
La langue de Tayeb Salih est douce comme les grains de sable des déserts
soudanais.
Mais la manière dont les femmes sont traitées dans le récit
de Moustafa Saïd fait froid dans le dos. Le traitement des femmes
à la fois en Angleterre et au Soudan, où finalement elles
sont vues comme des objets passifs de satisfaction.
Je ne comprends pas pourquoi certains personnages font ce qu'ils font
et l'obsession du narrateur pour Moustafa Saïd. Le lecteur en sait
finalement très peu sur la vie du narrateur, ce qui nous interroge
finalement sur son utilité. Il n'est que conteur et a un regard
semi-occidental sur les événements.
Il est intéressant de noter à quel point les meurtres de
Moustafa Saïd sont dépénalisés alors que le
drame de son ancienne femme est tourné en une horreur macabre dont
elle est la seule responsable, alors qu'elle essayait simplement de se
dépêtrer d'un mariage forcé. Les horreurs de la Deuxième
Guerre mondiale à Rome nous manqueraient presque...
Jacqueline![]()
C'est un livre extrêmement
riche en peu de pages.
J'ai été séduite par la langue, recherchée,
souvent poétique, avec des inversions inhabituelles.
Plus que l'affrontement entre deux cultures, "traditionnelle"
et occidentale, il m'a semblé que le livre traitait du mélange
des cultures, de leur évolution et de leur interpénétration
au fur et à mesure des rencontres…
Moustafa Saïd ne m'est pas apparu comme un personnage vraiment antipathique
et responsable du malheur des autres, mais plutôt comme un homme
sans racines ni attachement, jusqu'à son arrivée au village
où il mène une vie tout à fait traditionnelle avec
une femme et deux enfants. Dans le village, il n'est pas complètement
accepté, mais son expérience, ce qu'il a appris ailleurs,
lui permet de donner des conseils et de jouer un rôle social. Il
est intégré tout en restant étranger.
J'ai aimé la construction du roman, la quête du narrateur
qui m'a rappelé celle du narrateur de Mohamed Mbougar Sarr dans
La
plus secrète mémoire des hommes. Je me suis intéressée
au parallèle entre le parcours du narrateur et celui de Moustafa
Saïd : poussés par les Anglais, ils ont fait des études
un peu semblables, mais leur intégration dans la société
qu'ils avaient quittée est différente comme l'époque
où ils sont partis.
Il me paraît tout à fait injuste d'imputer à Moustafa
Saïd la mort de Hasna. Le narrateur aurait pu lui sauver la vie en
l'épousant après son veuvage, d'ailleurs on les sent un
peu amoureux, mais il a une femme et une vie plus occidentale. Par son
refus, serait-il lui aussi responsable de sa mort ?
J'ai aimé la tension de ce récit qui se lit comme un conte.
D'ailleurs la chambre secrète n'est-elle pas une espèce
de chambre de Barbe bleue ?
Le titre parle de "migration vers le Nord". Vers la fin il y
a une très belle image d'oiseaux migrateurs sur le Nil. Au début,
j'ai pensé que le Nord c'était l'Angleterre, mais c'est
aussi Khartoum où le narrateur a des fonctions dont, au village,
on dit à juste titre : vous, vous êtes en dehors de notre
vie. Il me semble que l'action se passe au Sud du Soudan, Sud qui
n'était pas encore indépendant quand le livre a été
écrit. La différence de culture concerne la culture occidentale
et la colonisation européenne, mais aussi, il me semble, la culture
arabe qui, par une colonisation antérieure, s'est superposée
à l'ancienne culture tribale …
Ce roman pose des questions passionnantes sur un pays que je ne connaissais
pas.
Il y a la poésie et la culture arabes, et j'ai pensé au
livre qu'on avait lu de Wauters, Mahmoud
ou la montée des eaux.
J'aime et j'ai envie d'y revenir. J'ouvre aux ¾ car je n'ai pas
tout de suite su apprécier la construction.
Renée entre![]() et
et
![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
Ce roman m'a énormément plu au début pour l'exotisme
et l'écriture qui est très poétique. Nous apprenons
à connaître la vie de ces gens : patriarcat, plusieurs épouses
facilement répudiées, excision, etc. L'analyse de la colonisation
pose des questions intéressantes.
J'ai aimé les discussions entre eux sur l'excision..., loi de l'Islam
ou pas ? (P. 84 et 85). J'ai aimé la liberté avec laquelle
ils parlent de sexe. Un père peut marier sa fille sans son consentement,
avec un vieillard ! On sent les réticences du narrateur vis-à-vis
des coutumes de son pays natal. L'Europe lui a ouvert un autre monde moins
patriarcal.
Mystères : concernant la noyade de Moustafa Saïd, s'est-il
réellement noyé ou a-t-il profité de la crue pour
disparaître et vivre une troisième vie ? Est-ce qu'il a été
agent secret à Londres ? Quel pouvoir exerçait-il sur son
épouse soudanaise, vu sa fidélité au-delà
de la mort, et la violence mise en œuvre pour tuer son vieux mari,
puis se suicider ?
Moustafa a choisi ce jeune qu'on dit poète pour perpétuer
sa légende d'homme tiraillé entre les deux mondes : l'Occident
et l'Afrique. MAIS le narrateur n'est pas dupe : "Sa
fatuité, son égocentrisme, me paraissaient sans limites
? Il aurait voulu... être éternisé par l'Histoire".
Mrs Robinson, comme tout le monde, adore Moustafa et pense qu'il est un
homme bien, même après avoir assassiné sa femme :
je pense que c'est un pervers (voir son attitude avec les femmes à
Londres) qui cache son jeu dans la vie courante.
C'est un beau roman d'une grande richesse, qui pose des questions.
Cependant, mon prosaïsme ne comprend absolument pas le meurtre de
Jean par son mari. D'accord, elle le torturait, leurs rapports étaient
sadiques, mais pousser des jeux érotiques jusqu'à la mort
? "Je souffrais (...),
cela me procurait du plaisir. Je prenais goût à la souffrance"
Je veux bien le croire. MAIS Je doute qu'elle dise :
"Je t'aime, ô mon amant" avec un poignard dans
le cœur. C'est trop pour mon mental étroit. Ça m'a
vraiment gâché le roman.
J'hésite entre ½ et ¾.
Jérémy![]()
Avant la lecture : Je ne connaissais pas l'auteur, n'en avais pas
entendu parler et je ne suis pas intéressé spontanément
par la littérature africaine. Je n'avais pas d'apriori positif
ou négatif avant de commencer la lecture si ce n'est que la libraire
m'a dit que c'était un très beau livre quand je l'ai acheté
!
Après la lecture : J'ai été agréablement
surpris. Je rejoins ce que disait Jacqueline. Oui, c'est un livre court
mais riche et dense, qui laisse beaucoup de questions en suspens, qui
ouvre beaucoup de pistes. Nos débats montrent que ce n'est pas
un livre univoque, c'est un livre qui laisse toute sa place au lecteur,
qui le laisse travailler. Il ne nous donne pas tout et laisse sa place
au mystère et à une multiplicité d'interprétations
possibles. Pour moi c'est le signe que c'est un bon livre.
Il y a des scènes à la fois belles et cruelles, notamment
celle du meurtre de Wad Rayyes. Mais je ne vous rejoins pas pour dire
que Moustafa Saïd est horrible et cruel. Oui, c'est un séducteur
impénitent, mais qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il les pousse
au suicide ? C'est peut-être le cas, mais là encore je trouve
que ce n'est pas explicite, c'est une interprétation du lecteur.
Il y a un "faisceau d'indices" : il est le dénominateur
commun de ces suicides et cela arrive à plusieurs reprises. Mais
un faisceau d'indices ne fait pas une preuve. Et pour ce qui concerne
le meurtre de Jean, si j'étais l'avocat de Saïd, je plaiderais
le suicide par personne interposée. Il la "suicide" plus
qu'il ne la tue ! En tout cas, elle sait très bien ce qui est en
train de se passer, elle voit la mort arriver et ne se débat pas,
ne résiste pas, elle voit la mort arriver et la souhaite : "Mon
cher, j'ai pensé que jamais tu n'oserais. J'ai failli désespérer
de toi." Un peu plus loin : "Viens,
viens avec moi, ne me laisse pas partir seule…" Bref,
un bel exemple de relation toxique, dont on parle tant aujourd'hui !
J'ai été un peu frustré, car j'aurais voulu en savoir
plus sur Moustafa. On sait que c'était un bel homme, qu'il était
brillant, mais on a tout de même un peu de mal à croire qu'elles
tombent toutes si facilement en pâmoison, enfin toutes sauf Jean
bien sûr.
J'ai trouvé intéressant le rapport entre le narrateur parti
faire des études et son meilleur ami Mahjoub qui s'est arrêté
à l'instruction nécessaire à ses travaux agricoles
et à son commerce. Si le premier est devenu un haut fonctionnaire
frustré, ayant l'impression de ne pas avoir prise sur le cours
des choses et d'être inutile, le second semble frustré de
ne pas avoir eu le destin auquel il aurait peut-être lui aussi pu
prétendre : "Compare
un peu nos deux chemins. Tu es devenu haut fonctionnaire tandis que je
suis resté paysan dans un pays perdu.
Mais c'est toi qui as réussi, parce que tu agis sur la vie réelle
du pays. Nous autres, fonctionnaires, ne changeons rien à rien,
tandis que les gens comme toi sont les héritiers légitimes
du pouvoir. Vous êtes le centre nerveux de la vie, le sel de la
terre."
Je trouve que cet échange a encore aujourd'hui une résonance
quant au "bon" niveau d'éducation, à celui qui
apporte réellement une richesse supplémentaire à
un pays. Intéressantes aussi les réflexions du narrateur
sur le pouvoir politique corrompu et sourd aux revendications et intérêts
légitimes du peuple.
Enfin, j'ai beaucoup aimé le personne de Bint Mahjoub, la vieille
du village qui boit, fume, discute d'égal à égal
avec les hommes et parle de sexe de manière aussi crue, si ce n'est
plus, qu'eux ! Elle est vraiment truculente. De manière générale,
quelqu'un a dit que les personnages secondaires n'étaient pas très
intéressants. Je ne suis pas d'accord, je trouve au contraire qu'ils
apportent tous quelque chose : que ce soit Wad Rayyes, le grand-père
du narrateur, son meilleur ami, Bint Mahjoub ou bien encore les époux
Robinson.
Je rejoins encore Jacqueline sur le fait qu'il faudrait relire ce livre,
car il mérite une analyse vraiment détaillée. Je
ne sais pas si je le ferais, mais quoi qu'il en soit j'ai vraiment eu
plaisir à le lire.
Je l'ouvre aux ¾ et non pas en entier car j'aurais parfois voulu
que l'auteur m'en donne un peu plus. Mais c'est aussi ce qui fait le charme
et l'intérêt du livre, la part de mystère qu'il recèle.
Claire entre ![]() et
et![]()
J'ai beaucoup apprécié le livre que j'ai trouvé,
moi aussi, très riche, et en
un petit volume. Contrairement à plusieurs d'entre vous, c'est
le romanesque, moi, qui m'a plu :
la narration m'a impressionnée par son art de la tension, du suspense,
la façon de distiller les informations, les flashbacks habiles
; et le rapport ex-colons/ex-colonisés, très nourri, faisait
partie de cette tension. La langue m'a souvent étonnée,
avec - tant pis si c'est un cliché - comme une musique des mots
et des tournures, comme une autre langue ; et les propos sur les femmes
allaient de surprise en surprise.
Je me suis interrogée parfois : le récit oral dans le récit
super écrit (mais bon, Moustafa est génial), pourquoi il
se confie au narrateur, pourquoi le récit s'arrête tout à
coup, quel est le secret du grand-père du narrateur ; et ces Anglaises
qui tombent dingues... ; et la scène de violence avec la veuve (j'ai
essayé de visualiser comment elle avait pu avoir un bout de sein
arraché et avait pu lui donner des coups de couteau dans le sexe...)
et le journal de Moustafa vide (commençant pourtant par cette phrase
: "À ceux qui
ne voient d'un regard net, à ceux qui parlent d'une voix catégorique,
à ceux pour qui les choses sont blanches ou noires, orientales
ou occidentales")... La fin m'a paru bizarre et la première
phrase avec l'adresse "C'est
à la suite d'une longue absence, messieurs" m'a
fait attendre un retournement, indiquant qui étaient ces messieurs,
qui n'a pas eu lieu.
Deux scènes m'ont frappée : le dialogue étonnant
entre ces musulmans sur les relations sexuelles, avec notamment la femme
Bint Mahjoub, et la scène dans le désert que j'ai trouvée
grandiose.
J'ai trouvé très fortes l'utilisation par un Africain des
clichés sur les Africains pour séduire, ainsi que la critique
virulente de la corruption des élites africaines.
J'ai
ensuite écouté l'émission de
France Culture consacrée au roman qui
m'a vraiment étonnée sur deux aspects :
- on entend l'auteur dans une interview de 1997 dire en anglais : "En
fait, j'avais l'idée d'écrire un thriller. Au départ
mon intention c'était d'écrire une simple histoire de meurtre.
Mais c'est devenu une sorte de conflit entre différents mondes,
différentes cultures, différentes civilisations. Je pense
que l'histoire a pris le dessus durant l'écriture et j'ai dû
m'adapter. De nouveaux personnages sont apparus, de nouvelles dimensions,
de nouveaux angles. Donc c'était plutôt sérieux pour
moi." J'ai du coup compris pourquoi la narration était
tellement habile en termes de suspense.
- La spécialiste évoque le réalisme magique, très
présente dans la littérature soudanaise et dans ce roman,
et là je suis tombée de haut, car j'ai tout pris pour du
réalisme. J'ai donc reconsidéré la scène sexuelle
de tuerie..., la chambre cachée, et tout ce qui était "trop".
Je
me suis intéressée à la traduction, grâce à
l'article trouvé qui montre que la première traduction était
choquante par les passages enlevés exprès : l'article est
centré sur la disparition des critiques de l’orientalisme.
J'ai regardé pour ma part la traduction d'excisée
qu'on trouve dans notre livre p. 12 : Bint Mahjoub
dit en riant : "Nous
avions peur que tu ramènes une chrétienne, non excisée".
Dans la première traduction, pas d'excision : "Nous
avions peur que tu ramènes une chrétienne"
(voir ici mes découvertes).
Pour être dans l'ambiance, j'ai vu deux expositions qui m'ont vraiment
intéressée : "Présences arabes : art moderne
et décolonisation. Paris 1908-1988" au Musée
d'art moderne (“Comment
faire un art moderne et arabe ? Un vrai projet esthétique se met
en place au cours du 20e siècle : pensé à la fois
en rupture avec l’art académique, en écho avec les
avant-gardes occidentales, dans le cadre d’une identité nationale
propre, sans retour pour autant à un art islamique.”)
et une exposition sur Etienne Dinet (1861-1929) à l'Institut
du monde arabe (un peintre français qui, passionné,
n'a peint que l'Algérie, s'y est installé, s'est converti,
a fait le pèlerinage à la Mecque... : étonnant !).
Christelle![]()
C'est pour moi une très belle découverte d'un auteur et
d'un pays.
L'ambiance est très prenante, le Nil contribue à l'atmosphère.
J'ai aimé les contrastes entre la vie rurale et la ville, les éduqués
et les autres, la fascination entre les deux mondes, Angleterre et Soudan.
C'est à mon avis cette fascination, liée en partie au peu
de connaissance mutuelle de leurs cultures, qui pourrait rendre crédible
le magnétisme morbide et répété exercé
par Moustafa sur les femmes qu'il rencontre à Londres (car l'intrigue
paraît toutefois très étrange) !
La construction est très habile, fluide et pourtant je n'ai pas
lu le livre très rapidement. Je ne me suis pas sentie perdue, mais
vraiment portée par la très belle écriture.
La manière de construire le récit sous la forme d'une enquête
m'a beaucoup plu, cela permet l'assemblage progressif d'informations,
mais aussi de laisser des zones d'ombre, des énigmes... À
mon avis, cela suffit pour suivre les personnages, appréhender
leur complexité, je n'aurais pas aimé en savoir plus, je
préfère pouvoir émettre des hypothèses sur
ce que devient le narrateur, Moustafa, ce qui s'est passé à
Londres...
J'aurais d'ailleurs préféré avoir plus de mystère
à propos de la mort de Jean et de la tuerie finale, l'avalanche
de détails crus m'a semblé inutile et excessive (à
cause de cette réserve, je n'ouvre pas le livre en grand).
Enfin, je ne suis pas originale, car les deux scènes qui m'ont
le plus marquée sont la scène de la route dans le désert,
très poétique et où l'on sent la grande sensibilité
du narrateur, et le dialogue entre les "vieux" du village à
propos des relations hommes-femmes, bien plus terre à terre !
Richard![]()
Je ne suis pas allé à Oxford comme Moustafa, mais à
une autre fac anglaise.
Le début de la lecture a été assez difficile, assez
hachuré.
Une fois dedans, je me suis laissé prendre par l'action et la description
de cette société et de ce pays qui est tellement différent
du nôtre.
(Mais il y a parfois des phrases qui n'ont rien à voir avec ce
qui vient d'être dit et va suivre, par exemple p. 60, entre le dialogue
: "En ce début
d'hiver, le ciel de Khartoum était constellé d'étoiles.")
La lecture, en tant que document, fournit de magnifiques descriptions
et évoque les problèmes de la décolonisation :
je n'ai jamais lu de livre traitant de ce sujet avec autant d'intérêt.
Maintenant se pose la question de l'interprétation : et si on lisait
ce livre comme une allégorie ? Et si les deux hommes n'étaient
qu'une seule personne ou un symbole ? On ne sait pas comment le narrateur
finit sa vie, mais il est possible qu'il se noie comme Moustafa. Si ce
n'est pas le cas, et qu'il soit sauvé (par ceux qui entendent ses
appels au secours), alors nous avons là tout le problématique
de l'avenir des deux mondes, traditionnels et colonisés. À
méditer …
J'ouvre aux ¾, ce qui pour moi est exceptionnel.
(Les
deux avis suivants sont arrivés après la séance,
sans avoir eu connaissance de nos avis.)
Françoise
![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
J'ai complètement zappé notre soirée, persuadée
que c'était la semaine prochaine !
Et pourtant j'ai lu ce livre exotique, et même écouté
le podcast
signalé.
J'ai trouvé ce livre intéressant et un peu brouillon, pas
surprise d'apprendre - de sa bouche - que son projet initial était
d'écrire un polar.
Je pense que l'auteur a mis beaucoup de lui dans le narrateur, évidemment,
mais aussi dans le personnage terrible de Moustafa Saïd sur lequel
il est impossible de se projeter. Comment a-t-il fait pour se faire aimer
de toutes ces femmes et surtout la dernière apparemment ?
Une femme forte et courageuse. L'auteur met dans ce récit tout
ce qu'il a lui-même vécu, tiraillé entre tradition
et modernité, dont cette femme est la victime expiatoire.
Je trouve que c'est un livre courageux pour l'époque à laquelle
il a été écrit, mais même encore maintenant,
et l'écriture - dure, crue - est au diapason.
Je l'ouvre aux ¾.
(C'est
Etienne qui a proposé le livre et il a osé n'être
pas présent à la séance...)
Etienne![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Mon avis sera assez bref : j'ai été globalement déçu
par le livre. Je suis complètement passé à côté
et n'ai pas vraiment réussi à saisir le fil rouge et les
enjeux (la colonisation ? La domination ? Le transfuge de classe ? Tout
m'a semblé effleuré). Alors que les première pages
m'ont semblé intéressantes, j'ai eu l'impression au fur
et à mesure de l'avancée que tout perdait en lisibilité
(volontairement ?). Pire, l'histoire de Mustafa Saïd a fini par
m'ennuyer, voire m'agacer (mention spéciale aux scènes érotico-sadiques
des dernières pages que j'ai trouvé ridicules). Une impression
globale d'éparpillement et de verbiage essentialisant a fini par
l'emporter.
Je suis un peu navré d'avoir suggéré ce livre, je
ne m'attendais pas du tout à ça, c'est une mauvaise pioche.
Je garde ¼ ouvert les quelques pages de discussion savoureuses
entre villageois…
(Justement, en fin de séance, nous avons conclu : de cet auteur qu'aucun.e d'entre nous ne connaissait..., eh bien son livre, dont aucun.e d'entre n'avait entendu parler, c'était bien "un-livre-pour-le-groupe" ! Une belle découverte, qu'on ait eu ou non des réserves, découverte que sans le groupe nous n'aurions pas faite...)
|
Les
8 cotes d'amour du groupe breton Entre
|
Brigitte![]()
Je dirais d'emblée que je n'arrive pas rapidement à saisir
le sujet du roman écrit par Tayeb Salih, écrivain saoudien.
Je cherche à situer l'écriture de ce livre dans l'histoire
du Soudan. Ce roman est écrit dix ans après l'indépendance
du Soudan qui a été colonisé en 1899 par les Britanniques
alliés des Égyptiens jusqu'en 1924. Année où
les Britanniques administrent alors seuls le Soudan : ils avaient des
vues sur le Nil et sur le canal de Suez pour des raisons économiques.
Je me perds à la fois dans la reconstitution fragmentée
de la vie de Mustafa Saïd, personnage tragique, tourmenté,
déchiré au plus profond de lui par son histoire douloureuse
de colonisé et je me perds dans la vie du narrateur.
J'ai lu que le livre a été interdit au Soudan en 1989, année
d'un coup d'État militaire soutenu par le Front national islamique.
Le Soudan mettra trente ans à retrouver un président démocratiquement
élu.
Sachant qu'aujourd'hui, ce livre est reconnu comme étant un des
grands romans de la littérature arabe, je cherchais à comprendre…
il y a certes de la poésie lorsqu'il décrit son pays.
Je dois dire que certains passages crus me dérangent. Ma lecture
est poussive. Je résiste. Je l'ouvre à ¼ jusqu'à
ce que vers la page 100 j'écoute le podcast de France Culture.
J'y reviendrai.
Deux mondes coexistent et la violence est omniprésente. La violence
n'est pas une fatalité Je retrouve d'un côté le Soudan,
pays colonisé de l'Afrique de l'Est, pays conservateur majoritairement
de confession musulmane (je note beaucoup d'atteintes à la liberté
des femmes) et de l'autre l'Angleterre, pays colonisateur où les
deux personnages principaux, tous deux surdoués, ont étudié.
Ces personnages je ne les trouve ni sympathiques, ni attachants. Le narrateur
cherche à comprendre le secret de la disparition de Moustafa Saïd :
noyade ou plus vraisemblable suicide. Ou je pense, avant de lire les deux
derniers chapitres, qu'il a pu se faire passer pour mort et vit une troisième
vie ! Aucune envie de croiser son chemin.
Qui dirais-je de Moustafa ? Un enfant orphelin de père recueilli
par un couple d'anglais (image du côlon paternaliste) qui repère
ses capacités intellectuelles et l'envoie étudier à
Londres après son lycée. Brillant, il devient professeur
d'université reconnue appréciée ses pairs, il s'intéresse
à l'économie britannique qu'il critique. À Londres,
il séduit quatre femmes blanches dont l'histoire amoureuse est
empreinte de violence, surtout avec Jean. Ces relations se terminent dramatiquement
: trois suicides et le meurtre de sa dernière femme. Même
après sa mort dans son village soudanais, son épouse se
suicide après une scène de violence inouïe dans un
contexte de remariage arrangé. Que recherchent ces femmes auprès
de Moustafa ? Pour les Blanches, l'exotisme du colonisé noir :
un maître, un seigneur pour lequel elles agissent en esclave ?
Est-ce pour Moustafa une revanche de "l'intrus colonisé"
? Est-ce une réponse à la violence par la violence ?
Certaines relations sont malsaines, notamment Jean sadomasochiste. Le
retour de Moustafa au Soudan dans son village d'origine est-il en lien
uniquement au désir de revoir les siens après la prison ?
Est-ce une démarche intellectuelle bien plus profonde ? A
priori, il avait prémédité sa fin et inscrit ses
volontés qui protègent notamment ses deux garçons.
Étrangement les chemins de Moustafa et du narrateur se croisent.
Leurs parcours se mêlent. Le narrateur après la mort de Moustafa
poursuit son chemin, mais ne peut oublier cet homme. Il essaie dans une
grande douleur de comprendre ce qui le lie à Moustafa, mais aussi
de rompre avec la violence. Il retrouve le Nil et décide de vivre.
Tout au long du livre, les différences culturelles, l'héritage
de l'Histoire coloniale et de ses violences, les connaissances, l'éducation
scolaire et le savoir, malmènent la rencontre des hommes et des
femmes. Que recherchent les uns et les autres? J'ai le sentiment que cette
rencontre des deux mondes soudanais et britannique est présentée
comme inévitablement destructrice et ça me dérange.
Comment arriver encore aujourd'hui à reconstruire après
les stigmates de la colonisation ?
Je reviens sur le podcast de France Culture, Sans
oser le demander. Géraldine Mosna-Savoye, journaliste qui
a fait entre autres des études de philosophie, me permet de mieux
comprendre que l'auteur, au-delà des meurtres ou assassinats, parle
de "réalisme magique" avec une critique postcoloniale.
Je retiens qu'il faudrait travailler le symbolisme. Par exemple, elle
parle de l'importance des éléments comme l'eau du Nil autour
duquel sont installés les villageois, le fleuve est "donneur
de vie" mais divise, tue ou rassemble… c'est vrai encore aujourd'hui.
Les conflits violents perdurent au Soudan. Elle développe en quoi
l'ouvrage est la vive critique de la colonisation et de la violence.
Éclairée par ce podcast, je reprends ma
lecture et j'ouvre pour finir le livre à ½ car le roman
fermé je ne sais toujours pas ce que j'en retiens réellement,
sinon des questions… pour autant je ne ferai pas une seconde lecture.
Cindy entre ![]() et
et![]()
À ma première lecture, Tayeb Salih ne m'a pas emportée
dans son histoire ni dans cette littérature "africaine"
du Nord Soudan, alors que d'autres auteurs africains (lus depuis mon enfance
passée au Gabon) m'ont toujours émerveillée, fascinée
avec des expériences littéraires beaucoup plus intenses.
Je citerai Amadou
Hampâté Bâ, Léopold
Sedar Senghor ou plus encore Chinua
Achebe. Tous également romanciers, poètes…
Je m'attendais davantage à une histoire littéraire plus
ancrée dans le territoire et la culture de tradition orale.
Alors qu'ici, on en sort avec le principal personnage, Saïd, qui
raconte au narrateur, son histoire dramatique lourde de désillusions,
face à ses expériences, ses relations amoureuses occidentales
dans un régime politique colonial britannique.
Cette histoire dans l'histoire du narrateur nous éloigne du pays,
du village avec ses traditions et cultures si attachantes décrites
lors de passages savoureux, surtout dans les scènes de famille.
Mais dommage, peu de jolis tableau de mœurs africaines malgré
le talent de l'auteur à utiliser cette langue savoureuse et limpide
qui fait toutes les richesses, les couleurs et la vie du grand récit
oral africain comme "me
laissait heureux, au bruit du vent. Et par Dieu si je connais dans ce
pays, sa forme de joyeux murmure"
Le grand intérêt du livre ? Me donner l'occasion de rechercher
des documents sur l'histoire du Soudan (pas assez connue), de son époque
coloniale britannique et même aujourd'hui, avec un conflit, une
guerre terrible touchant tout un peuple en grande souffrance :
- "époque des
premières écoles et les gens s'en méfiaient. Les
agents gouvernementaux parcouraient le pays recrutant des écoliers"
(p. 27)
- "quand
tu seras grand si tu réussis à l'école tu seras fonctionnaire
du gouvernement et tu porteras un chapeau" (p. 28)
- "J'ai connu les champs
au temps des norias (...)
la
grande sécheresse (...)
puis les pompes hydrauliques furent installées, des coopératives
s'organisèrent (...)
et la terre redevint fertile"
(p. 53)
J'ai poursuivi la lecture sans être
"séduite" par la personnalité mystérieuse
de Mustapha Saïd, personnage clé du roman alors qu'étranger
au village !
Roman de dialogues, dialogues des deux personnages : le narrateur enquêtant
sur le passé de Saïd et ses vies complexes, recherchant sa
vraie identité et l'on comprend aussi les décalages entre
l'Europe, l'Occident et ce pays d'Afrique. Dialogues également
avec le grand-père et le narrateur : "j'arrivai
à la maison de mon grand-père, l'entendis réciter
versets du Coran (...) enfant c'était la dernière voix que
j'entendais avant de m'endormir" (p. 54).
Le grand-père qui tient
ici un rôle protecteur, de régulateur, d'apaisement.
Avec aussi une volonté de la part du narrateur de surprendre, de
ne rien cacher, sans retenue : "tout
cela m'excita au point que je ne pus poursuivre ma lecture. Je levai vers
lui un regard impatient. Il (…) commença. "
(p. 25)
Je n'ai pas été captée par toute cette histoire,
trop longue à mon avis, même si empreinte de récits
théâtraux et dramatiques, dont le narrateur reste sensible
tout en ayant "des idées noires" : "Soudain,
je me sentis revivre (...), je recouvrai ma sérénité,
et les idées noires venues du récit de Moustafa se dissipèrent."
Je retiens surtout les premières pages : "L'absence,
la nostalgie et les songes, tels que ce fut merveilleux de me trouver
réellement parmi eux"
(p. 29)
Je pense que ce qui me fait revenir à l'auteur, c'est que vivre
parmi la beauté de la nature, ici celle du Soudan, a rendu le narrateur
plus enclin à l'utopie, à ce qu'il soit plus sensible que
les autres. Il en a eu l'expérience et ça se lit : "À
travers la fenêtre, j'aperçus dans la cour notre vieux palmier
au tronc robuste (…) et ses palmes nonchalantes dont le bouquet vert
débordait la cime" (p. 10)
On peut imaginer que Tayeb Salih a vécu
son enfance dans cette imprégnation, pour devenir plus tard un
grand écrivain, poète, au destin sensible, humain (comme
le narrateur) : "nous
sommes tels que nous sommes, des gens ordinaires" (p. 55).
Ou encore : "Ainsi
ne suis-je pas plume au vent, mais créature, pareille à
ce palmier, de haut lignage et de sûre destinée."
(p. 10)
C'est avec cette force et sagesse en lui qu'il respectera la mémoire
et l'histoire de Moustafa en ne "brûlant" rien de sa vie
cachée : "Tout
le long de ma vie, je n'avais jamais choisi, ni décidé.
Mais je décide désormais de choisir la vie (…) j'ai
aussi des devoirs que je dois accomplir" (p. 171)
Il y a juste vers la fin du livre une prose magnifique et mystérieuse,
imprégnée du mysticisme, de croyances, et de "l'obligation
d'inventer pour survivre" qui offre une fin de tous les
possibles. La noyade dans le Nil est-elle réelle ?
Je retiendrai aussi une certaine modernité de la vision de l'auteur
soudanais, dans un contexte post-colonial, sa réflexion sur l'orgueil,
la perte d'identité, les statuts et la vie des femmes entre Afrique
et Occident.
Un roman basé sur une enquête qui m'a permis de rester jusqu'à
la fin, mais sans un grand plaisir de lecture.
J'ai cherché sans vraiment les trouver (comme dans la poésie
de Léopold Sédar Senghor) du symbolisme, des chants, des
ambiances, dont les mots et les rythmes, les bâtons de palabres
se lient à la pensée et au corps.
Marie-Odile![]()
Étrangeté et mystère du personnage
Moustafa Saïd.
Un parcours hors du commun, du Soudan à Londres, puis de Londres
au Soudan.
Un rapport aux femmes plutôt choquant.
Une mort/disparition inexpliquée.
Le mystère, le secret symbolisé par la chambre rouge
Le narrateur, sorte de double de Saïd.
Regard complexe et multiple sur la colonisation.
Les liens entre l'Afrique et l'Occident.
Mépris envers le colonisé. Saïd = "le
meilleur exemple de l'échec de notre mission civilisatrice en Afrique".
Critique sévère du colonialisme "Les
Anglais apprirent aux gens à nous haïr, nous les enfants du
pays, et à les aimer eux, les colonisateurs, les intrus."
Opposition de celui qui est passé par l'Occident (et son baratin
appris dans les écoles) à celui qui est resté au
pays.
Une succession de pages aux tonalités
différentes.
Des événements londoniens plutôt glauques.
Des moments de procès déconcertants.
Des événements tragiques concernant Hasna.
Des pages pittoresques correspondant à une vision plutôt
habituelle de l'Afrique parfois légères, parfois poétiques.
Par exemple : les différents rires p. 74, l'habitat, les portraits
(grand-père et Bint Mahjoub)/
Les échanges sur la polygamie, la domination de l'homme, le rapport
à la femme blanche....
Tout ça forme contraste, car il y a de l'attendu et de l'inattendu dans ce roman qui entraîne loin et porte à réfléchir.
J'ouvre à moitié ce texte qui me laisse perplexe, même
après la séance.
Soaz![]()
Livre qui me bouscule, questionne, dérange.
Il nous plonge dans la vie d'un village soudanais, à l'atmosphère
parfois étouffante, mais aussi poétique (de magnifiques
descriptions de paysage), avec les détails de la vie quotidienne
et l'humour des vieilles femmes (discussion sur le sexe en toute liberté).
Difficile de rester indifférente au comportement des hommes envers
les femmes, notamment aux agissements de Saïd, manipulateur par le
sexe et son pouvoir de domination.
Ce livre nous permet de nous pencher sur les raisons, l'impact, le meilleur
et le pire de la colonisation, le devenir des enfants envoyés en
Europe...
On y retrouve l'arrivisme, la luxure, la faiblesse, la haine, la soumission
des femmes, une certaine liberté sexuelle, les mariages forcés,
la place prépondérante de dieu, le pouvoir de la passion
jusqu'à la folie...
Présent et passé se mêlent, narrateur et Saïd.
Est-ce que Saïd est la main de la vengeance contre les colonisateurs
?
Ce livre nous tient en haleine, jusqu'au bout, jusqu'à la chambre
oblongue qui nous révélera tous les mystères de cette
vie si particulière. Il nous donne l'envie d'explorer la civilisation
soudanaise et de s'informer sur la période de colonisation de cette
contrée.
Chantal![]()
Première lecture : je n'arrivais pas à voir clairement l'histoire.
Je mélangeais les noms, les époques, je ne lisais que par
bribes (étant en famille), ce qui ne facilitait pas la tâche.
Donc relecture, et là, je me suis régalée.
Par les thèmes abordés bien sûr :
- l'exil des jeunes pour suivre des études, donc l'arrachement
au sol natal
- le choc de la rencontre avec l'Europe et l'impossible réelle
intégration
- les traditions - ancestrales - au Soudan de cette époque, et
la place des femmes.
Je trouve l'écriture de ce texte très forte, puissante,
brutale ou poétique, mais toujours efficace.
La construction du livre rend sans doute la lecture un peu ardue : allers-retours
d'un personnage à l'autre, d'une époque à l'autre...,
mais elle donne un rythme, une musique au texte, brutal et violent, puis
doux et poétique ; les séquences se succèdent
comme des vagues, et je me suis laissé emporter avec plaisir.
J'avoue que Moustafa Siad m'a émue, cet enfant sans émotion
(sans signes d'amour maternel ?), son exil à cause de son
intelligence exceptionnelle, sa revanche de Noir sur les "cuisses
blanches écartées"... je l'ai re-fabriqué
en lui trouvant toutes les excuses à ses "mensonges"...,
comme Mme Robinson !
Je pourrais continuer d'évoquer tous les passages qui m'ont touchée,
enchantée, mais je ne cite ici que celui qui m'a amusée.
La première épouse de Wad Rayyes qui, après le crime
commis par Hasna sur Rayyes : "Rayyes
a creusé sa tombe de sa propre main. Bint Mahmoud (Hasna), Dieu
ait son âme, nous a soulagées toutes, les anciennes et les
nouvelles. C'est bien fait, si ça ne vous plaît pas,
vous pouvez boire la mer. "
Enfin, ce texte nous incite à une réflexion très
actuelle, je trouve, sur le colonialisme, le nôtre, et ses conséquences
qui n'en finissent pas, même après des décennies,
de cogner encore et encore dans les consciences...
Voilà : je l'ouvre en grand.
Annie![]()
J'ai lu assez vite ce petit roman des années 60, dont l'histoire
se passe entre le Soudan et l'Angleterre, et qui m'a totalement dépaysée.
Je me suis laissé embarquer au Soudan, dans la vie quotidienne
des habitants, dans leurs discussions à l'ombre, dans la beauté
du Nil…
J'ai ressenti une impression de contrastes permanents, à commencer
par les sensations physiques : la chaleur écrasante de ce grand
pays, le désert, les terres arides, les animaux faméliques...
Et la fraîcheur du Nil dont on imagine les abords verdoyants et
vivants, ses crues régulières.
Il nous décrit aussi bien la vie simple et difficile des villageois
soudanais que les plaisirs dans les salons anglais, les coutumes et la
vie paisible des uns (où la religion tient une grande part) et
la vie agitée et plus facile des autres. Contraste également
entre ce très grand pays d'Afrique (pour rappel le Soudan du sud
est indépendant depuis 2011) et cette île qu'est l'Angleterre
(soit plus de 2000 fois plus grande au moment de la sortie du livre).
Et sous-jacent le contraste entre colonisés et colonisateurs.
Les personnages sont eux aussi surprenants : le narrateur (mémoires
de l'auteur ?) recueille l'histoire de Moustafa Saïd que l'on prend
au départ pour un ingénieux agronome qui a voué sa
jeunesse à apprendre pour apporter du progrès à son
pays. Mais très vite la révélation de son secret
donne une autre dimension au personnage et le récit de ses nombreuses
conquêtes en Angleterre avec les drames associés (suicides
et meurtre) accentue le fait que les apparences sont encore une fois trompeuses.
J'ai aimé cette perte de repères et me demander ce qu'il
y avait au bout de la page.
J'ai trouvé très drôles les conversations totalement
débridées des vieux. Je les imaginais tellement bien avec
leur canne, leur bouche édentée, leurs éclats de
rires, leur tranquillité et leurs propos salaces ! Là encore,
quel contraste entre l'apparent et le réel !
Et Moustafa qui meurt noyé (est-ce vrai ?) alors qu'il était
un très bon nageur.
J'ai aimé également la poésie des descriptions des
paysages, des sentiments et des corps. Une lecture agréable qui
m'a fait voyager, un roman original à mes yeux.
J'ouvre aux trois quarts.
Edith entre![]() et
et![]()
Je viens donc de terminer le livre. Besoin de relire l'introduction :
ce roman est le texte intégral, afin de rester fidèle à
l'enchainement et à la temporalité texte arabe, c'est-à-dire
son rythme et sa musicalité dit le traducteur Abdelwahab Meddeb.
Puis je vais relire la quatrième de couverture… Comme si j'avais
besoin d'encadrer ce roman des intentions et propos (le traducteur et
l'éditeur) pour pouvoir me situer dans ce texte.
J'ai lu rapidement sur deux jours : je ressens bien la force du texte,
ses différents niveaux de lectures et reste très impatiente
tout au long de la lecture de connaître le secret de Mustafa Saïd.
Je ne suis pas déçue !!!
Ouvert ½ pour le plaisir car d'une lecture difficile.
Ouvert ¾ pour la qualité littéraire.
C'est un texte à "l'ambiance" poétique, métaphorique,
avec des tournures de phrases quelquefois déstabilisantes, à
la construction des chapitres non chronologique, m'obligeant à
revenir à la fin du chapitre précèdent pour me "rétablir",
avant de comprendre que l'auteur développait un autre aspect de
sa vie, de ses rencontres, évoquant pour cela les personnes familières
de son village (le grand-père Bakri important) et ses voisins dont
la veuve Hasna (anglaise) de Mustafa, Wad Rayyes et Bint Mahjoub.
L'auteur, par la forme de son récit, se réserve de nous
amener aux différents époques de la vie de Mustafa Saïd
et de la sienne donc : ainsi les deux courriers laissés par Mustafa
et la clé de sa chambre mystérieuse - longtemps fermée
après sa mort -, chambre loin du village de l'auteur et qui révélera,
lors de son ouverture, l'homme lettré et l'amoral pervers (c'est
ainsi que je traduis le caractère de Mustafa Saïd), avec un
contenu extravagant (livres, documents, objets) censé donner une
réponse à l'auteur. Et à moi !
Si je classe mes propos : j'ai le récit magistral du meurtre orchestré
par les deux époux amants Jean Morris et Mustafa Saïd, la
violence du lien orchestre pour chacun la mort, meurtrier l'un par l'autre.
Le suicide probable de Mustafa noyé dans le Nil, mort souhaitée
par celui-ci et - farce de la vie ? - refusée autrefois par le
tribunal après les deux suicides suspects de Isabella Seymour Sheila
Greenwood dont il est soupçonné. Et puis la scène
du meurtre tout aussi surréaliste par Hasna (mère de ses
fils), la veuve convoitée par Wad Rayyes, vieillard concupiscent
et dominateur. Il y aurait du Georges Bataille là-dedans ? Violence
physiques, viol de Hasna, folie des rapports passionnels et destructeurs
de Jean Morris, chantage et provocation outranciers par elle, dominatrice
en miroir avec Mustafa, des situations destinées sinon décidées
à une mort certaine de l'un ou l'autre. Victime et bourreau sont
chacun consentants dans leurs mises en scène et dans l'exacerbation.
Mustafa semble avoir trouvé "son maître" auprès
de la femme Jean Morris. Les deux autres mortes ne le sont que par faiblesse,
la leur ! J'assiste, par la lecture, au récit d'un féminicide,
littérairement réussi !
La progression du récit est déconcertante : Mustafa est
vivant dans le dialogue, sorte de révélation à l'auteur
; puis Mustafa est raconté, évoqué, comme mort dans
les chapitres suivants, son destin dévoilé par touches rapides,
qui définissent le meurtrier pervers et amoral, cynique et froid
dont la seule personne compatissante fut Mrs Robinson sa nourrice.
C'est toujours un peu compliqué de me repérer. Le côté
malsain, énigmatique (il n'est pas originaire du village que borde
le Nil bien que soudanais) de Mustafa apparaît dès la description
qu'en fait l'auteur : son regard et son silence, les mouvements de son
visage.
On voit aussi le colonialisme, la puissance de la langue du colonisateur
(l'anglais) pour s'imposer, la puissance de la culture soudanaise et une
de ses formes, dérangeante pour une européenne : la place
accordée aux femmes. Il y a aussi la tranquille assurance accordée
à qui s'y conforme (l'auteur) malgré son choix d'une seule
épouse : "l'absence,
la nostalgie et les songes, tels que ce fut merveilleux de me trouver
réellement parmi eux (…) Telles était bien la chaleur
du clan" ; ce sont des propos affirmés dès
la première page du récit. Il est des leurs malgré
ses diplômes et la pratique de la langue anglaise.
C'est le genre de livre tellement dense et elliptique que je suis persuadée
d'avoir passé à côté de nombreux aspects. L'auteur,
Tayeb Salih, et sa culture européenne (cf. la 4e de couverture)
me fait penser qu'il y a beaucoup de lui dans le "récitant",
de même que dans le personnage (double inversé ?) de
Mustafa.
Khartoum, le Nil, la présence de la nature : sont évoqués
des repères géographiques et historiques à rechercher.
Plaisir de la découverte de la doc VAC pas encore lue au moment
de l'écriture. Je consulte après le point final.
Après discussion j'attribue ¾, la densité du texte
m'y oblige.
Marie-Thé![]()
Après quelques hésitations, j'ouvre ce livre aux ¾,
j'ai beaucoup aimé les cent premières pages (environ), mais
ensuite le côté morbide qui m'apparaissait m'a amenée
à lui ôter ¼ .
Dès la première phrase : "C'est
à la suite d'une longue absence, messieurs, que je revins dans
ma famille", j'ai pensé aux griots écoutés
en Afrique (de l'Ouest ) il y a bien longtemps, aux conteurs de Martinique
aussi.
Le retour du jeune homme au pays de ses racines, "créature
pareille à ce palmier", m'a tout de suite interpelée,
c'est intense ; quel contraste avec la fin où celui-ci "flotte"
sur le fleuve, entre deux rives (à la dérive ?), choisissant
la vie cependant. Je ne peux m'empêcher de penser ici à cette
phrase du Deuteronome : "J'ai
mis devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie."
Déracinement, transmission, j'en remarque l'importance, mais le
narrateur ne sera pas le passeur des paroles de Moustafa Saïd : "Je
l'avais laissé parler et j'étais sorti. Je ne l'avais pas
convié à achever son récit." Je vois
en M. Saïd un personnage brillant, d'un remarquable talent, mais
aussi un prédateur redoutable, destructeur, un être dépourvu
d'émotion, insensible, qu'aucun trouble ne semble atteindre :
"expier, non sa mort,
mais le mensonge de ma vie", dira lors de la disparition
d'une de ses victimes, celui dont la vie peut finalement apparaître
comme une farce.
Je note encore la condition de la femme africaine, la toute-puissance
de l'homme, les bienfaits et méfaits de la colonisation, etc. Il
y aurait tant et tant à dire ! Et puis, le cheminement vers la
tragédie avec Hasna et son vieillard de mari, avec Jean, l'épouse
à propos de qui Moustafa Saïd dira : "J'étais
chasseur, je devins proie." Ce cheminement m'a fait penser
au fleuve : "il est
ramené vers son irrévocable destinée (...) vers la
mer, vers le nord".
J'ai aimé le voyage vers Khartoum, les étendues désertiques,
les épineux... : "Pas
un nuage, promesse d'ombre, dans ce ciel de feu, couvercle de l'enfer."
"C'est la terre du désespoir
et de la poésie." J'ai pensé à ces
lointaines années que j'ai passées en Afrique de l'Est :
même paysages, même chaleur étouffante. Beaucoup de
passages du livre m'y ont d'ailleurs fait penser, ceux concernant les
femmes de là-bas en particulier.
À noter encore dans cet avis réducteur, le regard critique
de l'auteur, ou du narrateur, ou de Moustafa Saïd (les trois se superposent)
sur les ministres corrompus, redoutant les intellectuels, plus dangereux
à leurs yeux que le colonialisme... sur l'exploitation scandaleuse
du peuple, etc.
Je terminerai par quelques associations comme j'aime le faire. J'ai quelquefois
pensé à Frantz
Fanon, à M. M'Bougar Sarr pour son personnage erratique dans
La
plus secrète mémoire des hommes, même si celui-ci
ne ressemble pas à Moustafa Saïd, à Alain
Mabanckou, et bien sûr à Abdourhaman Wabiri pour Le
pays sans ombre, livre sur Djibouti qui vaut vraiment le détour,
que je me suis lassée de proposer.
Et tout à fait autre chose, j'ai même osé faire un
petit lien avec Mrs Robinson du film Le
Lauréat, pour une certaine ambiguïté que j'ai
ressentie.
Claire
À propos de ce recueil de nouvelles que tu proposes, Marie-Thé,
réponse a déjà été donnée :
il n'est guère possible de le programmer tant qu'il est épuisé...
• Quelques
repères biographiques
Les formes du nom de l'écrivain varient : Tayeb Salih, Tayeb Saleh,
Salah Tayeb, Salih Ak-Tayyib, Tayyib Muhammad Salih Ahmad al...
Il est né en 1929 dans un village du nord du Soudan, pays qui accède
à l'indépendance en 1956. État le plus étendu
d'Afrique, le Soudan compte, au moment de son indépendance, environ
un million d'habitants.
Tayeb Salih fait des études d'agronomie à l'université
de Khartoum, avant d'aller compléter sa formation en Grande-Bretagne
et de s'y installer.
Après avoir brièvement enseigné au Soudan, il devient
journaliste au service arabe de la BBC à Londres, puis au siège
de l'Unesco à Paris ; il est ensuite représentant de l'UNESCO
pour les États arabes du golfe Persique. Pendant plus de 10 ans,
il écrit une chronique hebdomadaire pour le journal arabe Al
Majalla, basé à Londres.
Il publiera quatre romans et des nouvelles.
"J'avais eu une enfance très heureuse. Le fait de vivre à l'étranger, de vivre l'isolement et la nostalgie m'ont poussé à écrire. À Londres, je réalisais la perte que je venais de subir. L'hiver était atroce, et je ne connaissais personne... J'ai écrit pour communiquer avec les miens." (Hebdomadaire égyptien Ahram Hebdo, 2005).
- Une interview de 1997 restitue le contexte d'alors
:
Que veut dire être écrivain sous un régime islamiste
comme celui de Khartoum ?
Il y a huit ans que je ne suis pas retourné au Soudan. Les quelques écrivains qui y sont restés subissent les effets du verrouillage islamiste : harcèlement moral, autocensure, etc. Il est donc impossible de penser et de créer librement dans un tel climat, les intellectuels et les artistes soudanais qui vivent en exil sont également pénalisés : leurs livres, disques, etc. ne parviennent pas aux lecteurs soudanais. Aujourd'hui, le régime de Khartoum cultive l'uniformisation. Le Soudan, qui est le produit d'un brassage ethnique et culturel, offrait, avant l'arrivée des islamistes, l'exemple d'un pays tolérant. Le régime actuel a tourné le dos à cette tradition, dont les savants et les mystiques ont été les leviers.
Vos romans font l'objet d'une censure déguisée. Pourquoi?
Les autorités soutiennent que mes écrits ne sont pas censurés. La vérité, c'est qu'ils font les frais d'une lutte de clans entre les "modérés" et les ultras du FNI, Front national islamique, que dirige l'éminence grise du régime, Hassan al-Tourabi. Mais dans l'ensemble, le régime considère mes romans comme des écrits vains, sexuellement et moralement incorrects. Aux yeux des autorités, la "bonne littérature" est celle qui ne fait place ni à la fable, ni à la fiction, ni au sexe. Or ces éléments ont fécondé l'islam et le patrimoine arabo-islamique.
Cette censure touche également des chansons dont les paroles sont jugées "licencieuses".
Sur le plan culturel, le régime de Khartoum fait preuve d'une médiocrité sans égale ; cette décision rappelle celle d'un ancien ministre de l'Information qui avait suggéré la destruction de statuettes anciennes, sous prétexte que l'islam interdit les idoles ! Interdire les chansons dites de la "valise", c'est jeter un voile de plus sur le peuple soudanais, le priver d'oxygène.
Votre participation à cette manifestation ne risque-t-elle pas d'être exploitée par le régime de Khartoum ?
J'ai répondu à l'invitation de l'Institut du monde arabe et non à celle du gouvernement soudanais. À l'étranger, je saisis toutes les occasions pour rencontrer mes compatriotes et dénoncer le régime en place. ("Loin de Khartoum. Rencontre avec Tayeb Salih, exilé à Londres et censuré au Soudan", Maati Kabbal, Libération, 3 avril 1997. L'institut du monde arabe a organisé en 1997 une exposition intitulée "Soudan : royaumes sur le Nil").
Il sera enterré en 2009 au Soudan, où la cérémonie funéraire a été suivie par un grand nombre de personnalités et d'écrivains arabes, ainsi que par le président soudanais de l'époque, Omar Al-Bashir, au demeurant peu recommandable...
Montrant sa renommée, le 12 juillet 2017, Google Doodle a commémoré le 88e anniversaire de Salih Tayeb :
• Les trois livres traduits en France
Saison de la migration vers le Nord est le deuxième
volet d’un polyptique précédé d’un recueil
de nouvelles, Les noces de Zeyn, publié en 1966, dix ans
après l'accession de son pays à l'indépendance, suivi
de deux récits, "Daw el-Beyt" et "Meryoud",
réunis sous le titre de Bandarchâh.
Tous ont pour décor le même village, Wad Hâmid, entre
Nil et désert, et habité par les mêmes personnages.
Mais temporalités et genres littéraires diffèrent.
- Les
noces de Zeyn et autres récits, trad. Anne Wade Minkowski,
Actes sud, 2013.
- Bandarchâh,
trad. Anne Wade Minkowski, Sindbad, 1995 ; rééd. Actes Sud,
2022.
- Le Migrateur, traduction partielle en français de Fady
Noun, préface de Jacques Berque, La Bibliothèque arabe,
coll. "Littératures", Sindbad, 1972 ; rééd.
avec une traduction intégrale de Abdelwahab Meddeb et Fady Noun
et un nouveau
titre, Sindbad, La Bibliothèque arabe, coll. "Littératures",
1983 ; rééd. Actes Sud, coll. "Babel", 1996
: Saison
de la migration vers le Nord.
• Le roman Saison de la migration vers le Nord : publication et traduction
Tayeb Salih publie d’abord son récit en plusieurs
épisodes dans le magazine libanais Hiwâr en 1966.
Rapidement remarqué par la maison d’édition arabophone
Dar Al-‘Awdah, le roman sort la même année sous le titre
Mawsim al-hijra ilâ ash-shamâl (Saison de la migration
vers le Nord). Le livre connaît un succès immédiat
et sera traduit dans de nombreuses langues.
Plus tard, il sera interdit au Soudan dans les années 1990, en
raison de son contenu en partie sexuel et malgré le fait qu'il
lui ait valu une renommée internationale.
L'académie
arabe de Damas l'a désigné en 2001 "roman arabe
le plus important du XXe siècle".
Il est traduit en anglais un an après sa publication en arabe,
par celui qui sera un grand traducteur de l'arabe, Denys Johnson-Davies
(Season of Migration to the North). Johnson-Davies, d'abord collègue
de Tayeb Salih à la BBC, entreprit ainsi les premières traductions
de ses textes.
Le roman est traduit en
français trois ans après sa publication, par Fady Noun en
1972, sous le titre Le migrateur.
Le livre est précédé d'une
préface de Jacques Berque (voir =>ici).
Jacques Berque (1910-1995) est un sociologue et anthropologue orientaliste
français, titulaire de la chaire d'histoire sociale de l'Islam
contemporain au Collège de France de 1956 à 1981, et membre
de l'Académie de langue arabe du Caire à partir de 1989.
Il est l'auteur de nombreuses traductions, dont celle du Coran.
Cette caution inspire confiance. Hélas, un
article récent met les pieds dans le plat... :
"La première version traduite en français, de Fady Noun, offre au lecteur français une vision complètement édulcorée de l’imaginaire oriental sur l’Occident, gommant presque systématiquement les critiques de l’orientalisme qui rythment le texte arabe. Mais la seconde version, d’Abdelwahab Meddeb, rétablit les passages coupés et permet de se rendre compte du rôle important jouée par la fiction arabe dans la déconstruction du savoir orientaliste" (Ridha Boulaâbi, "De Tayeb Salih à Abdelwahab Meddeb : Saison de la migration vers le Nord ou vers l’orientalisme ?", Recherches & Travaux, n° 95, 2019).
L'article mérite la lecture car il donne des exemples
édifiants, choquants même.
Pour ce qui est de la traduction des œuvres en anglais, Johnson-Davies se fixe des règles que peu de traducteurs de la littérature arabe semblent respecter. Le traducteur doit d’abord préserver l’intégralité du texte choisi, c’est-à-dire éviter les changements et les omissions pouvant affecter sa nature (voir l'hommage "Denys Johnson-Davies : figure de la traduction de la littérature arabe", Mustapha Ettobi, revue TTR : Traduction, Terminologie, Rédaction, vol. 19, n°1, 1er semestre 2006).
Le traducteur en français aurait gagné à l'imiter : Fady Noun, né à Beyrouth en 1946, a fait des études de sociologie à Paris. Il est journaliste depuis 1980 à L'Orient-Le Jour, le grand quotidien francophone du Liban, et auteur de recueils de poésie.
Lorsqu’en 1983, les éditions Sindbad décident de publier une nouvelle traduction du roman soudanais en la confiant à Abdelwahab Meddeb, écrivain et essayiste, celui-ci, sans faire table rase de la version de Fady Noun, décide d’être plus proche du texte source. Il justifie ce travail de remaniement dès l’ouverture du livre, de la manière suivante :
Sindbad a publié ce roman en 1972, sous le titre Le Migrateur. Cette première traduction, de Fady Noun, n’était pas intégrale. J’ai donc transmis l’ampleur et l’intégralité du texte original. Mon souci étant de rester fidèle à l’enchaînement et à la temporalité du texte arabe, c’est-à-dire à son rythme, sa musicalité. Le roman est rendu à son titre littéral : Saison de la migration vers le Nord. Le texte arabe utilisé pour ce travail a été publié à Tunis, en 1978, par Sud Éditions.
- "Tayeb Salih, écrivain soudanais", Robert Solé, Le Monde, 25 février 2009.
- "Adieu à Tayeb Saleh", Tirthankar Chanda, Jeune Afrique, 29 février 2009.
- "Saison de la migration vers le Nord de Tayeb Salih", Littérature classique africaine, Tirthankar Chanda, RFI, 26 avril, 2020, 4 min.
- "Saison de la migration vers le nord de Tayeb Salih : quel est l’un des plus grands romans du Soudan ?", Géraldine Mosna-Savoye, Sans oser le demander, France Culture, 29 juin 2023, 58 min.
- (Pour les mordus de Marguerite) "Le
thème de l’étranger chez Marguerite Duras et Tayeb
Salih : quelques aperçus", Mattias Aronsson, Presses universitaires
de Rennes, 2013.
- (Un autre article prise de tête) "De
l'exil géographique à l'exil identitaire ou l'impossible
reterritorialisation dans Saison de migration vers le Nord",
Mohamed-Racim Boughrara, Carnets, 2017.
- Un hommage à Salih Tayeb est organisé en 2013 à l'Institut du monde arabe, sous forme d'interventions successives de personnalités ou spécialistes (voir le programme), visibles =>ici, vidéo, 1h 41 ; il faut prendre le temps, en raison des salamalecs... ; mais l'ambiance vaut le détour.
- Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon, Seuil, 1952 ; rééd. Points Essais, 2015.
- L'essai qui fait autorité dans le domaine : L'Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident d'Edward W. Said, Seuil, 2005 ; rééd. Points Essais, 2015.
- Marcella Rubino, une des rares universitaires en France avec Zaïneb Ben Lagha à intervenir sur Tayeb Salih (France Culture, Institut du monde arabe), réalise, dans le cadre d'une mission de terrain en 2022, un état des lieux des espaces littéraires à Khartoum.
-
D'où venait notre idée d'un livre soudanais ?
D'Etienne qui nous a en avril dernier fait de la pub pour une ouverture
soudanaise que lui a inspirée un article du Monde
indiquant que "vue
de l’étranger, la littérature soudanaise arabophone
s’est longtemps résumée au nom de Tayeb Salih (1929-2009)
et à son chef-d’œuvre Saison
de la migration vers le nord"
(1966). L'article se centrait sur un auteur plus jeune et très
primé, Abdelaziz Baraka Sakin (né en 1963), auteur du Messie
du Darfour, Les
Jango et La
Princesse de Zanzibar (tous chez Zulma).
Nous
avions aussi
remarqué
que le livre que nous avons choisi notre livre figurait dans la Bibliothèque
idéale de Pivot.
- Leila Aboulela est un autre nom de la littérature
au Soudan. Rapide portrait : sa grand-mère a étudié
la médecine dans les années 1940 ; de mère égyptienne
professeure d'université et de père soudanais, Leila Aboulela
est née en Égypte et grandit à Khartoum. Elle fait
des études d'économie à l'Université de Khartoum,
puis en Angleterre comme Salih Tayeb, où elle obtient un doctorat
en statistique. Elle vit plusieurs années en Écosse, puis
au Qatar.
Son œuvre reflète en partie cette vie entre l'Europe et les
pays arabes : par exemple, le roman Le Musée décrit
les abîmes séparant deux étudiants, l'une soudanaise,
l'autre écossais. Le Minaret est consacré à
une femme soudanaise d'origine aristocratique contrainte à l'exil
en Grande-Bretagne à la suite d'un coup d’État.
Publications traduites en français :
- La Traductrice,
trad. de l'anglais Christian Surber & Nida, éd. Zoé,
2003.
- Le Musée,
trad. de l'anglais Christian Surber, éd. Zoé, 2004.
- Le
Minaret, trad. Aline Azoulay, Flammarion, 2006.
Le nouveau groupe parisien a lu ce livre pour le 6 septembre.
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
||||
| |
||||
|
à
la folie
grand ouvert |
beaucoup
¾ ouvert |
moyennement
à moitié |
un
peu
ouvert ¼ |
pas
du tout
fermé ! |
![]() Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens