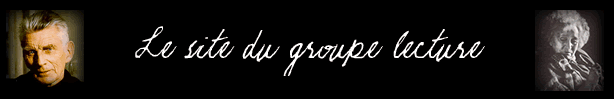
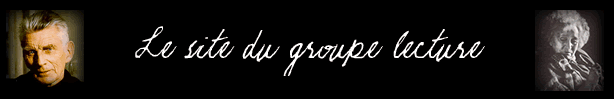 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Littérature africaine
|
Était également avec nous Kidi Bebey, écrivaine et journaliste, et auteure d'une série d'articles dans Le Monde sur la littérature africaine. Voici les livres à notre programme, dans l'ordre chronologique de leur publication, de 1979 à 2023 : deux francophones, un lusophone, un anglophone, de 4 pays différents. Moins de 1000 pages en plus de deux mois ! Certains d'entre nous en ont lu d'autres, en plus... |
|||
|
| ||||
|
DE
LA DOC - DES INFOS - DE LA DOC
=>ICI
|
|
•
Pourquoi
la littérature africaine ? |
|
31 LECTEURS
des différents groupes |