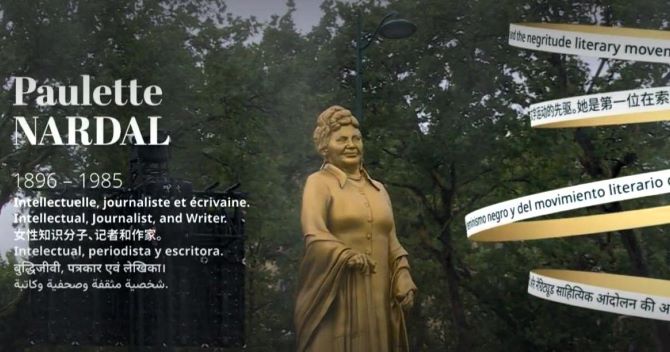Nous
avons lu pour le 15 décembre 2024 :
Les
sœurs Nardal : à l’avant-garde de la cause noire
de Léa MORMIN-CHAUVAC
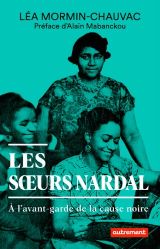
préface
Alain Mabanckou, éd. Autrement, 2024, 192 p.
| DES INFOS AUTOUR DU LIVRE • Des images • Léa Mormin-Chauvac : parcours, publications • Presse autour de son livre • D'autres articles à propos des sœurs Nardal • Nommer, honorer |
|
Découvrez
›NOS
RÉACTIONS sur ce livre
|
| Des images | |
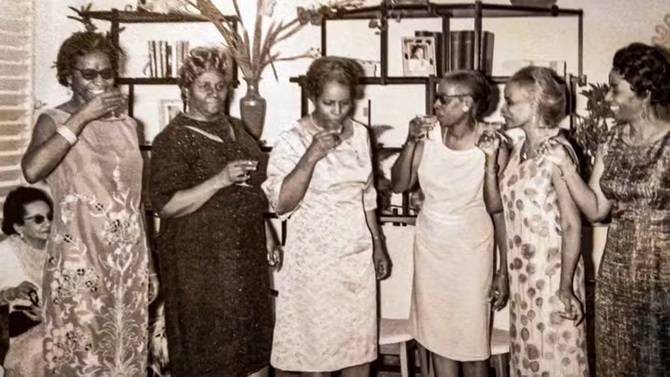 |
|
|
Les sept sœurs Nardal - FONDS
LOUIS
THOMAS ACHILLE
|
|
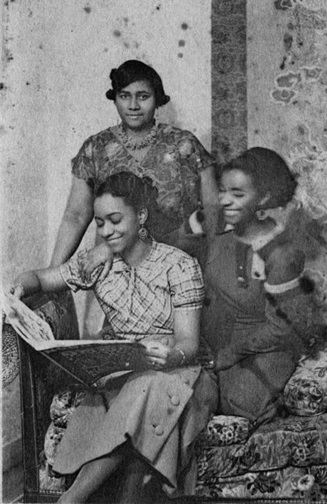 |
 |
|
Paulette Nardal (debout), Lucy
(à gauche) et Jane (à droite), 19 octobre 1935
dans le salon au 7 Rue Hébert à Clamart ARCHIVES DE MARTINIQUE |
Paulette Nardal (photo non datée)
FONDS LOUIS THOMAS ACHILLE Ce cousin de Paulette a eu un parcours extraordinaire : voir >le site qu’animent ses enfants |
|
La chorale fondée par Paulette
Nardal La joie de chanter existe toujours, voir >ici
|
|
|
Léa Mormin-Chauvac, dont
nous lisons le livre, avoue "avoir fondu en larmes"
en découvrant la statue de Paulette Nardal lors de la cérémonie
d'ouverture des JO. "J'avais la chair de poule rien qu'en
entendant la voix de Daphné Bürki présentant
Paulette Nardal. Le monde entier la voyait", se
souvient Léa Mormin-Chauvac qui ce jour-là s'est
dit qu'elle avait, à sa mesure, participé à
cette reconnaissance : "Mon téléphone n'a
pas arrêté de sonner dès qu'elle est apparue".
|
|
 |
Née
en 1993 à Aix-en-Provence. Son père martiniquais et
sa mère se rencontrent sur le campus à Bordeaux, "deuxième
capitale universitaire des Antilles" martiniquaise. Elle fait
des études à Toulouse en sciences sociales, puis Sciences
Po à Paris et devient journaliste, comme ses parents l'avaient
été dans la PQR. Pour elle, Nardal n'était alors
qu'un arrêt de bus en Martinique. Pour Libération, elle couvre mouvements féministes et décoloniaux ; c'est alors qu'elle découvre Fiertés de femme noire : entretiens/mémoires de Paulette Nardal, de Philippe Grollemund (L’Harmattan, 2019) d'où elle tire un article après avoir rencontré l'auteur : membre de la chorale fondée et dirigée par Paulette Nardal dont il découvre la personnalité, il enregistre de 1974 à 1976 des entretiens avec elle. Correspondant de presse du Monde, le jeune homme passe parfois ses appels au journal depuis le domicile de Paulette Nardal, proche de la préfecture où il exerce son service national en tant que VAT (volontariat territorial en administration). En 2016, il retrouve ces cassettes, assorties de retranscriptions manuscrites minutieuses, qu’il pensait avoir égarées au gré des déménagements. Il publie ces entretiens rassemblés sous forme de mémoire. |
- Ses publications sur les sœurs Nardal
- Une double page dans Libération
: "Paulette Nardal, théoricienne
oubliée de la négritude", 27 février
2019.
Outre le livre de
Philippe Grollemund cité ci-dessus d'entretiens/mémoires
de Paulette Nardal, des sources indiquées
explicitement dans l'article concernent des recherches américaines
qui font autorité ; les voici, accessibles intégralement
en ligne :
›
Negritude Women de Tracy Denean Sharpley-Whiting (University
of Minnesota, 2002) : trois des cinq chapitres sont consacrés
aux sœurs Nardal .
› In
Search of Seven Sisters : a Biography of the Nardal Sisters of Martinique
de Emily Musil Church (Callaloo, vol. 36,
n° 2, printemps 2013, Johns Hopkins University Press,
16 p.).
- Un documentaire : Les
oubliées de la négritude, France Télévisions,
2023, 52 min, de Marie-Christine Gambart et Léa Mornin-Chauvac.
Un extrait =>ici.
Présentation du film par Mouna El Mokhtari, Le
Monde, 23 mars 2023.
- Les
sœurs Nardal : à l’avant-garde de la cause noire,
éd. Autrement, 2024. Voir ci-dessous divers échos dans la
presse sur le livre (radio, télé, périodiques).
- "Les sœurs Nardal
penseuses de la négritude", scénario de la BD,
dessins Raphaëlle Macaron, La Déferlante,
n° 2, 2021.
- Entretiens avec Léa Mormin-Chauvac
-
"Focus
sur les sœurs Nardal, grandes oubliées de la négritude",
par Valérie Parlan, Ouest-France, 11 mars 2023 : à
propos de son documentaire.
- "Les
sœurs Nardal, les oubliées de la cause noire", par
Nicolas George, Le Journal international, TV5MONDE, 21 avril 2024,
5 min 33.
- "Léa
Mormin-Chauvac, les sœurs Nardal, les mères de la négritude",
par Jean-François Cadet, Vous m'en direz des nouvelles,
RFI, 23 avril 2024.
-"Dans
la compagnie des sœurs Nardal, les oubliées de la négritude",
par Tirthankar Chanda, Chemins d'écriture, RFI, 4 mai 2024,
4 min 19.
- Léa Mornin-Chauvac, par Cécile Baquet, #MaParole,
Outremer La 1ère, 30 septembre 2024, deux épisodes de 30
min : 1/2
et 2/2.
- Critiques radio ou presse écrite sur le livre
- "Les sœurs Nardal : à
l'avant-garde de la cause noire", Léa Mormin-Chauvac",
Nathalie Crom, Télérama, 13 avril 2024.
- "Les
sœurs Nardal, à l'avant-garde de la cause noire",
Anne-Cécile Mailfert, En toute subjectivité, France
Inter, 19 avril 2024, 3 min.
- "Connaissez-vous les sœurs
Nardal ?", Valérie Marin La Meslée, Le Point,
13 juin 2024.
- "Négritude : nom féminin",
Marylin Maeso, Lire - Magazine littéraire, 1er juillet
2024.
La plupart ont été publiés avant le livre de Léa Mormin-Chauvac que nous lisons et nombre d'entre eux figurent parmi les sources de son livre.
- La Revue du monde noir, fondée en 1931 par Paulette Nardal, Léo Sajous et René Maran, est une publication bilingue français-anglais annonçant la "négritude" : ses six numéros sont consultables dans >Gallica. Voir notamment l'article de Paulette Nardal "Eveil de la Conscience de Race", n° 6, 1932.
- Dans son article "Quand la Martinique devient sujet de roman" (La Presse, Montréal, 5 août 1989), Yves Dubé rend compte du roman de Rafaël Confiant Le nègre et l'amiral (Grasset, 1988) et dit : "Raphaël Confiant, dans son rappel historique de cette période, n'oublie pas son apport littéraire : la découverte de Césaire par Breton, la création de la Revue du Monde noir et la renommée du Salon de Paulette Nardal à Paris, l'édition d'Ainsi parla l'Oncle de J. Price-Mars qui deviendra un classique et l'effervescence de tout ce qui a donné naissance au mouvement de la négritude dans la francophonie d'alors. Ses renseignements à ce sujet sont précis, exacts et nous permettent de nous remémorer des moments émouvants qui ont marqué la vie littéraire et culturelle de cette époque."
- Paulette Nardal sera la secrétaire à l'ONU de Ralph Bunch, prix Nobel de la paix : voir l'article "Histoire des Noirs : la vision du monde de Ralph Bunche sur la race", Janet Sassi, Fordham Now (Université de New York), 10 février 2017.
- "Paulette
Nardal ou une négritude par la presse", Laure Demougin,
Journée d’études : le statut des périodiques
francophones dans le monde (1880-1980), Le Mans Université,
juin 2019 (étude universitaire : 20 pages).
- "Des femmes noires, illustres et
universelles" (dont les sœurs Nardal), Sonya Faure, Libération,
22 décembre 2020, à l'occasion de la sortie du livre Des
vies de combat : femmes, noires et libres, d'Audrey Célestine
(60 destins de femmes noires).
- "Paulette Nardal, pionnière
de la négritude", Béatrice Bouniol, La Croix,
12 février 2021 : récit réalisé à partir
d'entretiens avec l'historien Pascal Blanchard, auteur de Le
Paris noir (Hazan, 2001) et La
France noire (La Découverte, 2012).
- "Les sœurs Nardal, aux avant-postes
de la cause noire", Benoît Hopquin, M, le magazine du
Monde, 17 juillet 2021, 8 pages. Benoît Hopquin est notamment
l’auteur du livre Ces
Noirs qui ont fait la France : du chevalier de Saint George à Aimé
Césaire (Calmann-Lévy, 2009). À associer
à :
- "Paulette
Nardal, pionnière oubliée de la cause noire", entretien
avec Benoît Hopquin qui retrace son histoire, par Morgane Tual,
podcast le Monde, 6 octobre 2021, 22 min.
- "1931 : Les marraines de la négritude",
par Doan Bui, L'Obs, 23 décembre 2021.
- "Paulette
Nardal la négritude", Julie Gavras, Cherchez la femme,
Arte, 2021, 3 min.
- La revue Flamme (Fédérer Langues, Altérités,
Marginalités, Médias, Éthique), consacre un numéro
très riche à "Mondes
noirs : hommage à Paulette Nardal", n° 1, Université
de Limoges, 2021, avec en particulier les articles suivants :
› "Le Paris créole
des sœurs Nardal : une rétrospective historique (XVIIIe-XXe
siècles)", Erick Noël
› "Les Nardal : Textes,
co-textes, contextes", Cécile Bertin-Élisabeth
(article détaillé dans le livre que nous lisons, p. 143).
› "Paulette Nardal
ou le jeu du féminisme au prisme du genre grammatical",
Corinne Mencé-Caster
› "Le 'Rassemblement
féminin' (1945-1951) : à la croisée des différents
réseaux de Paulette Nardal", Clara Palmiste
› "Analyse du rapport
de Paulette Nardal sur le féminisme colonial (1944-1946) par une
approche postcoloniale et intersectionnelle", Clara Palmiste
› "Paulette Nardal,
les confidences de la femme des fiertés noires", Philippe
Grollemund
› "Entretien de Paulette
Nardal avec Paulo Rosine" (archive audio de FR3 Martinique -
Martinique La 1ère)", Paulo Rosine et Paulette Nardal
› "Archives territoriales
de Martinique"
› "Paulette Nardal
au Panthéon", Catherine Marceline.
- "1936 - Quand René Maran et Paulette Nardal écrivaient les pages coloniales de Je suis partout", Dominique Chathuant, Clio-Texte, 30 décembre, 2021.
- "L’Exposition coloniale de 1931", Pap Ndiaye, site du Palais de la Porte Dorée, 2022.
- "De récentes recherches féministes outre-Atlantique sur des femmes antillaises pionnières : les sœurs Nardal, des intellectuelles précurseuses de la négritude et du panafricanisme entre Paris et la Martinique au 20e siècle", Chloé Maurel, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 156, 2023, (étude universitaire : 17 pages).
- Enfin, soulignons le fait que la redécouverte des sœurs
Nardal vient des recherches américaines. Brent
Hayes Edwards est un chercheur américain important, spécialiste
de la culture noire, auteur de Pratique
de la diaspora, éd. Rot-Bo-Krik (initialement publié
en 2003, traduit en français en 2024). On lui doit Ecrire
le monde noir : premier textes, 1928-1939, de Paulette
Nardal, textes réunis et présentés par Brent Hayes
Edwards et Eve Gianoncelli, Rot-Bo-Krik.
Les deux entretiens suivants (Le Monde, RFI) sont très éclairants
:
›"Les
sœurs Nardal ont créé le milieu intellectuel noir francophone",
entretien avec Brent Hayes Edwards, par Séverine Kodjo-Grandvaux,
Le Monde, 10 mai 2024.
› "Les
sœurs Nardal, phénomène éditorial",
entretien avec Brent Hayes Edwards avec Valérie Nivelon, La
marche du monde, RFI, 2 juin 2024, 48 min 30.
- "Paulette Nardal, pionnière méconnue de la négritude" intégrant en bas de page un diaporama, par Tanella Boni, professeure de philosophie à l'université en Côte d'Ivoire, The Conversation (média généraliste en ligne qui fédère les établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophones), 30 septembre 2024.
- "L'afroféminisme", Cynthia Fleury, L'Humanité, 31 octobre 2024, à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif Marianne est aussi noire, où Silyane Larcher et Félix Germain évoquent les luttes occultées pour l'égalité, portées par les femmes afrodescendantes, des Antilles et de Guyane françaises, de Mayotte et de La Réunion, ainsi que des différents pays africains francophones ; sont citées : Maryse Condé, Simone Schwarz-Bart, Lucie Julia, Gisèle Pineau, Marie-George Thébia, Fabienne Kanor, Sylviane Vayaboury, Suzanne Dracius et, avant elles, Paulette et Jane Nardal, Suzanne Césaire, Suzanne Lacascade, Françoise Ega, Gerty Archimède...
| Nommer, honorer |
- En 2019, dans le XIVe arrondissement de Paris, la maire Anne Hidalgo
a inauguré un nouvel espace vert : la promenade
Jane-et-Paulette-Nardal. Les villes de Rouen et du Petit-Quevilly
organisent des "votations" pour choisir le nom des rues : c'est
ainsi qu'ont déjà été choisis les noms de
Françoise Sagan, Agnès Varda et Françoise Héritier.
En 2022, la votation pour déterminer les noms de deux nouvelles
rues communes aux deux villes dans le futur quartier Flaubert, concernait
cinq choix ; 654 personnes ont participé. Les résultats
: Hubertine Auclert : 399 voix ; Paulette
et Jeanne Nardal : 335 voix ; Georgette Agutte-Sembat : 217 voix ;
Assia Djebar : 166 voix ; Chantal Akerman : 150 voix.
- Renommage de la
rue Cuvier à Paris en rue Paulette Nardal, par l'ancien footballeur
Vikash Dhorasoo, devenu militant LFI : un vote a eu lieu entre Audré
Lordre, Saartjie Baartman, et Paulette Nardal.
- Signalons des visites parisiennes organisées par www.leparisnoir.com
Le musée Carnavalet propose aussi des visites de ses collections
sur ce thème "À
la découverte du Paris Noir".
- "Paulette
Nardal : pourquoi Anne Hidalgo veut la faire entrer au Panthéon",
L'Internaute, Julie Malo, 12 octobre 2021.
- Il existe une Association "Pauline
Nardal au Panthéon", très défendue par sa
présidente avocate Catherine Marceline, avec une page facebook
très active.
- "Paulette
Nardal mise à l’honneur dans un doodle pour son 125e anniversaire",
Google, 12 octobre 2022.
- "Le Panthéon ne serait
pas immérité pour les sœurs Nardal", entretien
avec Jean-Louis Achille, par Nicolas Ballet, Le Progrès
(Lyon), 25 mars 2023 : Jean-Louis Achille qui détient des archives
uniques sur l’émancipation des Noirs évoque ses grand-cousines,
les sœurs Nardal.
- Une pièce antillaise : 92140 chez les Nardal, de Haimegédéji qui présente son livre ici en vidéo, joué à la radio au salon du livre de Cayenne, autopublié, éd. Sydney Laurent, 2022.
Et voici NOS RÉACTIONS sur le livre
|
Les lectrices
|
Ce
15 décembre 2024, nous étions 16
à réagir sur le livre :
- en direct : Agnès, Anne,
Aurore, Claire Bi, Claire Bo, Flora, Joëlle L, Laetitia, Marie-Yasmine,
Nelly, Patricia, Stéphanie, Véronique
- par écrit pour la séance : Felina, Joëlle
M, Sandra.
Prise ailleurs : Sophie.
|
Les tendances concernant
le livre
|
C'est un sujet qui nous a toutes beaucoup intéressées.
Et l'importance du livre est indéniable. Mais un beau sujet ne
suffit pas pour emporter l'adhésion de toutes ! Commençons
par les aspects critiques :
- Ce n'est pas un roman et certaines, qui ont l'humeur au roman, ont traîné
la patte pour le lire. Toujours question genre, qui attendait une biographie
des (7) sœurs Nardal n'en a pas eu pour son argent.
- Parmi les écueils, certaines ont manqué d'un fil directeur
clairement apparent, ou ont regretté des répétitions,
bref ont pâti d'une lecture pas assez fluide à leur gré.
- Pire, il en fut qui accusèrent un flou, voire un manque d'objectivité
de l'autrice.
- Paulette Nardal n'est pas une blanche oie. Et politiquement, ça
coince. Quelle déception pour certaines !
D'autres points de vue, enthousiastes ou avec quelques
réserves, ont mis en valeur le livre, ses apports, ses éclairages,
ses nuances.
Alors finalement ?
- 50% des lectrices ont très
nettement apprécié :
•Agnès
•Claire Bo •Flora
•Joëlle
M
•Sandra,
tout en formulant quelques réserves :
•Anne
•Claire
Bi
•Laetitia.
- 31,3
% ont des réserves nettes,
voire vaches :
•Felina
•Joëlle L •Marie-Yasmine
•Nelly
•Stéphanie.
- 18,7
% ont lu quelques chapitres et pourraient donc adorer ou détester
le livre..., modifiant les pourcentages... :
•Aurore
•Patricia
•Véronique.
|
La succession des avis
|
Sandra
Cet ouvrage a été pour moi une découverte d'une histoire
familiale, d'une histoire de femmes, d'une histoire intellectuelle, d'une
histoire d'un courant de pensée.
C'est un livre donc au contenu dense, qui regroupe des tas de pistes de
réflexion à creuser, à discuter, à débattre.
Avant cette lecture, je ne connaissais pas en détail les tenants
et les aboutissants de cette posée nommée "la négritude".
Certes les noms d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar
Senghor ne m'étaient pas inconnus, mais je n'avais jamais approfondi
leurs pensées, leurs parcours.
Cet ouvrage, avec fluidité, nous ouvre les portes de la famille
Nardal, et avec elle nous parcourons leur île de naissance, leur
milieu intellectuel, leur parcours universitaire, le contexte des années
20-30, les échanges d'idées, mais également leurs
mésaventures et les difficultés à faire entendre
leur voix.
Une histoire donc passionnante de femmes, combatives, qui subirent le
fléau de la misogynie, de la volonté de rabaissement de
certaines jalousies, mais sans jamais taire leurs volontés : faire
valoir leur liberté de pensée, démontrer l'importance
de construire en débattant la mémoire des idées et
l'histoire, mais sans se mettre de côté du reste de l'humanité,
sans se définir en tant que victimes face aux "méchants".
La richesse de ces femmes a été de penser collectif, sans
cloisonner l'histoire de la culture noire, mais de l'intégrer à
celle de la France et du monde.
Il y a beaucoup à dire sur ce livre, mais il est de ceux qui permettent
de mettre fin à l'invisibilité de ces femmes, de toute origine,
de toute condition sociale, qui ont participé au rayonnement artistique
et intellectuelle, et qui sont encore oubliées de nos jours.
Cet ouvrage est comme un livre "réparateur" pour les
sœurs Nardal et les femmes de leur entourage qui ont également
participé à la construction de ce courant de pensée.
Il est le signe que grâce à des historiens, des journalistes
et des chercheurs qui travaillent avec objectivité et avec énergie,
nous pouvons encore nous attendre à de nouveaux apports de découvertes
historiques et d'établissements de la vérité.
Pour finir, pour reprendre le titre de la préface "Les héroïnes
de la conscience noire", était-ce vraiment des héroïnes
? Je ne sais si c'est vraiment le bon terme, il ne va pas avec les valeurs
et les personnalités qu'elles dégagent. Ce sont des femmes
intelligentes et combatives, d'une richesse d'initiatives et d'actions
judicieuses, et qui ont fait partie de celles qui n'ont pas voulu qu'on
leur impose leurs idées.
Felina
Je
n'ai pas été enthousiasmée,
j'ai trouvé que le livre ne parlait pas assez de la vie des sœurs
Nardal et que le style était trop académique. Cela m'a empêchée
de continuer une lecture fluide... Mais m'a donné envie d'en savoir
plus sur les Nardal.
Pardon pour ce micro-commentaire. Bonne séance de Noël et
bises à tutti.
Joëlle
M
Je ne suis pas très biographie, mais
j'ai bien aimé.
Claire
Et la négritude pour toi ?
Joëlle
Vaste sujet !
Stéphanie
Je
rejoins Felina. J'ai lu la moitié. Le sujet m'intéresse
énormément et j'étais ravie du choix. Je ne connaissais
pas les sœurs Nardal.
Et pourtant, le livre m'a déçue. Je n'arrive pas à
avancer. Il y a des répétitions. Ce n'est pas fluide. Je
me demande parfois qui parle. Je n'arrive pas à me retrouver.
Et ce n'est pas très bien écrit pour avoir des plaisirs.
Oui, c'est un vaste sujet comme dit Joëlle, toujours actuel. Et je
reconnais l'importance du livre.
Peut-être le format essai n'est pas très adapté.
Je reste sur ma faim concernant leur vie.
Mais je le lirai jusqu'à la fin.
Joëlle
L
J’ai été déçue.
Au départ, j'étais emballée à l'idée
de découvrir ces personnages. Je m'attendais à une famille
dans le genre des Klumpke (cf. extrait
des Américaines
de Bonal que nous avions lu), mais j'ai vite déchanté.
Première alerte : la préface très courte. Service
minimum de Mabanckou, dont le nom est plus connu et qui peut servir d'argument
vendeur. Mon impression était qu'il s'était fait prier,
puis s'était exécuté de mauvaise grâce…
Deuxième alerte : l'introduction qui dit qu'il ne reste aucun document,
tout a brûlé. Donc là, je me demande comment elle
va s'en tirer pour faire son livre. En fait elle s'en tire en compilant
des livres écrits par d'autres et en donnant son avis. Je m'attendais
à trouver des faits, pas une opinion. C'est plein de "je pense
que…",
"à
mon avis…", "il me semble que…".
Ça manque de vie, les personnages ne sont pas incarnés.
L'histoire est souvent vue par le petit bout de la lorgnette. Il y a quelques
anecdotes, mais elles sont contre productives, elles ne me donnent pas
une bonne image des sœurs Nardal. Par exemple Paulette qui "s'implique"
dans la grève de 1953 (en fait elle brise la grève en donnant
des cours en douce).
J'ai ramé pour lire le livre jusqu'au bout. Je l'ai terminé
juste à temps. La fin du chapitre XIV (reconnaissance tardive)
et le chapitre XV rattrapent un peu l'affaire. Le propos m'a semblé
plus clair, moins embarrassé, moins tortueux.
Parce que pendant les 3/4 du livre elle a essayé de me faire croire
que les sœurs ont tout inventé et qu'elles ont été
pillées par de méchants machos. À la fin, elles sont
plutôt des facilitatrices, des catalyseurs. C'est un rôle
important, il n'était pas nécessaire de me survendre ces
dames.
Déception, l'absence d'iconographie. Même pas un fac-similé
de la couverture de la Revue du monde noir. Alors qu'on la trouve
assez facilement sur internet.
En conclusion, un livre qui ne m'a pas charmée et m'a un peu frustrée.
Flora
Pour ma part, j'ai adoré. C'est un livre très riche.
Le seul bémol que j'y trouverais, ce sont les détails, trop
nombreux. Par exemple quant à sa foi religieuse ou l'effort de
guerre, on s'y étend trop. Ou encore pour ce qui est des orientations
politiques, trop de pages y sont consacrées.
Mais j'ai appris énormément de choses. C'est un livre important,
tout comme celui que nous avions lu de Titiou
Lecoq. Je ne connaissais pas du tout les sœurs Nadal.
J'ai été marquée par l'épisode de l'Exposition
coloniale. Elles ne sont pas montrées là sous leur meilleur
jour. Mais c'est intéressant de voir leur point de vue par rapport
aux colonies. Elles sont conservatrices.
J'ai aimé aussi la partie sur la départementalisation qui
permet de comprendre la situation d'aujourd'hui.
Bref, j'ai beaucoup aimé, découvrir ce livre, très
complet. L'écriture ne m'a pas du tout rebutée. Donc des
réactions très positives.
Anne
En général je peux avoir
un peu de mal à me plonger dans un essai, mais celui-ci m'a plu
dès le début.
J'ai bien aimé l'aspect chronologique du déroulement et
de l'enchaînement des chapitres, qui alternent entre la présentation
de concepts ou bien de grandes étapes de la vie des sœurs
Nardal. J'ai beaucoup appris sur la conscience noire, le féminisme
noire, et également sur la Martinique.
J'ai trouvé intéressant le fait de présenter les
traits de caractère d'un personnage important et modéré,
catholique et non communiste, engagé et non radicale, ce qui a
peut-être joué dans le fait qu'elle ne reste pas connue.
J'aurais aimé que le livre parle plus des autres sœurs Nardal
que de Paulette, c'est mon seul regret ; mais les archives ne le
permettaient peut-être pas.
Claire
Bo
C'est le
documentaire qu'avait fait l'auteure du livre qui m'a fait découvrir
les sœurs Nardal et quand le livre est sorti, je vous l'ai proposé.
J'ai aimé le ton du livre, ni militant radical (salop de Césaire
!), ni prétentieux (c'est moi qui ai découvert ces invisibilisées !),
ni extatique sur les Nardal (elles sont géniales à tout
point de vue !). Elle utilise des recherches qui ont largement précédé
son livre (une biographie clôt d'ailleurs le livre) et complète
par de nombreuses rencontres, variées (que j'ai toutes trouvées
instructives). Un peu comme avec Neige Sinno, mais dans un objectif bien
différent, on l'accompagne dans l'avancée non seulement
de la redécouverte du rôle des Nardal, mais aussi dans les
possibles explications de leur invisibilisation. Je la trouve prudente,
et j'apprécie qu'elle se situe dans et hors du sujet : dans car
son père est martiniquais, dehors car elle adopte une distance
propre au métier de journaliste.
J'ai trouvé particulièrement intéressant qu'une des
clés du rôle de Paulette vient du fait de ses études
d'anglais, car elle a ainsi pu faire se rencontrer Antillais et Africains
avec des Américains.
Le féminisme de Paulette est indiscutable, notamment à son
retour aux Antilles, et je trouve éclairant de nous montrer comment
sa religion, et surtout son appropriation de la culture occidentale, la
rendent conservatrice, limite colonialiste.
J'ai aimé comment elle découvre, telle l'héroïne
nigérienne d'Americanah
de Chimamanda Ngozi Adichie en arrivant à Philadelphie pour poursuivre
ses études, qu'elle est noire...
J'ai trouvé le livre agréable à lire, pas tellement
prise de tête, bien construit, et de surcroît le parcours
jusqu'aux JO de Paulette Nardal est tel, avec ses méchants et ses
gentils, des moments tragiques et des rebondissements heureux, que d'une
certaine manière, je l'ai trouvé romanesque...
Laetitia
Mon avis est positif avec quelques réserves.
J'ai
découvert les sœurs Nardal l'été dernier : en
juillet, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques
avec la statue de Paulette Nardal parmi les "10
femmes en or" ; puis en août à Arles, au LUMA à
travers une œuvre expérimentale et performative de William
Kentrige : une vaste installation intitulée "Je
n'attends plus" (visible jusqu'au 12 janvier 2025).
Mon intérêt principal a été pour le projet
du livre : faire connaître - voire faire sortir de l'invisibilité
- des femmes qui ont compté dans l'histoire de la Martinique. Un
peu comme le projet des
Culottées de Pénélope Bagieu ou de Titiou
Lecoq - Les
grandes oubliées - lues par Lirelles : l'idée
de redonner une place à des femmes oubliées ou méconnues
voire à des pionnières.
Un premier questionnement au début de la lecture du livre, sa
forme : il s'agit en effet d'un essai. S'agit-il de la meilleure forme
pour une première entrée dans un univers assez méconnu
de ma part, celui de la "négritude" et de la problématique
noir" ? N'aurait-il pas mieux valu lire déjà quelques
œuvres (Césaire, etc.) pour avoir après une vision
globale ?
Cependant, j'ai repéré très vite deux aides à
la lecture : d'une part le choix de l'aspect chronologique qui permet
de se "raccrocher" à des événements connus
(années 20, guerre, etc.) ; et d'autre part, l'alternance des "idées",
des "théories" avec des éléments biographiques
de la vie des sœurs (maison en Martinique, vie à Paris, voyages,
drames, etc.).
Mes principaux points d'intérêts :
- le salon littéraire de Clamart
- la Revue du monde noir
- leur personnalité très ouverte avec la richesse de la
dualité martiniquaise : patrimoine africain et héritage
européen
- la découverte de mouvements spécifiques :
› la Harlem Renaissance, p. 41 : mouvement de renouveau de la culture afro-américaine qui connaît son apogée durant l'entre-deux-guerres
› en association, le terme "New negro" ; 1925-1939 est une période de contributions importantes d'artistes, d'écrivains, de poètes, de musiciens afro-américains
› le mouvement Rastafari, p. 60 : mouvement social culturel et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 30
› Black Panthers, p. 63 : mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine d'inspiration marxiste-léniniste et maoïste, formé en Californie en 1966
› le Rassemblement féminin, chapitre 8
› l'afroféminisme français, p.132.
- la découverte de concepts :
› la "négritude", laquelle est au centre du livre : j'ai trouvé intéressant l'aspect historique et le rôle des sœurs Nardal ; elles semblent ainsi avoir été des médiatrices en faisant en sorte que les personnes se rencontrent ; sans compter leur compréhension de la double discrimination des femmes noires victimes à la fois de sexisme et de racisme
› l'afro-latinisme (Jane Nardal), p. 66
› le "féminisme noir" p. 115 : Paulette Nardal est pionnière
- le mélange de personnes connues et inconnues :
› René Maran : premier prix Goncourt noir
› Alan Locke : créateur du concept philosophique "New Negro"
› Félix Eboué
› Maryse Condé (p.86)
› Joséphine Baker
› James Baldwin
Quelques réserves : j'ai trouvé le livre quelquefois
difficile à suivre dans la compréhension du rôle des
sœurs (page 60), des enjeux de l'époque, de la différence
de positionnement politique (Aimé Césaire/Senghor).
Par ailleurs, on rencontre des personnages quelquefois inconnus, ce qui
nécessite une recherche en parallèle si on veut bien saisir
le sens de tout un paragraphe. Enfin, dans certains chapitres, certains
passages ou citations sont difficiles à appréhender (par
exemple chapitre 3, page 61).
Le livre se termine sur un espoir : on en est au tout début de
la redécouverte de leurs travaux (au passage, j'ai trouvé
intéressante l'habileté de Paulette Nardal à revendiquer
son travail à la fin de sa vie et à transmettre ses idées).
Je retiens cette phrase éclairante : "la porosité
intellectuelle et artistique entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique
qu'elles incarnent individuellement" (page 178).
En conclusion, je dirais que j'ai apprécié cette lecture
vers laquelle je ne serai pas forcément allée par moi-même.
Véronique
Je ne l'ai pas lu en entier - j'ai lu 70 pages - peut-être parce
que je n'avais pas la tête à ça, et aussi parce que
ce n'est pas un livre à lire dans le métro.
L'écriture m'a un peu déroutée.
Je vais le finir car j'ai envie de savoir.
Je m'attendais à une biographie, mais ce n'est pas du tout ça.
J'ai trouvé des redondances.
Concernant le gaullisme, le communisme, j'ai eu un peu de mal à
tout remettre en place.
C'est certes intéressant le fait que certain et certaines aient
disparu dans l'ombre d'Aimé Césaire.
Il faut que je le finisse.
Marie-Yasmine
Je
n'ai pas réussi à lire entièrement ce livre, un peu
par ma faute, par manque de temps et un peu par sa faute, par manque d'un
fil narratif clair.
Même lorsqu'il ne s'agit pas de fiction, j'apprécie qu'un
cheminement se dessine, et là il m'a manqué. Beaucoup d'informations,
qui mélangent les lieux, les époques, les personnes, pour
une parfaite néophyte c'est un abord confus et abrupt.
J'ai aussi eu du mal avec certains passages qui me semblent parfois être
plus l'opinion de l'auteure que de vrais éléments historiques,
sans pour autant être présentés comme tel.
Par exemple dans sa déclaration, la sœur aînée
dit avoir découvert sa couleur de peau à Paris, et dans
toute une partie avant, l'auteure nous décrit une société
classant les personnes selon leur carnation, plaçant la famille
Nardal en bas de la pyramide à cause de sa couleur sombre de peau.
Cela me semble contradictoire.
J'ai tout de même apprécié d'en apprendre plus sur
les sœurs Nardal. Le sujet du livre est très intéressant,
mais je n'ai pas apprécié son traitement.
Agnès
Cet essai biographique m’a plu pour sa dimension féministe
et intersectionnelle, pour ce qu’il m’a appris des différents
mouvements de la cause noire (que je ne connaissais pas) et pour sa concision.
C’est une bonne introduction, bien documentée, à la
vie et l’action des sœurs Nardal, particulièrement de l’aînée
d’entre elles, Paulette (en cela, le titre est un peu trompeur).
Je loue tout d’abord la démarche de l’autrice qui œuvre
à sortir ces sept femmes de l’ombre dans laquelle elles ont
été reléguées.
La première fois que j’ai entendu parler des sœurs Nardal,
ce fut dans le cadre de mon travail en 2019 quand une voie du 14e arrondissement
de Paris a été baptisée "promenade
Jane et Paulette Nardal". Comme je ne les connaissais pas (et
en particulier parce qu’il s’agissait de deux femmes), j’ai
cherché à savoir qui elles étaient. J’ai alors
appris qu’il s’agissait de deux sœurs, qui avaient posé
les bases théoriques du mouvement de la négritude.
Comme le souligne Alain Mabanckou dans sa préface, je n’avais
entendu parler que d’Aimé Césaire et de Léopold
Sédar Senghor (je ne connais pas le 3e homme cité, Léon-Gontran
Damas). Un nouvel exemple de l’effacement systémique des femmes
de l’histoire. Plus loin dans le livre, l’autrice explique bien
ce processus d’invisibilisation, par la misogynie de leurs contemporains
qui minimisent leur apport au mouvement, ainsi que par le manque d’archives
les concernant, et ceci jusqu’aux recherches menées au sein
des cursus universitaires sur l’histoire des femmes et du féminisme
(jusqu’en 2002 en l’occurrence pour les sœurs Nardal).
Au sujet de cette préface, je ne peux m’empêcher de
m’interroger sur le choix d’un homme, alors que l’autrice
souligne elle-même le paradoxe des préfaces rédigées
par des Blancs (Sartre par exemple) pour des livres rédigés
par des auteurs noirs. J’y vois un même positionnement de sujétion,
d’une caution recherchée auprès d’un représentant
du groupe dominant.
J’ai aimé cet ouvrage pour son prisme féministe (cette
sororie de sept sœurs, sans aucun frère, semble sortie d’un
conte), pour l’évocation du salon littéraire de Clamart
- nous sommes plusieurs dans ce groupe à avoir un goût prononcé
pour les salons, parce que ce sont des lieux qui ne se limitent pas à
réunir des intellectuel·les ou des artistes, mais des matrices
qui permettent les rencontres, la création de réseaux d’entraide,
le foisonnement des idées et la stimulation créatrice.
Ce livre m’a également apporté des connaissances relatives
aux différents mouvements de la cause noire et je me rends compte
que j’étais assez ignorante en la matière. Je retrouve
la même diversité des sensibilités, des positionnements,
des moyens de lutte, que dans les mouvements féministes.
Paulette, qui se situe dans la mouvance bourgeoise chrétienne aux
valeurs humanistes, a lutté, après l’obtention du droit
de vote, contre l’abstention et créé un mouvement féministe
pragmatique (sur l’éducation, la prise en charge des enfants
malades, des mères célibataires…). Elle s’est
intéressée aux violences subies par les femmes, s’est
interrogée sur le comportement (culturel) des hommes.
C’est une figure très intéressante et je comprends
que certaines militent pour qu’elle entre au Panthéon, en
tant que pionnière du féminisme (dès les années
30) et du féminisme noir en particulier.
Quant aux sœurs Nardal en général, leur jeunesse me
paraît idyllique, toutes réunies dans une grande maison,
auprès d’une mère et d’un père qui les
encourage à suivre des études, dans un grand foisonnement
culturel. Ce sont des vies qui sortent de l’ordinaire.
Ce livre m’a également intéressée par sa description
du système raciste : les castes sociales fondées sur la
couleur plus ou moins foncée de la carnation (colorisme), les réactions
que subissent Paulette et Jane à leur arrivée à Paris,
les notions d’exotisme et de doudouisme qui véhiculent les
pires clichés, la double oppression qu’elles subissent en
tant que femme et en tant que Noires (intersection des discriminations
de race et de genre).
Par ailleurs, à la fin de l’ouvrage, il est question de l’action
de Paulette en matière de réappropriation culturelle et
c’est un sujet auquel je suis très sensible en tant que Bretonne,
au travers de la redécouverte des chants, des danses, de la langue,
des costumes, etc.
Au final, un livre très instructif, concis mais très riche
en informations, qui m’a permis d’acquérir de nouvelles
connaissances (deux autres exemples, la départementalisation et
la résistance en Martinique pendant la Deuxième Guerre mondiale).
Nelly
Vos
commentaires m'enrichissent presque plus que le livre que j'ai lu sans
grand enthousiasme.
Laetitia omet de dire que nous nous sommes dit plusieurs fois : allez,
les sœurs Nardal, il faudrait qu'on s'y mette ! Révélateur
du manque d'accroche !
Pour ma part, j'ai lu trois pages tous les soirs pour m'endormir (et l'ai
terminé ce matin...). Ce n'est pas parce que c'était difficile
ou que cela ne m'a pas intéressée, mais j'aurais aimé
des choses plus légères pour la séance de Noël
!
Il y a un foisonnement d'idées, de choses, c'est intéressant,
mais un peu trop de choses, et sans une ligne nette, choisie pour raconter.
J'ai aimé l'aspect "salon littéraire" par exemple
ou les derniers chapitres qui apportent plus d'humanité, avec cette
traversée du désert pour Paulette, une certaine distance
par rapport à la vie et à ses joies. J'ai retrouvé
un intérêt qui baissait quand il était question de
politique.
Je n'ai pas toujours compris leur opposition politique d'ailleurs, elle
reste assez théorique, sinon que par rapport au débat d'idées
qu'évoque le livre, l'image de Leopold Senghor et d'Aimé
Césaire en ressort ternie je pense. Ils ont profité des
sœurs Nardal, sans leur accorder le retour qu'elles méritaient.
Vous écouter me décomplexe car j'ai toujours un peu de mal
à faire part d'un ressenti à propos d'un essai. Je ne connaissais
pas les sœurs Nardal, elles méritaient bien sûr leur place
dans la programmation de Lirelles.
Claire
Bi
J'étais d'emblée enthousiaste à l'idée d'une
lecture sur ces thématiques.
J'ai découvert plusieurs revues que je ne connaissais pas, et étoffé
ma galerie de personnages qui se sont croisés à Paris dans
les années 30 et dans le salon des sœurs (avec le maître
du rastafarisme !)
Je pense effectivement qu'elles ont fait médiation et que ce livre
participe à le faire reconnaître, mais dire qu'elles sont
les mères de la négritude serait inexact (et c'est un peu
ce que conclut le livre il me semble). Par contre il apporte beaucoup
sur l'afroféminisme, comme on le nomme aujourd'hui. Les réflexions
sur la sororité des femmes noires et la double oppression raciste
et patriarcale qu'elles subissent sont précurseurs (par exemple
p. 40-41, et notamment avec son article "L'éveil
d'une conscience de race"), même si d'autres pages influencées
par le conservatisme de Paulette Nardal sont surtout là pour justifier,
voire essentialiser sa propre absence de prise de position, notamment
sur l'empire colonial : "après s'être docilement
mises à l'école de leurs modèles blancs, peut-être
ont-elles passé, comme leurs frères noirs américains,
par une période de révolte. Mais, plus mûres, elles
sont devenues moins sévères, moins intransigeantes, puisque
tout est relatif. Leur position actuelle est le juste milieu"...
Tu m'étonnes qu'elle ait été mise de côté,
étant donné le contexte politique. Pour moi cet extrait
reflète bien l'ambivalence de la figure de Paulette Nardal et ses
pudeurs sur ce qu'elle appelle devant l'ONU "le problème colonial".
J'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de l'autrice.
Elle déplie sa recherche, nous fait partager son enquête
et ses questionnements par étapes, et les imbrique peu à
peu à l'histoire. Ses explications plurielles sur l'oubli où
tombées les sœurs Nardal replacent bien le cadre, et sont
valables dans d'autres circonstances :
- le manque d'archives (notamment l'incendie de la maison familiale) ou
d'archives réunies avant les travaux des années 2010
- "retracer des aventures collectives prend plus de temps"
et se double de la tendance à personnifier, autour d'une figure
centrale, un mouvement pluriel, ici Césaire
- invisibilisation des femmes coutumière, y compris à gauche
- conservatisme de Paulette Nardal, quand même très problématique,
qu'on ne peut pas éluder : ses écrits dans des revues
collabos, son amitié avec des patriotes, sa visite enchantée
de l'Exposition coloniale de 1931 ou sa distanciation dès le départ
avec les luttes anti-impérialistes et anti-coloniales. Partant
de là, c'est normal qu'elle ait été longtemps invisibilisée
par les Antillais. Il me semble par contre que là, la piste n'a
pas été creusée jusqu'au bout, soit par manque d'infos,
soit pour ne pas abîmer l'héritage de Paulette : visiblement
elle n'aurait rien dit du colonialisme hors Martinique, ni dans les années
30 ni lors des indépendances, ou de la ségrégation
aux États-Unis, au prétexte qu'elle "ne fait pas de
politique" (phrase typiquement de droite au passage). J'aurais par
exemple aimé lire son courrier à la revue sénégalaise
AWA
dont on nous parle à la fin et l'entretien qu'elle leur a accordé,
qui ne sont pas retranscrits, mais seulement cités. Cet angle mort
court un peu tout au long du livre, mais il est quand même suffisamment
traité en filigrane pour que le lecteur puisse se faire sa propre
opinion.
L'autrice truffe aussi son texte de pistes de réflexion avec les
historiens dont elle nous raconte les entrevues, comme par exemple Gilbert
Pago et ses analyses sur quatre sociétés post-abolitionnistes
américaines, ou d'infos intéressantes sur l'administration
coloniale et ses archives.
Le livre est centré sur Paulette, alors que la trajectoire de Jane
méritait à mes yeux plus de développement. Mais c'est
sans doute dû à un manque d'archives. Malgré tout,
le portrait mythifié du clan Nardal est sympa et la trajectoire
de Paulette intéressante, dans sa pensée et son vécu.
Le livre nous permet "de la percevoir dans sa singularité",
pour reprendre sa propre expression très juste. J'ai donc aimé
la suivre, de Paris à son retour aux Antilles, avec la fondation
de la chorale et d'un mouvement féministe martiniquais, et globalement
ce qui est dit ici de la construction des récits mémoriels
aux Antilles et des cultures créoles. J'aurais aimé croiser
un peu plus ses compatriotes Maryse Condé et Frantz Fanon.
Surtout le livre redit l'importance d'une part des médiations,
des lieux de rencontres, des revues, des traductions, etc., qui "font
exister les conditions matérielles et intellectuelles" des
courants de pensées (sociologie d'Howard
Becker qu'elle cite), et d'autre part la tendance générale
à s'attacher à faire émerger des figures solitaires,
presque toujours masculines, qui éclipsent ces coulisses indispensables
et au contraire collectives.
Il se conclut par une définition de l'écrivaine sénégalaise
que j'ai découverte ici, Awa
Thiam, de ce qu'est la logique colonialiste : "la déstructuration
des sociétés négroafricaines traditionnelles et la
dissolution de l'égo nègre" ; cette définition
peut nourrir les réflexions sur les dominations coloniales ou postcoloniales
qui existent toujours aujourd'hui. Et peut-être que finalement Paulette
était anticoloniale à son corps défendant...
Aurore
Je n'ai pas été sérieuse ne lisant que 70 pages.
Mais j'ai très envie de lire un roman plus qu'un essai. Pourtant
le sujet est intéressant. Mais il fallait se concentrer. Et sur
la version numérique que j'ai, je suis perdue quand il y a des
guillemets. Je ne sais pas si je continuerai, car je suis plongée
dans le livre de Michael McDowell,
Katie, une histoire où
deux femmes qui vivent dans la misère.
Patricia
J'ai lu trois chapitres. Pourtant le sujet m'intéressait énormément,
mais comme Aurore, je terminais un roman, L'incandescente
de Claudie Hunzinger, que j'aime beaucoup, mais ce que j'ai lu du livre
sur les sœurs Nadal m'a intéressée et je vais le finir.
Programmation des années précédentes – Liens – Nous contacter