|
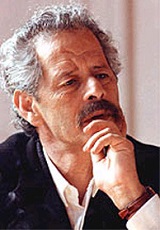
Extrait de Goodreads
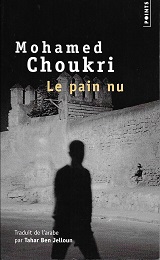
Quatrième de couverture : « Dans
le Maroc des années 1940, Mohamed assiste terrorisé au meurtre
de son frère par son propre père. Fuyant le "monstre",
il erre dans les bas-fonds de Tanger, côtoie la famine et la délinquance.
De ces nuits à la belle étoile, il gardera le goût
du sexe et l’amertume de la prison. La vérité crue
et l’audace littéraire de Mohamed Choukri ont fait de cette
autobiographie une œuvre culte.
Né dans le Rif marocain, Mohamed Choukri (1935-2003)
est l’auteur de romans ? notamment Le
Temps des erreurs, de nouvelles, de pièces de théâtre
et d’essais qui l’ont placé parmi les auteurs majeurs
de la littérature arabe.
"Un texte nu. Dans la
vérité du vécu, dans la simplicité des premières
émotions." (Tahar Ben Jelloun) »
Cette autobiographie publiée en 1980 a deux autres
volets publiés en 1994 et 1996 : Le
Temps des erreurs et Visages.
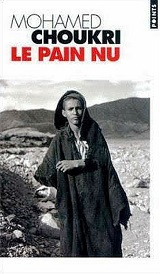
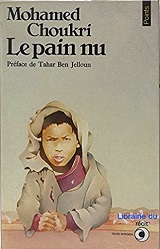
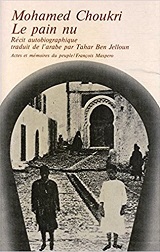
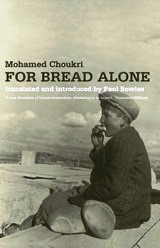
Le pain nu, première édition en 1973, traduit en anglais
par Paul Bowles
|
|
Mohamed Choukri (1935-2003)
Le pain nu
Nous avons lu pour le 31 mars 2017 ce
livre traduit en 1980 par Tahar Ben Jelloun, avec une préface
du traducteur.
C'est la lecture de Rue
des voleurs de Mathias Énard qui nous a donné envie
de lire ce livre. Les personnages
du roman évoquent en effet à plusieurs reprises le livre
(voir ICI ces passages).
Voir en
bas de page des infos sur le livre, l'auteur, la traduction.
Jacqueline (avis transmis)
(avis transmis)
J'ai aimé le style direct et sobre pour évoquer et la misère,
et la force vitale de l'enfance et de la jeunesse.
Pour moi, l'auteur a su créer un monde plus "vrai", plus
crédible que Boualem
Sansal. Il est entré en résonnance avec celui de Mathias
Énard dont j'imagine qu'il a eu connaissance... Il m'évoque
Calaferte
pour la situation et la haine du père mais aussi
Arenas pour la force vitale... Merci à Tahar Ben Jalloun pour
la traduction et merci à qui l'a proposé. La suite Le
temps des erreurs
m'a paru avoir un peu moins d'unité. Ouvert aux ¾.
Séverine
La tentation est grande de vouloir parler de ce livre en le comparant
à celui lu précédemment. Peut-être parce que
les deux traitent de l'enfance des deux narrateurs, à peu près
à la même époque et dans des milieux défavorisés
(mais certes pas dans le même pays). Si je cède à
cette envie de comparer, je dirais que je préfère de loin
Le pain nu à L'amie
prodigieuse. Certes, dans Le pain nu, le contexte est beaucoup
plus rude et plus violent que pour notre amie Elena, mais je trouve qu'il
y a une force, une brutalité dans le style qui ne peuvent pas laisser
insensible. On rentre dans le livre en se prenant un coup de poing dans
la figure. C'est direct, c'est cru. Et il y a une drôle d'impression
d'intemporalité et d'universalité : on en oublie parfois
qu'on est au Maroc, et on a du mal à situer l'époque.
Ce destin terrible m'a rappelé Kyra
Kyralina de Panaït Istrati : on est dans le même
cas de figure, et dans l'histoire, et dans la vie des auteurs (deux autodidactes
qui pour l'un a appris à lire et écrire tardivement et qui
pour l'autre a appris le français tout seul). Ça m'a rappelé
également Rue
des voleurs avec ce personnage principal éloigné
de sa famille (l'un par ce qu'on l'a renié et l'autre parce qu'il
veut fuir la violence) qui essaie de s'en sortir et enchaîne les
métiers honnêtes ou malhonnêtes et pour qui le sexe
est une question centrale. Le sexe justement, parlons-en : il participe
de l'intérêt du livre, car remis dans le contexte de l'écriture
de ce roman, on comprend toute la dimension révolutionnaire que
prend la crudité des descriptions. En tout cas, je remarque que
les prostituées ont été de tous les livres que nous
avons lus récemment : Rue
des voleurs, Rue
Darwin… et dans Kyra
Kyralina !
Pour apporter un bémol à mon commentaire, je dirai que plus
j'avançais dans ma lecture et plus je peinais : passé
la découverte du style et de la force du texte, j'ai trouvé
que l'on entrait dans une succession de situations qui peu ou prou étaient
toujours les mêmes. Donc, mon intérêt s'est émoussé.
Pour finir, je ferai deux remarques : dans tous les derniers romans
que nous avons lus, les livres et l'écriture ont été
des personnages importants de chacune des histoires. Et j'ai été
interloquée par le fait que la religion ne soit pas plus présente
que cela, mais j'ai tout de même noté cette phrase sur laquelle
je conclurais : "Tout
ça arrive à cause du vin et des femmes dans un pays musulman
gouverné par des chrétiens". Une citation
qui pourrait donner à réfléchir aujourd'hui encore…
Je l'ouvre à moitié. Bonne soirée !
Monique L (avis
transmis) (avis
transmis)
Difficile de parler de ce livre qui m'a pourtant fait une forte impression.
Ce n'est pas à proprement parler une œuvre littéraire.
En tout cas, ce n'est pas ce que j'en retiens, mais un témoignage
fort et sans retenue sur un monde que je ne connais pas. Des mots crus
qui dépeignent de façon très réaliste le quotidien
d'un gosse qui mène une vie de galère. Dans l'extrême
pauvreté, Mohamed n'a pas le choix, la vie le force à déraper.
Les dérives sont sinon inéluctables tout au moins faciles.
On ne peut pas blâmer. C'est un livre désabusé. J'ai
été saisie par la froideur déconcertante avec laquelle
la scène traumatisante et monstrueuse de la mort du petit frère
a été relatée.
Un autre fait m'a marquée et que je trouve terrible, c'est que
malgré la haine que Mohamed ressent pour son père brutal
et alcoolique et la révolte qu'il n'a cessé d'enfouir en
lui, il ne lui vient pas à l'idée de contrer son autorité.
Pour lui, c'est impensable ! "Je
vous l'ai dit : il est comme un Dieu. Mais qui lui a donné
ce pouvoir ?"
Une lumière à la fin puisqu'admirant et enviant un de ses
amis, un érudit, qui lui parle du Coran et lit des nouvelles du
journal, il veut apprendre à lire et à écrire.
J'ouvre en entier.
L'écrivain marocain, Abdellah
Taïa très visible ces derniers temps, et qui a vécu
son enfance dans le Maroc des pauvres, évoque fréquemment
cette œuvre qu'il dit avoir lu en cachette, comme tout le monde.
Monique S (avis
transmis) (avis
transmis)
J'ai lu Le Pain nu, pourtant je ne peux juger sur l'écriture
de l'ouvrage (style, choix et montage des séquences souvenirs)
car de qui est-ce ? Choukri dans son premier jet ? Oral ou écrit
(pourquoi pas, la littérature fut d'abord une superbe littérature
orale) ou alors retravaillé par celui qui lui avait commandé
ses mémoires ? Et puis cette drôle de traduction de
Tahar ben Jelloun... Comment savoir qui a fait quoi... Encore un livre
"accrocheur" sur le plan éditorial et économique
me dis-je, sur les dessous pas toujours jolis de la culture du Maghreb.
Néanmoins, j'ai lu ce livre sans m'ennuyer, parce qu'écrit
par quelqu'un qui a vécu ces événements, je me suis
attachée à voir comment la violence subie forme des bourreaux.
Cette question me turlupine depuis que j'ai pris connaissance des méfaits
tragiques du nazisme, puis bien d'autres, jusqu'aux islamistes aujourd'hui.
Quel est le germe, où se trouve le point de non-retour qui, mieux
connus, pourraient nous aider à ne pas basculer dans ce type de
comportements ?
Pour "ouvrir le livre", j'hésite un peu... disons ½
pour l'intérêt sociologique.
Nathalie R
Je n'ai rien écrit cette fois, mais je suis venue avec des vivres.
(Nathalie montre d'autres livres d'auteurs nés
au Maroc : Confidences
à Allah de Saphia
Azzeddine, de Mahi Binebine Les
Funérailles du lait et Le
seigneur vous le rendra. Elle évoque aussi Stéphanie
Gaou, libraire à Tanger.)
J'ai beaucoup aimé car j'ai vécu au Maroc, il n'y a pas
si longtemps. Et par rapport à ce que décrit le livre, pour
moi, pas grand-chose n'a changé : à Casablanca, je voyais
des maisons avec piscine et non loin et des gamins de 7ans qui sniffaient.
Parmi mes élèves, certains tombaient dans le coma profond.
Mahi Binebine,
qui est aussi peintre, sculpteur, raconte dans Le
seigneur vous le rendra, une sorte de pendant à ce livre,
comment un enfant a son corps modifié par les mendiants pour pouvoir
mendier. Quant au viol masculin c'est commun, car il y a une frustration
énorme, on ne peut en effet aller à l'hôtel sans être
marié. Stéphanie Gaou évoque une femme qui à
son tour consomme les hommes dans Capiteuses.
J'aime beaucoup la littérature marocaine. Ici, je suis choquée
par l'écriture hors norme : est-ce qu'il avait été
enregistré avant l'écriture ? Il y a des passages poétiques.
C'est une histoire noble. Avec plein de choses dans ce livre, qu'on m'avait
conseillé et qui était interdit. En effet, il dénonce.
Il m'a beaucoup émue. J'ouvre complètement...
Catherine 
Alors c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. J'ai aimé
la première moitié, c'est très percutant. L'assassinat
du frère par exemple… C'est très cru depuis le début,
très prenant, mais… au bout d'un moment mon intérêt
a décru. Toutes ces dérives en détail m'ont un peu
ennuyée à la fin. J'ai été étonnée
car on parle très peu de religion, avec tout ce sexe très
cru, par rapport par exemple à Rue des voleurs, où
la référence à la religion existe, ici c'est un univers
sans religion. Il est vrai que c'est moins récent. Avec ce style
très cru, c'est vraiment un livre réduit à l'essentiel.
Le style comme l'histoire sont très percutantes. J'ai surtout été
saisie par le début. Cet enchaînement de livres sur le Maghreb que
nous avons lu (Anima
de Wajdi Mouawad, Rue
des voleurs de Mathias Énard, Rue
Darwin de Boualem Sansal, et maintenant Le pain nu de Mohamed
Choukri), c'est très déprimant... Pas d'autre réflexion
sur l'écriture. C'est terrible comme histoire. Je l'ouvre à
moitié.
Françoise D
Je ne vais pas en dire beaucoup. Je suis aussi très étonnée
que la religion soit absente. Il n'arrête pas de picoler et de baiser.
Ça m'a surprise. Que le récit soit crédible, oui,
tout à fait. Après… je ne sais pas comment dire…
qu'est-ce que c'est que cette traduction ! Il l'a pas vraiment écrit
ce livre. Il a fait ça au fur et à mesure, c'est Bowles
qui a écrit. Est-ce que j'ai compris ou pas ? C'est Tahar
Ben Jelloun qui l'a traduit ? Je trouve que c'est mal traduit. De
toute façon sa préface est nulle… Une fois tout ça
posé, cette histoire est à la fois banale et extraordinaire ;
on sait qu'il s'en sort. Oui, parfois c'est poétique mais on retombe
très vite dans le trivial. Pour moi ce n'est pas un objet littéraire,
c'est le reflet d'une époque, il n'y a pas de dimension romanesque,
c'est un récit. Point.
Claire
Que veux-tu dire par "pas de dimension romanesque" ?
Françoise
C'est juste un témoignage.
Et à sa mort il a eu les honneurs du Maroc !
Donc, je n'y ai pas trouvé un intérêt très
important. Ça ne m'a rien appris, sauf ce qu'il a vécu,
lui, Mohamed Choukri. Heureusement le livre n'était pas gros…
J'ouvre au ¼.
Fanny
Le mot qui revient le plus, c'est le mot "cru" et effectivement
c'est un mot central. Pour ma part, j'ai trouvé qu'on était
au plus près ce qu'a vécu cet enfant. Je n'ai rien lu autour
du livre. J'ai une certaine admiration pour le courage et la capacité
à écrire un livre par rapport à son illettrisme,
et du coup cela a orienté ma lecture, j'ai eu du mal à critiquer.
Car j'étais au plus près de son ressenti d'enfant :
on est avec lui, collé à ce qu'il a vécu. Le côté
cru des termes ne m'a pas choquée. C'est la réalité
de ce qu'il a vécu. Le style est assez baroque avec des phrase
très poétiques ("Il
avait fait taire les oiseaux qui chantaient dans mon ventre"
p. 85). Par rapport à la religion,
je ne sais pas si c'est si absent que ça (et on est décalé
par rapport à notre époque) ; p. 132 on lit :
"Tout ça
arrive à cause du vin et des femmes dans un pays musulman gouverné
par des chrétiens. Nous ne sommes ni des musulmans ni des chrétiens."
Par contre, effectivement, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai
dû le poser pour lire autre chose, mais quand je le reprenais j'avais
du mal à le quitter. De l'ennui ? Non pas forcément,
mais une forme de lassitude. J'ai dû le feuilleter pour aujourd'hui
afin que les choses me reviennent. Et sur le contenu, bien des choses
au bout de 10 jours ne me reviennent pas. J'ouvre aux ¾.
Annick A
Ce livre m'a saoulée. J'ai fait des efforts. Toutes les descriptions
m'ont ennuyée. Effectivement c'est très violent. J'ai lu
après sur le livre. Je me suis dit que c'est pas de la littérature.
C'est pas parce que tu as souffert que tu peux en faire un livre.
Nathalie
C'est pas un roman !
Annick
Oui, mais une vie pareille pourrait toucher. Je n'ai rien ressenti. Si
ce n'est de l'ennui par rapport à l'écriture. Y pas de belles
phrases. J'ai eu un intérêt par rapport à la vie du
Maroc. J'ouvre ¼ parce que l'intérêt c'est qu'il ait
pu écrire ce livre. La poésie moi je ne la vois pas, je
trouve ça très pauvre. Pour moi ce n'est pas de la littérature.
Danièle
Il y a peut-être deux niveaux dans ce livre. D'une part il y a la
société, avec la violence verbale, crue, la lutte pour la
survie, la faim. Et on comprend pourquoi il a été interdit
au Maroc vu l'image qu'il décrit. Les femmes sont considérées
par les personnages masculins comme le mal, la rouerie. La violence envers
elles est normale : la première femme battue que connaît
le narrateur, c'est sa mère, le premier homme violent c'est son
père. Bien qu'il haïsse son père pour sa violence,
il imagine, enfant, qu'il n'y a pas d'autre voie dans cette société :
il fera comme son père.
D'autre part, le personnage lui-même. Je ne trouve pas le livre
désabusé, il y a même une forme d'optimisme. Finalement,
il a un rapport avec les femmes qui n'est jamais violent. Lui les traite
comme des êtres humains. Il est ébloui par leur beauté
et plutôt gentil avec elles. De ce point de vue il se démarque
de l'univers masculin dans lequel il évolue. Dès le début
il apprend tout tout seul. Que les femmes pleurent plus que les hommes,
par exemple ! Il décide de voler tous le gens qui l'exploiteraient,
je trouve ça très mûr, il s'est forgé une réflexion
à partir de son vécu. Et il n'a pas de tabou sexuel, il
avoue aimer ces choses, qui sont pourtant mauvaises. Il est poussé
par son désir dans une société qui ne lui envoie
que des images de frustration. C'est un portrait de personnage à
part. Le narrateur ne se glorifie pas de cette attitude, cela est présenté
en creux, de manière douce et subtile. Ce potentiel de réflexion
et de dignité, cette énergie positive vont de pair avec
son envie d'apprendre à lire et à écrire. Cela lui
ouvrira des voies, son destin à lui.
Ce qui m'a choquée plutôt, c'est la traduction. Tahar Ben
Jelloun a mis beaucoup trop son grain de sel comme le montre l'article
dans lequel on voit des exemples de traduction littérale et ce
que Ben Jelloun en fait. Et les formules "Que veux-tu ?"
invraisemblables ! Ça m'a donné envie de connaître
l'opinion d'un traducteur. Quant à la religion, il n'y avait pas
les problèmes qu'il y a maintenant et qui nous rendent sensibles.
Plusieurs
Tu l'ouvres comment ?
Danièle
Ah… c'est une difficulté… je donnerai mon avis quand
je saurais quelle est la part de Tahar Ben Jelloun dans ce livre... Ça
me fait chuter à ½ et ce pourrait être ½ plus
ou ½ moins…
Richard 
J'ai une opinion très négative. Je cherche toujours quelque
chose de nouveau qui m'attire. C'est quasiment un documentaire sur la
culture marocaine. Un rapport sociologique pourrait faire la même
chose.
Je me suis emmerdé. Pour une fois, j'ai pu terminer un livre du
groupe une semaine avant, le samedi saint… Je l'ai réouvert
pour ce soir : tout le côté scatologique me déplaît,
les événements qu'il raconte, il y en a trop. Oui, il y
a quelques phrases philosophiques, mais tout est en style télégraphique.
Je ne me suis pas amusé. Je ne l'ouvre même pas !
Claire
J'étais très contente de lire ce livre que Mathias
Énard nous avait annoncé comme un grand livre.
Au début j'ai trouvé cela prenant, sidérant,
cette violence, cette crudité (le mot qui m'est venu comme vous
Fanny, Catherine). Puis je me suis lassée, j'ai trouvé que
ça patinait, ça tournait en rond, cela manquait de "construction".
Les personnages n'étaient pas "campés". J'ai guetté
les éléments de contexte historique (par exemple espagnol)
qui me remotivaient en m'instruisant. Certes, la présence de l'alcool,
du sexe, de la prostitution changent de l'univers musulman habituel. Mais
le narrateur ne m'inspire pas d'empathie, sa psychologie est frustre voire
floue. D'accord, c'est horrible, mais l'immoralité règne,
aucune valeur ou sens n'apparaît pour cet homme qui écrit
20 ans après les faits et à qui la distance de l'écriture
permettrait une forme de réflexion sur la dureté de la vie
et il y a juste ce programme "La vie il faut la vivre".
Avec tous les coups qu'il reçoit, je me disais au cours de la lecture
qu'il devrait être défiguré voire infirme et non beau
gosse... donc n'en rajoute-t-il pas ?...
Seul élément positif : la bisexualité paraît
très naturelle. Donc j'ai saturé et fini par lire (parcourir)
à toute vitesse. J'ouvre ¼ seulement, contente cependant
d'avoir découvert un "classique".
Se posent par ailleurs la question de l'élaboration de ce texte
et le rôle du traducteur.
Geneviève
Je suis très étonnée par vos commentaires !
J'ai l'impression de ne rien comprendre. Et votre rapport à la
traduction... Le livre existe par lui-même ! Celui qu'on a
lu, c'est celui-là !
Claire
On peut quand même s'interroger sur le rôle de la traduction...
Geneviève (qui est par ailleurs spécialiste
de la question)
Mais c'est un rapport fantasmatique à la traduction ! Moi je ne
lis pas comme ça. Même si quand je lis un auteur anglais,
je lis en anglais. Et je m'en fous de savoir s'il l'a vraiment écrit
lui-même. Je m'en fiche, je ne vais pas faire une enquête.
Et on est hors sujet quand on cherche à dire que ce n'est pas de
la littérature...
Brouhaha... Brouhahahah... Brouhahahahaha...
Geneviève
C'est ce que j'ai entendu : y a pas de belles phrases !
J'ai un passé de documentaliste en lycée professionnel alors
que je venais du monde de la littérature jeunesse, conçue
pour la classe moyenne bourgeoise, je me sentais à côté
de la plaque. Donc je me suis documentée et j'ai conseillé
ce livre aux (grands) gamins, j'étais gonflée quand j'y
pense.
Plusieurs
Ah oui !
Geneviève
Et ça a marché ! Aucun n'est revenu vers moi avec des réflexions...
Beaucoup étaient touchés par la réalité de
ce qui était vécu.
Quant à la religion, là aussi c'est une vision fantasmatique.
Je vais deux trois fois par an au Maroc, il y a une fascination pour l'alcool.
Il y a de beaux personnages de femmes. Et ce sentiment d'étrangeté
qu'a ce garçon par rapport à l'amour (il y a toujours quelque
chose qui s'effondre).
Je l'ai relu avec intérêt, je le trouve toujours "VRAI".
Je l'ouvre complètement.
Henri  

Je trouve que ce livre a le mérite d'exister. Il a un caractère
initiatique et j'ai un œil bienveillant puisque par l'intermédiaire
de la littérature, il va aller plus haut. Je l'ai lu comme Richard
rapidement. 15 jours après il ne m'en restait pas grand-chose.
Sauf l'épisode de la contrebande. J'ai oublié l'épisode
espagnol. Je ne vois pas pourquoi on ramène la religion ; parce
que c'est le Quart Monde, on s'interroge sur la religion ?… Soit
on peut considérer que le contexte instrumentalise ce livre, soit
on le considère comme un "objet" qui raconte une histoire,
son histoire (intéressante par rapport au confort dans lequel on
le lit) : il y a une énergie vitale, assez positive. Il va
faire son chemin sans se laisser influencer par les courants (machiste
par exemple). C'est de la littérature, tout est de la littérature,
mais ce n'est pas le genre de livre qu'on ouvre pour le plaisir de la
littérature, de l'écriture littéraire. Ces témoignages
ont le mérite d'exister. Ça parle de choses qui concernent
tout le monde. Je l'ouvre entre 0 et ¼ ou ½ pour faire politiquement
correct. Il me semble que la vie de Momo que raconte Romain
Gary, c'est bien plus romanesque...
Claire
Pourquoi ce sous-titre "récit autobiographique" ?
On n'indique pas ce sous-titre pour les livres de Christine Angot…
Et la préface que je trouve détestable assimile le narrateur
à l'homme de façon dévalorisante. A la radio,
j'ai entendu Ben Jelloun en parler d'une manière pas sympa.
À la fin du film adapté de ce livre, qui montre bien la
violence, il y a une très belle image : au cimetière,
on voit Choukri lui-même et derrière un enfant qui ramasse
des herbes pour faire de la soupe comme dans le livre, c'est poignant.
Geneviève
Pour revenir à la traduction, ce livre-là a été
rejeté au Maroc. Le traducteur donne une version recevable pour
un public français.
Brouhaha à nouveau...
Geneviève
Tout traducteur transforme. Même ce que vous dites (sur l'article
qui étudie la traduction) est transformé…
Nathalie
Il y a une magnifique hypotypose pages 113-114.
Tous
Gloups... ???
Nathalie
Une
hypotypose ? C'est une technique littéraire qui rend comme
vivante la scène.
Qu'est-ce qui appartient au traducteur, qu'est-ce qui appartient à
l'auteur ? Et l'influence possible des Confessions de Rousseau ?...
Claire
J'ai trouvé sur le blog d'Emmanuelle Caminade une analyse
très fine de sa difficulté à être touchée
par l'authenticité du récit en raison de l'écriture,
avec des exemples de langage soutenu qui ne vont pas ("que
m'importe", "Arrêtez
ces spéculations")...
Nathalie
Est-ce que la façon dont Georges Sand pour faire parler les paysans
ne choque pas de la même manière ? Et celle d'Eugène
Sue pour faire parler les voleurs ?
Claire
Et si on lisait Les
Mystères de Paris…
Nathalie
La façon dont la transcription des dialogues évolue, notamment
du 17e au 19e siècle. Et par rapport à la dissonance, dans
ce roman, contrairement à Sand où il y a une unité
de style...
Catherine
... si on décroche, c'est peut-être justement en raison de
la dissonance qu'on sent dans le style.
Claire
Au Salon du livre où le Maroc était invité, j'ai
écouté Abdellah Taïa qui rendait hommage à Choukri,
en insistant sur le témoignage de la misère partagée
et non sur sa plume. Il donnait l'impression de l'idolâtrer. C'est
le premier romain marocain traduit en français, c'est historique,
et à ce titre je suis contente de l'avoir découvert.
Le pain nu aurait été interdit au Maroc en 1998
suite au
choix de ce roman par une enseignante et aux plaintes des parents.
Nathalie
Actuellement, à la douane marocaine, il y a des contrôles
des livres, par exemple concernant des données géographiques.
On arrache des pages.
Geneviève
Il y a une omerta concernant tout ce qui touche à la sexualité.
L'auteur ici une sorte de fascination pour les femmes, sans mépris,
contrairement aux autres personnages.
Danièle (qui a aussi vécu en Afrique du nord)
Les hommes ne peuvent pas payer une dot, souffrent des interdits liés
à la sexualité. Il y a de nombreuses femmes divorcées
dans les grandes villes, en réalité ce sont des femmes répudiées.
D'autres lectrices
Renée (de Narbonne)
Je me suis plongée dans Le pain nu sans aucune préparation,
ni quatrième de couverture ou préface (j'aime bien rester
vierge devant un texte).
Le témoignage de cet enfant est bouleversant, on se doute vite
que c'est autobiographique. Ce père monstrueux qui tord le cou
à son fils comme on faisait aux poulets, qui bat l'enfant et sa
mère pour une peccadille, ne peut être que haï.
La façon dont il raconte la faim (la vrai faim que nous ignorons
tous) m'a touchée, et on comprend sa descente dans les bas-fonds,
le vol pour se nourrir.
Cependant, j'ai trouvé qu'il se délectait trop à
raconter les scènes de sexe et de viol. J'ai pensé : c'est
écrit en 1970 ? Voilà quelqu'un qui a lu Genet, la
poésie en moins ! Et bingo ! J'ai vu ensuite qu'il a
écrit plusieurs livres sur Genet...
Le témoignage s'en trouve affaibli : il ressasse des
expériences sexuelles sans intérêt (voir la fin !!!)
Selon votre critère : ouverture du livre à demi pour...
la faim.
Anne
Il commence dur, ce témoignage sur l'enfance maltraitée,
et se poursuit dur. L'empathie prend au ventre dès les premières
lignes. Une leçon de vie impressionnante. Tout mon respect à
celui qui a pu en sortir et qui a pu trouver les mots pour le dire. D'autant
que si l'enfant "Mohamed Choukri" était indéniablement
prisonnier de son entourage, de parents désespérés,
d'un milieu social carencé, d'un pays inorganisé dans une
époque spécifique, cet enfant des rues était avant
tout prisonnier des traumatismes qui s'étaient emparés de
son corps et de son psychisme. Il a fallu une énergique métamorphose
pour les soigner. Bravo pour la façon dont l'auteur réélabore
ses premiers émois sexuels et ses obsessions, mêlés
à l'idéalisation d'une déesse-mère-détruite
et femme inaccessible. La critique bourgeoise arabe parle de subversivité…
je ne leur souhaite pas de voir comment on érotise la douleur pour
en sortir. Peut-être d'ailleurs ont-ils perdu de vue la matière
dont ils vivent, la littérature, tant ils se sont défendus
de l'insoutenable "vrai" qu'elle contient. En poursuivant la
lecture, le développement de cette sexualité débridée
m'a semblé aller de soi et présenter la seule issue au "sans
issue" : il est urgent de calmer la faim et l'humiliation et
surtout d'échapper à l'ombre envahissante d'une grave dépression.
Mohamed est jeté dans les raies de la répétition.
Il ne connaît pas d'autres façons de faire que celle qu'il
a subi. Il est désolant en effet de voir comment l'enfant s'approprie
cette violence sans pouvoir rien en penser. Au fond, me suis-je dit, c'est
ça la malédiction, une masse écrasante de non dicible.
Mohamed ne sait pas d'où il vient, ne sait pas pourquoi il est
là (pourquoi moi ?), ne sait pas où il va. Il n'y a
pour lui aucun trompe l'œil au contraire de La
rue Darwin. Pourtant Mohamed trouvera finalement une structure
et des règles apportées par un homme, comme un beau cadeau
dont il pourra s'emparer : l'alphabétisation. Celle-ci le
conduira vers la voie de la sublimation. Peut-être toutefois, ferai-je
ici une critique. Je me suis laissé emmener dans les affres masculines
d'une sexualité et d'une jouissance impérative et tyrannique,
mais à l'instar des très fines descriptions des fantasmes
érotiques, j'aurais aimé voir plus clairement le fil rouge
des mutations progressives de l'intérêt du jeune homme pour
le savoir. Cette transformation de la violence et de l'érotisme
exacerbé vers la culture m'a semblé surgir trop brusquement
sans que j'en comprenne les détours. Les prémisses de la
curiosité pour l'écriture sont certes évoquées
mais en quelques lignes et tard dans le livre. Il y a peut-être
tout un aspect psychologique au sein de la métamorphose, dont je
veux bien croire qu'elle a eu lieu étant donné la qualité
du roman, qui m'a manqué. J'aurai mieux compris alors la voie positive
qui l'a amené à accepter d'un homme ce cadeau si fertile
de l'apprentissage alors que jusqu'alors il refusait tout. Cela aurait,
me semble-t-il, élargi l'histoire au-delà du subversif – provocation
dont s'est emparée la censure – et aurait approfondi
le déploiement de la résilience.
J'ouvre ce livre avec plaisir jusqu'aux trois quarts.
Muriel
J'ai trouvé ce récit autobiographique
intéressant, avec des descriptions bien campées des bas-fonds
de Tanger.
Le lecteur est vite embarqué dans l'errance misérable de
Mohamed, au travers d'un texte énergique car il est cru, violent,
brutal (un peu comme Anima).
Mais je n'ai pas apprécié les répétitions
vulgaires qui au bout d'un moment lassent, pour ne pas dire exaspèrent :
"je te cracherai dans
le trou du c...", "je
te pisserai dans le c..."
On se doute bien que l'auteur ne va pas utiliser la langue de Molière,
mais l'accumulation de mots orduriers n'apporte pas grand-chose.
Heureusement que le livre ne fait que 160 pages sinon, je n'aurais pas
été jusqu'à la fin. Vous l'aurez compris : je
n'ai pas aimé.
Le groupe de Tenerife a lu ce livre l'été
2021
Nieves
D'habitude je fais mes commentaires tout de suite après avoir fini
la lecture de l'ouvrage, cependant, cette fois-ci, il s'est écoulé
pas mal de temps avant de mettre par écrit mes impressions. Ce
n'est pas parce que ça m'a déplu, plutôt le contraire.
Mais ça m'a surtout impactée. Ces descriptions si acharnées,
implacables et rageuses des ambiances, du monde de misère et de
violence où vit le protagoniste m'ont coupé le souffle,
même si des fois on trouve des passages subtils et poétiques,
en particulier quand il parle des femmes et du sexe, bien qu'il n'ait
pas le concept de l'amour, ce qui semble normal étant donné
que dans sa vie personne ne lui a montré de l'amour. Il ne vit
que par les sensations à propos de ce qu'il voit ou de ce qu'il
touche. Il vit l'instant avec toute l'intensité d'un enfant ou
un adolescent qui survit au jour le jour, toujours au bord du gouffre.
Je remarquerai cependant le passage où, encore enfant, il décrit,
en la regardant en cachette, Amina, belle fille de famille aisée
qui suit tout un rituel avant de plonger nue dans l'eau. Un corps qui
réagit sans aucun artifice devant un beau spectacle, car c'est
la sexualité qui semble l'arracher ponctuellement à toutes
les misères vécues depuis son enfance, l'extrême pauvreté,
la violence, la famine, les drogues. C'est terrible et presque miraculeux
qu'une personne nourrie de tout ce qu'il peut avoir de plus odieux dans
ce monde ait pu devenir un grand écrivain.
Je pense que c'est un cas exceptionnel et c'est la raison pour laquelle
ce petit bouquin a produit une sorte de déflagration chez beaucoup
de lecteurs, en particulier, dans son pays où il a été
longtemps censuré. J'invite à lire l'histoire et une part
des commentaires à propos de ce texte où Choukri a osé
parler sans ambages de toutes les détresses humaines dont personne
avant n'avait osé le faire.
DOCUMENTATION SUR LE
LIVRE ET SUR L'AUTEUR
- 1972-2002 : 30 ans de l'écriture
à la publication au Maroc
- Quelques repères biographiques
- Ses œuvres traduites en français
- Que dit l'auteur lui-même ?
- Controverses concernant Tahar Ben Jelloun :
›sur
la publication
› sur
la traduction
- Le pain nu et la télévision
- Le pain nu au cinéma
1972-2002 : 30 ans de l'écriture
à la publication au Maroc
- Écrit en 1972. Aucune
maison d'édition n'a voulu le publier pour des raisons "morales".
- Traduit :
en 1973 en anglais par Paul Bowles
en 1980 en français par Tahar Ben Jelloun
en 1989 en espagnol par Abdellah Djbilou.
- Publié en arabe à compte
d'auteur en 1982.
- Censuré en 1983 au Maroc sur décision
du ministère de l'Intérieur. Les conservateurs religieux
reprochent à l'auteur d'entacher l'image de la société
marocaine et de porter atteinte à la religion musulmane. Ils l'accusent
d'encourager la déviance morale et sociale.
- Autorisé en 2002 : la censure
est levée, soit une année avant la mort de l'auteur.
Durant toute cette période, l'ouvrage circule dans un cercle très
restreint d'intellectuels, d'universitaires et de penseurs libéraux
: il est lu en privé et rangé dans les bibliothèques
personnelles à l'abri des regards.
Quelques repères biographiques
- 1935 : Mohamed Choukri naît à
Beni Chiker, dans le Rif. Sa langue maternelle est le berbère (rifain).
- 1942 : la misère pousse sa famille à émigrer vers
Tanger, puis vers Tétouan et Oran.
- 1946 : à 11 ans après une dispute familiale, il quitte
sa famille pour Tanger où il vit sans domicile, voleur, contrebandier
d'occasion et prostitué. Il est analphabète.
- 1955 : à 20 ans il fait une rencontre qui change le cours de
sa vie ; il est arrêté et emprisonné par les
Espagnols qui occupaient le nord du Maroc ; durant son séjour
en prison, il côtoie un partisan de l'indépendance qui commence
à lui apprendre à lire et à écrire.
- 1956 (année de l'indépendance du Maroc) : il quitte
Tanger, s'inscrit à Larache à 21 ans dans une école
pour apprendre à lire et écrire ; il persévère,
poursuit ses études (École normale) et devient instituteur,
puis professeur.
- Années 60 : il revient à Tanger, continuant de fréquenter
bars et maisons closes.
- 1966 : paraît sa première nouvelle ; il est découvert,
publié et traduit grâce à Paul Bowles ; il collabore
ensuite régulièrement à des revues littéraires
arabes, américaines et anglaises. À la même époque,
il fréquente aussi Jean Genet et Tennessee Williams.
- 1973 : c'est le premier volet de sa biographie Le pain nu, traduit
en anglais par Paul Bowles, qui le fait connaître d'abord dans le
monde anglo-saxon, puis en France grâce à la traduction en
1980 de Tahar Ben Jelloun.
- 1995 : il obtient le prix
de l'amitié franco-arabe (prix littéraire).
- 2003 : il meurt l'hôpital de Rabat d'un cancer ; il est inhumé
au cimetière Marshan en présence du ministre de la culture,
de hauts fonctionnaires, de personnalités du monde de la culture
et du porte-parole du Palais royal. Éloges dithyrambiques à
sa mort, y compris dans le monde arabe : revue de presse ICI.
- Les relations avec ses frères et sœurs n'étaient
pas ... terribles, raconte le site d'actualité marocain TelQuel
("La
seconde mort de Choukri", 16 septembre 2006). En revanche, il
fait bénéficier d'une pension à vie sa domestique,
Fathia, qui passa près de 22 ans à travailler pour lui.
Avant de mourir, il a souhaité que soit crée la
fondation Mohamed Choukri (qui prend forme concrètement en
2013) possédant ses droits d'auteur, ses manuscrits et travaux
personnels.
Ses œuvres traduites
en français
1980 : Le Pain nu, Paris, éd. Maspero
(collection
"Actes et mémoires des peuples")
1992 : Jean Genet et Tennessee Williams à Tanger, Paris,
éd. Quai Voltaire
1992 : Le Fou des roses, Paris, éd. La Découverte
1994 : Le Temps des erreurs, Paris, éd. du Seuil, deuxième
volume de l'autobiographie
1993 : Jean Genet à Tanger, Bruxelles, éd. Didier
Devillez
1996 : Jean Genet, suite et fin, Bruxelles, éd. Didier Devillez
1997 : Paul Bowles : le Reclus de Tanger, Paris, éd.
Quai Voltaire
1996 : Zoco Chico Bruxelles, Bruxelles, éd. Didier
Devillez
A noter : Le Pain nu est le premier roman marocain traduit
en France, suivi plus de 10 ans après par Le
Jeu de l'oubli de Mohamed Berrada (précise Farouk Mardam-Bey,
directeur de la collection "Sindbad" d'Actes Sud, dans
Libération)
Que dit l'auteur lui-même...
- De son parcours et de son
œuvre ? Réponse à
travers une interview
très intéressante sur Rif Planète, où
il évoque ses différents livres, les auteurs qui comptent
pour lui, etc.
- Le pain nu : une autobiographie romanesque ou un document sociologique ?
"Quand j'ai
dit faire de mon autobiographie Le pain nu un document plus sociologique
que littéraire, je voulais dire par là..." (voir
la suite ICI)
- Le pouvoir de l'écriture et le rejet de ses écrits ?
"Et puisque le pain des gens est politisé, écrire pour
en parler ne saurait qu'être un engagement politisé"
(voir la suite ICI)
- Et à la radio, deux
entretiens à France Culture : en
1998 (dans son appartement au dessus d'un café qui lui servait
de bureau, au milieu de ses oiseaux en cage, des plantes et des livres,
il raconte le Tanger de son enfance, sa rencontre avec Jean Genet, Tennessee
Williams ou Paul Bowles) et en 2003 dans le petit café Le Ritz
qui fut le dernier lieu où il donnait ses rendez-vous, en compagnie
de son ami écrivain Mohamed Berrada ;
Tahar Ben Jelloun qui est longuement interviewé n'est
pas tendre...
Tahar Ben Jelloun le
traducteur : controverse sur la publication
- En 1972, dans un article paru dans Le
Monde, Tahar Ben Jelloun qualifie les démarches de Bowles
publiant des Marocains de Tanger de "technique de viol".
- Pourtant, dans un article paru en 1978, dans Le
Monde, il ne met pas en cause Bowles au sujet de Choukri :
"Paul Bowles connaît la vie de Choukri. Il lui propose de
la raconter et de publier son récit chez Owen. Le livre paraît
en décembre 1973." Et pas davantage, dans la préface
au Pain nu datée de 1979 : "L'écrivain américain
Paul Bowles a adapté le récit de Choukri et l'a publié
en 1973 aux éditions Peter Owen à Londres sous le titre
For
Bread Alone".
- C'est Mohamed Choukri lui-même qui, en 1986, dévoile les
coulisses, racontant comment s'est déroulée la traduction-écriture
du Pain nu en anglais : "Lorsque
Paul Bowles m'a demandé d'écrire mon autobiographie, j'ai
répondu sans hésiter : Mais, je l'ai déjà
écrite. Elle est chez moi. Bien évidemment, je n'avais
pas écrit une seule phrase. Mais elle était déjà
inscrite dans mon esprit. Je comptais l'écrire après avoir
eu un peu de succès littéraire." (suite
ICI)
- En 2010, Tahar Ben Jelloun ouvre
lui-même une controverse qui se retourne contre lui. Il prétend
qu'après qu'un ami commun, Mohamed Berrada, l'a incité à
se lancer dans la traduction du Pain nu, il aurait découvert
que le manuscrit du livre n'existait pas : "C'est au moment
où je me lançais dans la traduction de l'autobiographie
de Choukri, Le Pain nu, que je découvris le subterfuge de
Bowles. Quand je demandai le manuscrit de son livre, je me rendis compte
qu'il n'existait pas. Choukri m'apportait chaque jour cinq ou six feuillets,
écrits la veille". Cette
version de Tahar Ben Jelloun est alors contestée par le romancier
et critique littéraire Mohamed Berrada à qui Choukri avait
donné le manuscrit intégral de son roman, antérieurement
à la traduction française (voir les détails ICI).
Tahar Ben Jelloun le
traducteur : controverse sur la traduction
Une analyse très fine de la traduction de Tahar Ben Jelloun et
de son rôle dans l'orientation du roman par Salah Natij (Université
de la Sorbonne Paris IV) : "Le
Pain nu de Mohamed Choukri et l'aventure de la traduction"
est très éclairante. Ce même article analyse la critique
arabe du Pain nu. Il montre également l'effet en retour
de la traduction sur l'original !
Un autre article sur la
traduction montre l'effet des choix du traducteur, qui radicalise la critique
de l’autorité parentale et patriarcale dans la société
marocaine et aggrave la misère de la famille de Choukri. Ben Jelloun
embellit parfois l'image de la femme. Quant à la religion, il a
tendance à aggraver et, parfois, expliciter la critique des valeurs
islamiques. ("Quand
la traduction libère : le cas du Pain nu de Mohamed Choukri",
Mustapha Ettobi)
Le Pain nu à
la télévision
- Apostrophes
du 15 février 1980 (15 min avec Choukri) : dans cette émission
consacrée aux souvenirs d'enfance, Bernard Pivot reçoit
avec Mohamed Choukri dont Le Pain nu vient de sortir chez Maspero,
Jean d'Ormesson, René Barjavel, Robert Sabatier, Hubert Comte ;
le livre est alors censuré au Maroc.
- En 2001, dans un documentaire de Planète
Thalassa (7 min), Choukri évoque ses débuts : "Paul
Bowles, il m'a présenté à cet éditeur qui
s'appelait Peter Owen. Alors il m'a demandé si je pouvais écrire
mon autobiographie. Je lui ai dit je l'ai chez moi, je l'ai déjà
écrite. Il m'a dit alors on signe un contrat provisoirement. On
l'a signé. Ce soir-là dans mon café à côté
de là où j'habite, j'ai demandé une petite bouteille
de vin et j'ai commencé à écrire le premier chapitre.
Et je lui dis à la fin à Paul Bowles que le livre il n'était
pas écrit. Alors il m'a dit pourquoi vous m'avez fait signer un
contrat sur un livre qui n'existe pas ? Et je lui ai répondu :
c'est le défi berbère. C'est comme ça."
Choukri évoque aussi Jean Genet, on voit sa tombe au Maroc...
Le Pain nu au cinéma
Un film, en ligne, Al-Khubz
Al-Hafi (Le Pain nu) de Rachid Benhadj, adaptation du roman, a
été présenté à Cannes en 2005, dans
une production italo-franco-algérienne. Le rôle principal
y est tenu par l'acteur marocain Saïd
Taghmaoui. Durée : 1h40.
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
     |
|
à
la folie
grand ouvert
|
beaucoup
¾ ouvert
|
moyennement
à moitié
|
un
peu
ouvert ¼
|
pas
du tout
fermé !
|
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|
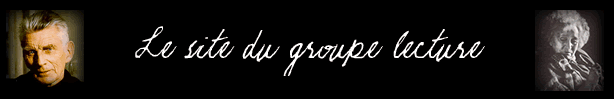
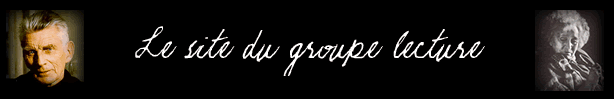







![]() Nous écrire
Nous écrire