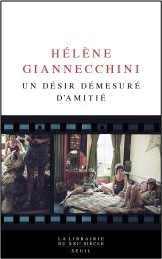Nous
avons lu pour le 9 mars 2025 :
| AUTOUR DU LIVRE • Parcours de l'auteure • Ses résidences • Ses textes • Expositions et événements • Entretiens radio et vidéo • Articles |
|
Et voici NOS RÉACTIONS sur le livre
LES
LECTRICES
Ce 9 mars 2025, nous étions 14
à participer de diverses manières à
la séance :
- en direct : Claire Bo, Joëlle, Laetitia, Mar, Marie-Yasmine, Patricia,
Sophie de Paris, Stéphanie, Véronique
- en visio : Agnès, Aurore
- par écrit : Felina, Flora
- par audio : Anne.
Prises ailleurs : Claire Bi, Nelly, Sophie de Nice.
TRÈS PARTAGÉES
-
A juste commencé le livre avec intérêt : Véronique
- Ont aimé, voire beaucoup aimé : Agnès,
Anne, Claire Bo, Laetitia,
Mar, Stefania
- Positive tout compte fait, mais avec une dent dure au tournant : Marie-Yasmine
- Positive un peu, mais tout compte fait mitigée : Flora
- Plus que mitigée : Felina
- Déçues : Aurore, Patricia
- Un livre qui est une épreuve, avec quelques aspects positifs
: Sophie
- Assez vache, tout en aimant quelques points : Joëlle.
LA
SUCCESSION DES AVIS
Puisque le livre s'y consacre, c'était l'occasion d'ajouter à
notre avis sur le livre quelques mots sur l'amitié.
Anne
(en audio)
Je regrette de ne pouvoir être présente avec vous, malheureusement
mon week-end musical et potager a pris le dessus sur le reste. Je tente
une première note vocale à partager, car j'avais beaucoup
aimé entendre l'avis d'une d'entre nous, parvenu par ce biais-là.
Je n'ai pas tout à fait terminé le livre - il me reste une
cinquantaine de pages - mais je vais le faire assez rapidement, car je
l'ai bien aimé.
J'ai d'abord aimé le titre, « Un désir démesuré
d'amitié », qui m'a donné envie de lire le livre.
Ça me parle, parce que, pour moi-même, les amitiés
sont très importantes dans ma vie.
Et d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, je parle de ma
famille. Depuis que je suis née, ma famille est composée
de personnes qui ne pas liées à moi par le sang, donc c'est
un concept - faire famille - qui a toujours été pour
moi plus large que le lien du « sang ». Et au-delà
des membres de ma famille, mes amis proches se sont mis à en faire
partie avec le temps. Donc, le discours d'Hélène Giannecchini
me parle beaucoup.
Peut-être que je m'identifie moins à la partie où,
si je comprends bien, elle se sent faire famille aussi avec les personnes
du passé qui l'inspirent, dans la communauté queer notamment.
Faire famille pour moi, c'est avec des gens qui sont proches, que
je connais, que j'ai connus pendant un certain nombre d'années,
avec une certaine intimité : et du coup, j'ai du mal à penser
faire famille avec des gens que je n'ai pas connus. Autant je peux admirer
très fortement des gens du passé auquel je m'identifie,
autant je n'aurais pas forcément parlé de lien familial
; mais c'était intéressant d'avoir son avis à elle,
on sent que c'est quelque chose de très fort pour elle, ce lien-là.
Sur la forme, j'ai bien aimé l'écriture. Le fait qu'il y
ait des photographies - d'habitude c'est quelque chose que je n'aime
pas trop, les bouquins où il y a des images quand ce ne sont pas
des romans graphiques - là, je trouve que ça marche
très bien. Ça m'aurait même plu qu'il y en ait un
peu plus - pas non plus dix fois plus... - et qu'elle les décrive
encore plus, car il me semble pour quelques-unes on se demande si c'est
d'elles dont parle le livre ou pas. Donc, ça m'a bien plu qu'il
y ait ces images, et ça m'étonne que ça me plaise
comme ça : donc ça c'était chouette.
Enfin, j'ai bien aimé, même si c'est dur parfois, me replonger
un peu dans l'histoire des mouvements queer : historiquement ce livre
apporte quelque chose.
Donc, en conclusion, je suis ravie d'avoir lu ce livre.
Felina
(par
écrit)
Je
ne peux me joindre à vous ce dimanche.
J'ai commencé le livre, mais je dois avouer qu'il ne m'a pas vraiment
conquise. Je n'ai pas réussi à dépasser la moitié.
À chaque fois que je le reprenais, c'était un peu à
reculons.
J'ai eu la sensation de divagation littéraire : on lit sans être
vraiment imprégnée par l'histoire et on enchaîne les
chapitres sans en distinguer les particularités. Avec aussi un
sentiment de répétition de certaines idées.
Mon impression est plus que mitigée. Je préfère attendre
vos impressions avant de décider si je dois persévérer
dans ma lecture.
Flora
(par
écrit)
Le
premier mot qui me vient c'est : déroutant.
Je m'explique : j'ai d'abord été très intéressée
par sa thématique car je trouve qu'il y a beaucoup à dire
sur l'amitié.
Puis, dès le premier chapitre j'ai trouvé l'approche de
l'autrice étrange. Vouloir s'approprier l'histoire d'autres personnes
de la communauté afin de se créer un passé qu'on
lui aurait caché étant enfant... bref, pourquoi pas, mais
ça partait mal.
Ensuite, je dirai que certains chapitres étaient instructifs/émouvants
(la partie sur les années SIDA, sur la famille choisie, la place
de l'amitié dans notre société), tandis que d'autres
m'ont laissée perplexe.
En fait, je pense que tout le long du livre je me suis demandé
où voulait en venir l'autrice, car nous avons des façons
de penser trop différentes et surtout certains passages étaient
inutiles : celui sur l'histoire de quatre amies d'enfance - je cherche
encore pourquoi elles ont été évoquées -,
celui sur la femme dont les amis sont venus chez elle vivre un temps pour
l'aider.
En fait, le principal défaut du livre selon moi est sa construction
: la thématique de l'amitié était souvent amenée
de façon alambiquée.
Dommage, car l'écriture est agréable et j'en ressors malgré
tout en ayant appris pas mal de choses.
En conclusion avis mitigé !
Joëlle
Désir démesuré…
J'ai bien peur de n'avoir pas trop compris ce livre.
D'abord je n'ai pas compris le plan (s'il y en a un). Je n'ai pas trouvé
le fil. Je n'ai pas eu l'impression de lire un livre, mais des chapitres
disparates, dont les titres ne m'ont pas aidée non plus à
voir une cohérence, à trouver une structure.
Pour moi, c'est un livre pas très clair, écrit dans une
langue pas toujours simple, avec plus de références universitaires
que d'incarnation. Ça manque de vie, c'est froid.
Le concept d’amitié queer ?
J'ai été gênée par ce concept, qui engloberait
gays et lesbiennes et toute la troupe. Parce que je ne crois pas que ça
marche comme ça. Queer, c'est un archipel, pas une entité.
J'ai repensé à la création du FHAR (Front Homosexuel
d'Action Révolutionnaire) au début des années 70.
Au départ structure mixte, ça n'a pas tenu plus d'un an
parce que les hommes ont pris toute la place, exactement comme chez les
hétéros. Et les filles sont parties vers le MLF où
elles ont fondé les Gouines Rouges (Monique Wittig).
Bien sûr, il peut y avoir des relations amicales entre deux personnes
ou des petits groupes, mais ce n'est pas généralisable.
J'ai l'impression qu'elle idéalise et plie le réel pour
le faire entrer dans sa thèse.
J'ai trouvé qu'il y avait des moments de «
victimisation
»,
ce qui, à titre personnel, me hérisse un peu. Par exemple,
dans le chapitre « Nous ne sommes pas
accidentelles » : «
Une partie de notre histoire est manquante parce qu’elle a été
volontairement détruite ». Oui, bien sûr, mais
ce n'est pas spécifique aux LGBTQI+. Il ne faut pas faire de parano.
Depuis l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par Jules César
jusqu'aux saccages des islamistes (Palmyre,
Bâmiyân, Tombouctou…) en passant par les guerres de religion
en France ou les autodafés nazis (livres, œuvres d'art…),
les destructions volontaires font partie de l'histoire humaine, malheureusement,
et elles visent toutes sortes de groupes.
En parallèle de cette victimisation, il y a parfois une idéalisation
sur les rituels familiaux (repas de famille, par exemple), dans laquelle
je ne peux pas la suivre, ayant moi-même longuement subi ce rituel.
Et présenter ces moments comme ceux de la transmission d'une histoire,
c'est faire fi des non-dits et autres secrets de famille.
À part
ça, j’ai bien aimé :
- l’emploi des photos, tout en regrettant qu’il n’y en
ait pas davantage, que ce ne soit pas un peu plus construit, là
aussi. On sent que c’est opportuniste. Quand elle a une photo elle
s’en sert, quand elle n’en a pas elle s’en passe.
- ses visites dans les archives, le sentiment de l’impossible, de
se perdre dans des dédales sans savoir où on va, ce qu’on
va trouver. Une aiguille dans une meule de foin ? Rien peut-être.
- le chapitre «
Comment
vivre ensemble
»,
plus concret, plus incarné. Même si les références
insistantes à Barthes m’ont agacée. J’ai vu il
y a peu le film L'attachement,
et c’est aussi un panorama des modes de faire famille (hétéro)
intéressant. Peut-être que le sujet est dans l’air.
L'amitié
et moi
Ma définition
: c'est un partage de sensibilités, d'opinions, de centres d'intérêt
et la possibilité de débattre.
Est-ce que j'ai des amis ? De moins en moins, avec le temps. Le cancer
du poumon a fait des ravages dans ma génération de fumeuses.
Qui sont mes amis ? Principalement des femmes, majoritairement lesbiennes.
Y compris plus âgées que moi, ce qui n'est pas bien prudent.
Quelques ex, mais pas tant que ça. Je n'ai pas créé
de tribu.
Auparavant, j'ai souvent participé à des petits groupes
qui passaient beaucoup de temps ensemble, week-ends, soirées, vacances.
Mais c'étaient des relations entre plusieurs couples et quand un
couple se défaisait, souvent le groupe périclitait.
Marie-Yasmine
(qui comme d'habitude a concocté une
douceur en rapport - même distant... - avec le livre,
ici son tout début hollandais : la recette =>ici)
J'ai
apprécié cette lecture, non pour la lecture elle-même,
mais pour les réflexions qu'elle a suscitées.
Sur la lecture en elle-même, je n'ai pas du tout apprécié
le zapping entre les histoires, qui surgissent parfois sans contexte et
ne permettent pas de s'immerger correctement. J'ai passé un temps
infini à aller et revenir, persuadée d'avoir raté
une page, et à froncer les sourcils en me demandant qui désigne
donc ces pronoms survenant subitement.
Le choix grammatical ne m'a pas aidée à sortir de ma confusion.
Je n'ai aucune difficulté avec ce choix que je trouve très
pertinent et à propos, mais la note l'expliquant aurait pu figurer
au début du livre, cela m'aurait épargné des froncements
supplémentaires de sourcils et des allers-retours confus dans ma
lecture.
Enfin, les longues descriptions de ses voyages dans diverses archives
étaient d'un ennui insurmontable. J'ai zappé tous ces passages.
Je voulais plus d'histoires, les siennes, celles qu'elle a réussi
à documenter, mais je me passe volontiers de savoir qu'une grande
allée bordée par des buissons mène à tel fonds
documentaire…
J'ai aussi passé les passages où elle joue aux devinettes
sur des photos anonymes dont elle ne sait rien. Je n'apprécie pas
le mélange des genres entre de la documentation solide et des rêveries,
j'ai assez des miennes, et dans ce genre d'ouvrages je préfère
les récits d'histoires qui sont tellement précieuses et
ne méritent pas d'être mélangées avec des suppositions.
Mais tous ces problèmes sont largement rattrapés par les
pépites que sont toutes ces merveilleuses histoires et par le développement
de ses réflexions et de celles d'auteurs qu'elle mobilise.
J'ai beaucoup apprécié le récit de son histoire personnelle,
que j'ai trouvé très belle et émouvante. Tant dans
sa relation avec ses trois parents qu'avec ses amantes et amies.
J'ai adoré être en désaccord avec les analyses qu'elle
présente et m'indigner dans de longs débats avec ma femme
sur la notion de déviance.
J'ai été très émue de son récit de
sa relation avec son ex-amoureuse devenue plus qu'une amie qui m'a ramenée
à des souvenirs douloureux.
Enfin, sur ma relation avec l'amitié, paradoxalement, et
malgré toutes les onomatopées indignées poussées
pendant ma lecture, je la partage grandement avec l'autrice.
Ma famille désastreuse m'a plongée très tôt
dans une quête désespérée pour trouver un endroit
où partager amour, rire, peines, mais aussi une solidarité
concrète et matérielle.
Malheureusement, ce besoin désespéré m'a amenée
aussi à accepter des relations toxiques pour ne pas perdre ce cocon
indispensable à ma vie.
Après m'être soignée de mes blessures d'enfant et
d'ado, je suis devenue plus attentive à construire des liens plus
sains, et certaines relations n'y ont pas survécu.
Je n'ai jamais eu le cœur brisé par des amoureuses, mais je
porte encore le deuil de mes amitiés perdues.
J'ai vécu longtemps dans des appartements partagés entre
des ami.es et des amoureuses avec beaucoup de joie. Dans un espace adapté,
cela serait avec enthousiasme que je réitèrerais, notamment
à la retraite.
Aujourd'hui, je désespère un peu de trouver en dehors de
mon couple un espace de connexion, de partage et de solidarité.
Mais je n'abandonne pas cette quête, sans toutefois m'y sacrifier
comme j'ai pu le faire auparavant.
Je rajoute après avoir écouté mes camarades (merci
pour le terme très bien choisi par Claire) que je regrette également
le manque de références françaises.
Laetitia
J'ai découvert cette écrivaine théoricienne, spécialiste
des rapports entre texte et image.
D'emblée, je suis entrée dans le livre avec un sentiment
très positif ; les titres des chapitres m'ont intriguée
et m'ont donnée envie d'avancer. Par ailleurs, j'ai été
séduite par le fait d'avoir à la fois du texte et des photos.
Un bon équilibre en quelque sorte.
Cet essai est riche : de nombreuses notions sont abordées, de multiples
références sont citées, différents lieux aussi
: Paris, Amsterdam, New-York - Brooklyn, Le Vermont, San Francisco, Marseille,
Bruxelles.
Dès le premier chapitre, l'auteure pose le projet de son livre
: déconstruire la notion de la « famille traditionnelle »
et proposer de la réinventer, de la réinvestir, de l'enrichir
- à partir de l'existant mais également en faisant appel
à sa propre histoire et expérience.
Pour cela, elle va citer des exemples personnels - ses deux pères,
l'amie de la famille -, elle va également s'appuyer sur des
tirages photographiques, ainsi que sur des extraits (d'essais sociologiques
notamment).
Les points d'intérêts
- La réflexion sur des concepts : l'amitié, le «
Faire famille » (p. 192) ; la notion de « famille
choisie » (différente de celle de « communauté
» ou bien de « réseau »)
de « proximités latérales
»,
de « kinship » (la diversité de nos liens),
le « vivre ensemble », le mariage…
- La réflexion sur les termes : amies/amantes/compagnes/camarades/sœurs/voisines…
- L'émotion suscitée par la découverte de la photographe
new-yorkaise Donna
Gottschalk (photographe et activiste américaine des années
70 et 80).
- L'histoire des mouvements LGBT (les références à
Act up, Stonewall…)
- La réflexion sur les années Sida, le lien entre les personnes
arrivées après et la communication bonne ou mauvaise (cf.
chapitre dans lequel elle évoque sa relation avec Myriam).
- Les multiples références à la culture LGBT, queer,
avec de grands noms : Monique Wittig, Sarah Schulman (cf. After Delores,
lu à
Lirelles en 2018), Susan Sontag (lue
aussi à Lirelles), Christine Delphy.
- Les photos choisies : j'ai apprécié le positionnement
de celles-ci ; elles n'éclairent pas le propos, elles représentent
le point de départ de la réflexion.
- La question des archives et de la mémoire, du souvenir
- Casa Susanna évoquée dans le chapitre «
Dévier ».
J'avais découvert cette communauté à Arles en 2023
lors des Rencontres
de la photographie ainsi qu'à travers le
documentaire de Sébastien Lifshitz.
- Dans les dernières pages, Hélène Giannecchini termine
sur un espoir lié à tous ces liens face à un contexte
politique compliqué (p. 261).
J'avais une réserve quant à la forme (le choix des pronoms)
qui a été levée par la « note de l'autrice
» en fin de livre. J'ai par ailleurs apprécié les
petites notes discrètes tout au long du livre, très immédiates
et qui s'intègrent bien au texte.
En conclusion, j'ai aimé cette lecture !
Trois mentions spéciales
- La notion d' « architecture féministe » (Phyllis
Birkby) : une découverte !
- La référence aux femmes et aux « clubs de lecture
» (p. 210) !
- La mention des « Terres
lesbiennes » de l'Oregon : je souhaite en savoir plus !
Petite
note personnelle sur l'amitié
L'amitié
est très importante pour moi.
J'aime la notion de «
Faire famille »,
de famille élargie dont parle Hélène Giannecchini
: j'ai ainsi une amie fidèle depuis maintenant… 45 ans !
Mar
(qui participe pour la première fois)
J'ai beaucoup aimé ce livre, il m'a vraiment touchée.
Le
sentiment de « ne pas avoir d'histoire » résonne beaucoup
en moi, car j'ai l'impression que chaque fois que j'apprends de nouvelles
choses sur l'histoire LGBT, c'est presque par accident.
Quand l'autrice évoque le monument
au poète qui a donné son nom au livre, elle écrit
: « Les deuils communautaires sont souvent vécus de manière
solitaire, je me suis sentie soulagée d'avoir, pour une fois, un
endroit où aller. » Je ressens la même chose en
découvrant ce livre dans le cadre de ce club de lecture, et je
suis heureuse de ne pas être la seule à l'avoir lu.
Un autre passage que j'aimerais mentionner est : « À un
certain moment, on réalise sa déviance, on s'y consacre,
personnellement j'ai même tendance à croire qu'elle m'a sauvé
la vie. » La raison pour laquelle moi aussi j'ai l'impression
que le fait d'être queer m'a sauvé la vie, c'est parce que
tout d'un coup, tout est devenu possible. Si je ne suis pas « normale
», alors je peux être ce que je veux, et avant tout, je dois
trouver des mots pour exprimer ce que je veux. Je pense que c'est un processus
très important, et que le fait d'être queer m'a donné
beaucoup d'autonomie dans ce sens-là.
La seule chose qui m'a laissée un peu mal à l'aise, c'est
que certaines des images présentées dans le livre sont des
photos anonymes dont on ne sait rien, accompagnées de spéculations
sur ce que pourraient être leurs histoires et je comprends bien
que ces spéculations sont bienveillantes, l'autrice explique très
bien quel est le but de cet exercice. Je trouve que c'est un exercice
magnifique à faire pour soi-même, mais quelque chose dans
le fait que ce soit fait publiquement me met un peu mal à l'aise.
Sur « l'amitié et moi »
Je dirais que l'amitié, pour moi, est une véritable nourriture
émotionnelle. Ce qui fait un.e ami.e, c'est avant tout la qualité
de présence que l'on s'offre mutuellement.
Les personnes que je considère comme mes ami.es sont celles avec
qui j'ai des choses importantes en commun et avec qui le contact se fait
naturellement, presque comme une sorte de gravitation. Ce sont des personnes
avec qui l'interaction est fluide et instinctive : je sais reconnaître
quand elles ont besoin d'une conversation sérieuse ou profonde,
et quand elles ont plutôt besoin de légèreté
et de distraction et cette attention est réciproque.
Mes ami.es sont bien plus important.es pour moi que les personnes avec
qui je partage des gènes, car cette affinité dont je parle,
qui est essentielle dans mes relations les plus proches, n'est pas évidente
du seul fait d'appartenir à la même famille biologique.
Agnès
Tout
d'abord, pour répondre à l'invitation de Claire, quelques
mots sur l'amitié.
Ce
sont des relations extrêmement importantes pour moi, qui suis fille
unique et lesbienne. Donc sans sœur ni frère, ni belle-sœur
ou beau-frère, ni nièces ou neveux, et avec un très
grand besoin d'échanger, de partager, d'être entourée
et d'appartenir à une communauté. Sans oublier que les femmes
sont éduquées à être plus des rivales que des
amies solidaires (contrairement aux hommes qui sont éduqués
au compagnonnage).
Depuis l'école maternelle, les ami·es m'ont tenu la main,
l'un·e après l'autre, pour parcourir le chemin de mon existence
et me faire découvrir le monde, jusqu'à aujourd'hui. Chronologiquement,
je pense à mes meilleur·es ami·es, Franck, Corinne,
Véronique, Valérie et aujourd'hui, depuis 20 ans, Muriel,
très différente de moi de par son milieu, ses opinions politiques
et son mode de vie, mais si proche que je la considère comme ma
grande sœur.
Je pense aussi aux bandes d'ami·es auxquelles j'ai appartenu, aux
associations LGBT et féministes grâce auxquelles j'ai forgé
de belles amitiés, solidaires et stimulantes.
J'aime ce concept de famille choisie et, en y réfléchissant,
je m'aperçois que je vis selon ce modèle depuis ma naissance
et que des ami·es se sont agrégé·es à
ma famille biologique depuis plusieurs générations. À
quel âge ai-je découvert que Tata Simone, une amie de ma
grand-mère, n'était pas ma tante ?… J'en suis alors
venue à m'interroger sur cette notion de « famille à
la mode de Bretagne » qui, par extension, inclut les parents éloignés
dont la parenté est difficile à établir (personnellement,
j'ai dû créer un tableau Excel pour comprendre quel lien
j'avais avec un tel ou une telle). Par extension encore plus vaste, ma
famille inclut certain·es ami·es et même nos animaux
de compagnie, qui sont aussi des personnes à part entière.
Et des ami·es.
Mon avis sur Un désir démesuré d'amitié
C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné
du plaisir à la lecture. Et qui a aussi suscité ma réflexion.
J'ai apprécié la démarche d'investigatrice d'Hélène
Giannecchini et je l'ai suivie avec intérêt. J'ai aimé
reparcourir des lieux que j'ai visités, comme le monument constitué
de trois triangles à Amsterdam où je me suis rendue avec
un groupe d'amies des Archives lesbiennes de Paris au début des
années 90. L'autrice suit son interrogation et nous expose les
différentes étapes de sa recherche. Elle aborde de nombreuses
thématiques, toutes passionnantes, l'amitié au temps de
l'épidémie du sida, la question des archives LGBT, les liens
amicaux qui ne sont pas reconnus par l'hôpital, les familles biologiques
et la loi, l'amitié vue comme un instrument révolutionnaire
qui permet de construire une société idéale, selon
Saint-Just.
Premier bémol : j'ai tout de même eu l'impression d'un manque
de plan et d'un « fourre-tout », même si l'expression
n'est pas jolie et certainement injuste.
J'ai beaucoup apprécié en revanche que le livre soit parsemé
de photographies et qu'il donne ainsi chair aux personnes évoquées.
J'ai aimé qu'elle parle de la Casa Susanna, car j'avais été
très émue par le
documentaire qui a été consacré à cette
maison.
J'ai aussi trouvé intéressant qu'elle parle de sa vie personnelle,
de sa mère et ses deux pères, et de l'amie lesbienne qui
a partagé leur vie.
Enfin, j'ai apprécié que le récit soit très
contemporain, qu'il évoque des faits et des débats très
récents (comme le « réarmement démographique
» de Macron, par exemple).
Un second bémol malgré tout : l'autrice s'appuie beaucoup
sur des exemples américains (les archives lesbiennes de New York,
San Francisco, les terres lesbiennes de l'Oregon, etc.). Elle évoque
les Archives lesbiennes de Paris dans ses remerciements, mais c'est tout.
Elle aurait pu s'intéresser à des exemples de vie communautaire
en Angleterre, en Allemagne, aux maisons de vacances lesbiennes dans le
Sud-Ouest de la France, etc. Pour moi, c'est un manque en tant que lectrice,
lectrice lesbienne.
Je profite de ce thème de l'amitié pour vous signaler la sortie prochaine du nouvel ouvrage d'une jeune autrice que nous connaissons ici (au Croisic), Lucile Peytavin, qui est venue faire une conférence dans le cadre de notre association féministe sur son ouvrage précédent, Le coût de la virilité. Son nouveau livre s'intitule Sororité : le pacte. Il s'agit d'un « manifeste féministe qui pose la sororité comme fondement et propose un pacte de solidarité entre les femmes ».