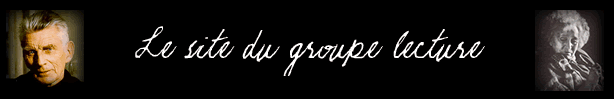
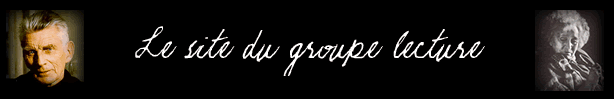 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Quatrième de couverture :
Le "héros de notre temps", c'est Grigory Petchorine,
jeune officier cynique et désabusé de cette première
moitié du XIXe siècle. Petchorine séduit les femmes
mais s'en lasse presque aussitôt et les délaisse. Envoyé
en garnison au Caucase, dans la splendeur des montagnes et des vallées
verdoyantes, il croise tour à tour une belle Circassienne, fille
du chef d'une indomptable tribu montagnarde, puis une jeune princesse
Pétersbourgeoise en villégiature, qu'il ne pourra s'empêcher
de vouloir séduire. L'auteur : Mikhaïl Lermontov, né en 1814 à Moscou, est un poète et écrivain russe. Son poème La Mort du poète, écrit en 1837 après le duel qui fut fatal à Pouchkine, lui vaut d'être en sorte d'exil envoyé combattre au Caucase où il trouve la mort, lui aussi en duel, à l'âge de vingt-six ans. Illustration de couverture : portrait de Lermontov par Piotr Zabolotski (1837)
Quatrième de couverture :
On a souvent fait d'Un héros de notre temps le
premier roman psychologique de la littérature russe. Mais l'analyse
y est toujours subordonnée à cette ironie dominante, à
ce regard distancié et critique que Petchorine, personnage principal
et narrateur, jette sur ses aventures. À juste titre, on y lira
les signes d'un certain essoufflement de la sensibilité romantique
; mais on verra aussi en Petchorine l'aîné de ces héros
sombres qui peupleront les plus grands textes de Gontcharov, Tourgueniev
ou Dostoïevski. À bien des égards, en effet, le court
roman de Lermontov, étrange, décousu, fascinant, annonce
les romans russes de la deuxième moitié du XIXe siècle. |
Mikhaïl Lermontov (1814-1841)
|
|
Un
héros de notre temps est constitué de 5
récits
:
|
|
Nos
13 cotes d'amour |